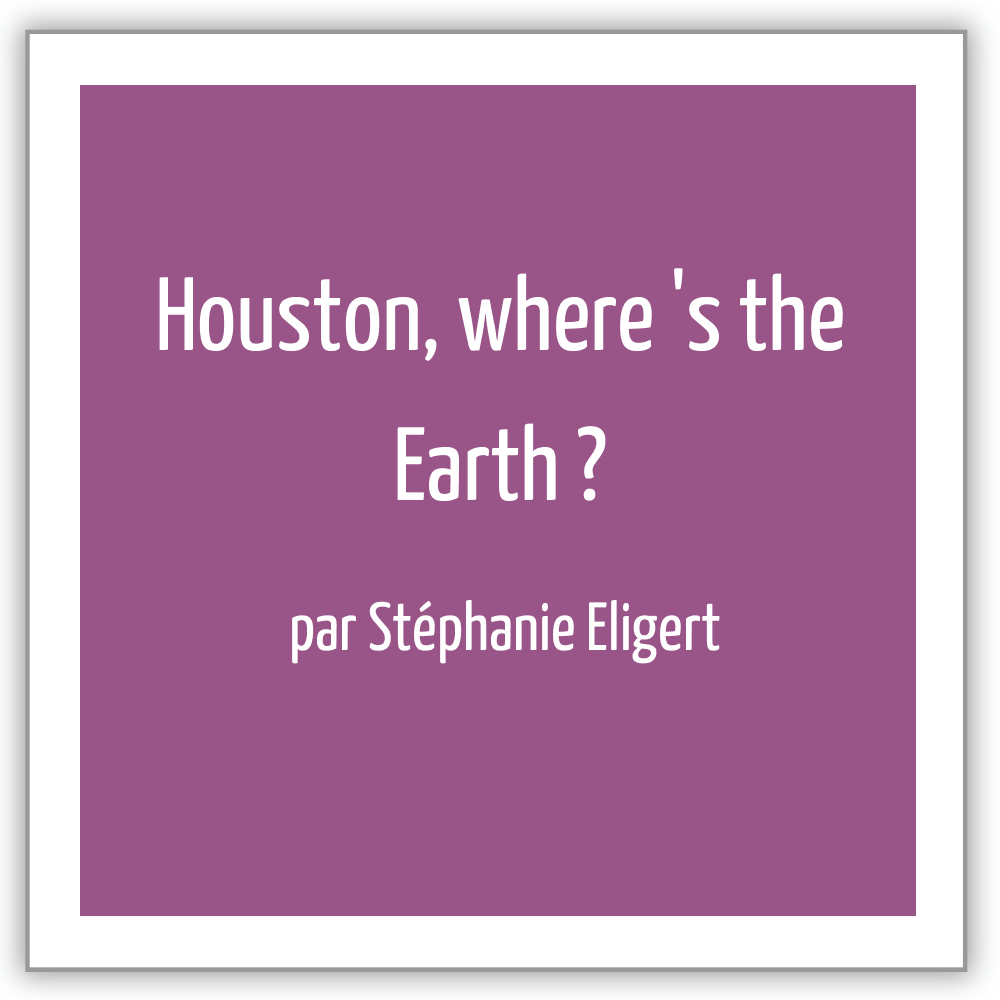Houston, where 's the Earth ? par Stéphanie Eligert
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
Si la littérature – comme le dit Barthes dans cette ultime définition aussi amoureuse que phénoménologique – « embrasse le monde », elle doit maintenant embrasser l’espace. Je me permets de renvoyer à un court texte publié ici en février dernier, au moment où par une coïncidence géniale, la Terre était heurtée, puis frôlée par deux salves de pluies de météorites. A cet instant, on pouvait ressentir une sorte de tremblement épistémique global dans la mesure où soudain, le ciel n’était plus cette « voûte » hermétique, confortablement séparée du reste du système solaire et traversée seulement de façon unilatérale (dans un mouvement glorieux de conquête : fusée sur la Lune, envoi de toutes sortes de sondes, Voyager, l’aimable Curiosity, etc.) ; non, tout d’un coup, on a compris que le ciel n’était rien d’autre qu’une fine enveloppe gazeuse, poreuse et transperçable par toutes sortes de matières venues de l’espace.
D’une certaine façon, ce tremblement, on en a eu les images fondatrices, un peu avant cela, en octobre 2012, avec le saut de Félix Baumgartner depuis la stratosphère . Indépendamment de cette performance (aux accents héroïques critiquables, d’ailleurs), les images de son saut – retransmises par la NASA – produisaient un choc à partir duquel, me semble-t-il, tout rapport immanent à la vie était définitivement altéré, modifié. C’est que pour la première fois, une caméra diffusait des images de la Terre en direct, et l’effet n’en était pas anthropocentrique ; au contraire, en voyant la planète – son atmosphère surtout, d’une beauté déchirante (délicatesse illimitée des masses nuageuses qui, à une dizaine de km d’altitude, semblent une brume générale, plus accentuée ici et là, et finement mouvantes) – on sentait, dans le goutte à goutte d’un plan-séquence, la fragilité totale, radicale de la vie au milieu de l’espace.
Il est certain que Gravity d’Alfonso Cuaron participe de ce tremblement sensible général. Or justement – au lendemain de la vision de ce film, troublée, physiquement remuée (en sortant de la salle, je n’arrivais plus à marcher), mais aussi hantée par ce qui y manque -, se lève la nécessité d’écrire pour lui opposer une déception profonde. Sur un plan cinématographique, il y a déjà des petites choses qui ennuient. A l’inverse de ce qu’on a pu lire dans la presse, le film n’est pas du tout minimaliste (le scénario, au bout d’une heure, devient totalement rocambolesque) ; puis il y a aussi la présence relativement pesante des lunettes 3D dont, à l’exception de quelques séquences où elles démultiplient vraiment la puissance du film (je pense surtout à l’explosion de l’ISS, absolument admirable, dans son architecture, et l’étagement arriéré du démembrement), pour le reste, elles tendent à lui nuire en hystérisant les scènes, en leur insufflant du spectaculaire là où une mise en scène calme aurait suffi à maintenir une intensité maximale et magnifique. Cependant, malgré cela, le film est beau.
Et s’il l’est – au delà de la question du deuil et de la pulsion de mort qui fait incessamment vriller -, c’est pour une raison sensuelle, existentielle. Deux spationautes, donc, interviennent sur Hubble en basse orbite, à 600 km de la Terre, mais ils se prennent de plein fouet les débris de satellites que les Russes viennent d’exploser par un missile. Hubble est en miettes, et ils partent alors en dérive sur la basse orbite terrestre. Et là, dans le temps d’abord calme du film, dans l’accumulation cursive, lente de la perception, l’on sent ce qu’est la basse orbite terrestre ; on comprend son étant ; c’est une sorte d’autoroute noire, profonde et ténue, dans l’épaisseur inconnue de laquelle on flotte, on se renverse, on tourne, on avance avec quelque chose qui est de l’ordre du vol, sans être du vol, etc. Et le dispositif général des plans accentue autant que possible cette sensation de couloir circulaire (qui est, stricto sensu, la définition de la force gravitationnelle) par le fait qu’il y a très peu de panoramiques ou de contre-champs, même rapides, vers l’espace (étonnamment, on ne voit jamais la Lune, ni vraiment le Soleil), et que les trois quarts des plans contiennent la Terre, en amorce plus ou moins imposante. En ce sens, Gravity n’est pas un film sur l’espace, mais plus étroitement, c’est un film sur la gravité – soit plus finement sur cette portion d’espace-temps, cette délicate zone frontière où la Terre influence l’espace, le déforme.
C’est là qu’à mon sens, il y a problème. La Terre - qu’on ne cesse pourtant de voir, et vers laquelle le regard glisse tout le temps (du fait de cette capture gravitationnelle, justement) - telle qu’en elle-même, on ne la sent pas. Sensuellement, elle n’est pas là. Du point de vue de l’économie de la mise en scène, cela s’explique, certes, puisque l’enjeu narratif du film réside dans cet accès impossible à la planète. Mais était-il nécessaire de pousser son imperméabilité jusqu’à la rendre presque non vivante, sans intensité existentielle particulière ? Manifestement, quelque chose manque à la mise en image de la Terre, et cela produit confusément une sorte de perception clivée du cadre : d’un premier plan (la basse orbite, la palpitation mystérieuse de la matière noire) de haute intensité, on glisse vers un second plan (la Terre), de très basse intensité. Mais pourquoi ?
A priori, pourtant, tout de la Terre est là : l’exactitude de son volume, sa couleur bleue. Tout, sauf son atmosphère – et si j’ai commencé ce texte en citant le premier plan du saut de FB, c’est aussi pour montrer que phénoménalement, depuis la stratosphère (et il est certain qu’il en est de même plus haut, à 600 km), la Terre, la singularité de sa surface, c’est l’atmosphère qui la lui donne : enveloppe brumeuse faisant halo bleu, délicatesse infinie du dégradé de cette brume dont le bord extérieur est manifestement de l’ordre du souffle, de la respiration, etc. Or, ici, à l’exception d’un seul plan, court, où l’héroïne, à l’intérieur de la capsule Soyouz, fixe par le hublot un système dépressionnaire (un cyclone, m’a-t-il semblé) – par lequel, en quelques secondes, on sent enfin que la planète vit un peu –, pour le reste, l’atmosphère n’existe pas ; l’on dirait que les nuages sont collés sur le sol, sans matière aérienne qui les porte ; à la limite, ils sont décoratifs, simplement graphiques (un peu comme les dessins d’enfants qui, par un charmant automatisme, ajoutent un cumulus à la maison qu’ils dessinent, en contrepoint d’un oiseau) ; et la seule véritable animation de la Terre, ce sont les lumières nocturnes des villes qui la lui donnent, lorsque l’héroïne dérive à l’opposé du Soleil. Or là même, cela a trop la texture lissée, vitrifiée d’une carte postale
A l’évidence, la texture de la Terre a été négligée dans ce film, et sa représentation réduite aux codes de la « beauté vue de loin ». Sans doute, on peut objecter que tout cela est numérique, et qu’il existe des contraintes techniques, etc. Mais à l’heure où l’ISS, justement, filme et photographie avec une précision illimitée le climat terrestre, une attention minimale aux mouvements de l’atmosphère aurait forcément suscité les bidouillages appropriés. On peut encore objecter qu’attendre du cinéma un effet de réel global, c’est archaïque – peut-être, mais alors, pourquoi la basse orbite dégage-t-elle ce puissant effet de réel, et non la Terre ? Pourquoi cet effet de réel partiel, tronqué ? C’est si dommage.
C’est dommage parce que ce beau film participe au tremblement épistémique général, mais en se tenant sur ses bords, en spectateur, dirait-on, qui ne veut pas se laisser emporter par le sens profond que cela induit : prendre acte formellement, esthétiquement de ce que la Terre est fragile, et que la vie y est un phénomène aussi délicat que sa fine enveloppe climatique. Or à l’exact inverse de cela, le seul postulat de fond du film, c’est cette ultra-évidence, énoncée au début, à savoir que la vie est impossible en dehors de la Terre - mais non de l’atmosphère, qui n’est jamais mentionnée, sinon sous la forme schématique d’un de ses composants, « l’O2 », et aussi, vers la fin, dans une belle phrase que j’ai pu attraper au vol, au milieu d’une scène d’action tonitruante, « caresser l’atmosphère ». Il est difficile de ne pas relier cela à l’indifférence générale des « grandes puissances économiques » - dont Hollywood est une sorte de concentré international– à l’égard du dramatique réchauffement du climat terrestre.
Ce qui est encore plus dommage, c’est que les millions de spectateurs de Gravity ne seront pas amenés à sentir cette fragilité, l’image de la planète restant conforme aux représentations médiatiques et publicitaires qu’on lui connaît : une gigantesque boule émaillée de bancs de nuages schématiques, trônant quasiment au milieu de l’espace grâce à une sorte de souveraineté impassible et massive (ce qui est tout sauf le cas, d’un point de vue astronomique). Je ne dis pas qu’il eut fallu faire un film militant, mais seulement faire davantage vivre la Terre, l’envelopper d’un halo bleu hypersensible, frémissant, mouvant, et dont chaque plan, sur fond de la dérive angoissée de l’héroïne, nous aurait indirectement donné la mesure délicate et puissante de son étant – avec cela, la sensation de la gravité eut été complète, en premier plan comme arrière plan du cadre. Mais bon, ce que le cinéma, pour l’instant, ne fait pas, peut-être que la littérature – parce qu’elle « embrasse le monde » - le fera ?