Un ABC de la barbarie de Jacques-Henri Michot (1) par Stéphanie Eligert
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
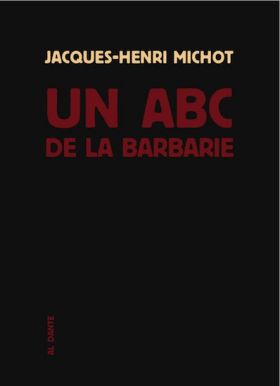
Voici un livre magnifique, nourrissant, indispensable - mais avant d’en commenter quelques extraits en détail, il me semble important de s’arrêter quelques instants sur son titre : « Un ABC de la barbarie ».
Pour ma part, ce titre, il est impossible de l’entendre ou de le lire sans que mon attention s’accroche - toujours quelques secondes de plus par rapport autres mots - sur le « un » qui l’ouvre. Quand on y songe, cet article « un » est relativement étrange puisqu’a priori, son caractère indéfini contredit le principe même d’ABC. On le sait, la particularité d’un ABC est d’être à la limite de l’objet livre (tel que le champ de la littérature le délimite) puisque son texte – un mode d’emploi - est intégralement écrit pour organiser des effets performatifs chez les lecteurs, qui deviennent dès lors des utilisateurs, etc. Cependant, les formes courantes d’ABC – la plupart du temps pensées pour les besoins du marché – en appellent toujours, dans leur titre, à la souveraineté généralisante de l’article défini « le » ; tout ABC, dans les rayonnages d’une librairie, est l’ABC, le seul et le plus « performant » sur le thème choisi, etc.
Le livre de Jacques-Henri Michot est tout aussi pratique, on le verra – mais lui, il est « un » ABC. La nuance est essentielle et va se diffracter dans toute une série de dimensions. Pour le dire vite, en ce qui me concerne (et selon une façon photosensible de lire que j’avais esquissée), ce « un » appelle aussitôt, en position de surimpression, un autre article indéfini, celui du dernier texte écrit par Deleuze : « L’immanence : une vie »*. Que ce soit dans l’article de Deleuze ou le livre de Jacques-Henri Michot, les « un / une » semblent partager ce que Barthes, dans le Neutre, appelait un même « différentiel de prégnance » ; chacun fixe notre attention sur un écart grammatical diffus (le caractère apparemment irrégulier, bizarre de l’usage de l’indéfini), puis, une fois fait, nous met en suspens – voire aux aguets, comme d’abord chez Deleuze, où l’on sent, l’on sait que ce « une » va nécessairement déployer une intensité conceptuelle particulière.
Un : indicateur d’immanence
Précisément, dans cet article, Deleuze paraît moins inventer un nouveau concept que radicaliser l’expression de l’immanence, comme il ne l’a jamais fait – à ma connaissance – jusqu’alors (et de ce point de vue, le texte est splendide car Deleuze y achève, dans une atmosphère indirecte d’urgence, les livres et les cours sur Spinoza). Même si le texte peut être commenté sous une multiplicité d’angles, le pari, ici, est de le penser, et surtout de l’utiliser d’une manière exclusivement littéraire, textuelle. Au reste, son enjeu profond paraît bien être la mise en phrase de l’immanence puisque l’articulation trouve son point de finesse décisif, me semble-t-il, grâce à un type de nuances sémantiques que seule peut créer la face sensible, matérielle de la langue. Il y a d’abord les deux points du titre qui, en passant outre la conjugaison du verbe « être », et ses implications instantanées en termes ontologiques (comme ça aurait été le cas dans « l’immanence est une vie »), ces deux points relèvent de la syntaxe propre au champ transcendantal (syntaxe que Deleuze, plus ou moins ouvertement, cherche à inventer).
Mais surtout - dans la perspective qui lie ce texte au livre de Jacques-Henri Michot -, il y a « une » vie, « un » article défini. S’appuyant sur un récit de Dickens, Deleuze dit brièvement comment une vie traverse tel homme « pauvre, mécréant » d’une vie a-subjective, « d’un pur courant de conscience », etc. Et un peu plus loin, il a alors cette phrase d’une portée très novatrice, me semble-t-il, pour la critique textuelle (et là, je demanderai au lecteur de bien vouloir entendre les mots « indéfini », « indétermination », « détermination » comme s’ils étaient extraits, non d’un texte de philosophie, mais d’un traité de grammairien) :
« L’indéfini comme tel ne marque pas une indétermination empirique, mais une détermination d’immanence ».
Je me souviens d’un instituteur, en primaire, qui, au moment de nous apprendre les différents articles, avait fait une parenthèse solennelle dans sa leçon pour nous expliquer la nécessité de n’employer l’article indéfini « un » que dans certains cas limites, « lorsqu’on ne pouvait pas faire autrement » ; il estimait que le caractère fondamentalement vague, imprécis du « un » ne pouvait qu’affaiblir notre parole, voire la rendre vulgaire, proche de l’argot. Il me semble même qu’il nous en avait interdit l’usage dans nos « compositions ». Au delà des répercussions relativement traumatiques d’une tel mot d’ordre (je me rappelle qu’après cela, j’ai traversé une période de fortes tensions réflexives, m’arrêtant de parler chaque fois que la particule « un » ou « une » me venait aux lèvres, en cherchant vainement à comprendre pour quelles raisons ces quelques lettres étaient si « mauvaises » ), au-delà de ça, l’anecdote articule la triple dimension idéologique qui se joue toujours plus ou moins entre « le » et « un » : d’un point de vue philosophique, la suprématie du « le » signe la victoire – presque au sens guerrier – de la transcendance, de l’Un sur le pluriel, le non hiérarchique. D’un point de vue sociolinguistique, il s’agit toujours de défendre, avec « le », une certaine idée de l’usage de la langue, qui a pour obligation d’être déterminante, définitoire (cf. ce fascisme de la langue violemment dénoncé par Barthes dans sa Leçon inaugurale au Collège de France, en 77). Et d’un point de vue politique, flotte encore ici une évidente configuration policière exigeant de contrôler le rapport entre « les » mots et « les » choses (« déterminer », « identifier », on le sait, forment les verbes cardinaux de tous les process actuels de « sûreté et de sécurité », que ce soit au sein de l’Etat ou dans les sièges sociaux d’entreprises).
Toujours est-il que si l’on entend cette phrase de Deleuze sous un angle exclusivement grammatical, nous assistons en quelque sorte à la naissance d’une nouvelle fonction linguistique : le déterminant d’immanence, comme il existe un complément circonstanciel de manière par exemple. Le « un » - ou « un un » si l’on n’est pas gênés par la diérèse – n’est pas le signe d’un flou, d’une carence supposée préjudiciable dans la mise en phrase du réel, mais tout au contraire, « un » porte cette mise en phrase à son degré maximal de précision. « Les indéfinis d’une vie perdent toute indétermination dans la mesure où ils remplissent un plan d’immanence » dit Deleuze. Textuellement, « un » marque à la surface même d’un texte, la sensation globale, cénesthésique de l’immanence – « un » est un « activateur de netteté » (Barthes, le Neutre) mettant en relief le « c’est ça ! » de tel plan d’immanence ou de tels morceaux d’« une vie ».
Et grâce à cet « indicateur d’immanence », la critique littéraire disposerait enfin d’un outil (peut-être en lieu et place de la fatiguée et impraticable hypotypose) lui permettant de cerner et de nommer dans une phrase la zone par où se colle la vibration « multiple, singulière » d’un plan d’immanence, et d’en articuler ensuite les diverses nuances d’écoulement dans le reste du texte, et ce comme on le ferait avec les normatifs compléments circonstanciels de temps, de lieu, etc. – sauf qu’avec le déterminant d’immanence, il n’y a plus cette séparation artificielle (idéologique aussi, forcément) entre le temps, l’espace, le corps et les moyens.
C’est le texte d’« une vie » même – et d’« une » barbarie - qui peut être charnellement, techniquement saisi.
* Gilles Deleuze, « L’immanence : une vie » in Deux régimes de fous, Editions de Minuit, 2003.