Après l'Union d'Antonio Rodriguez (entretien)
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
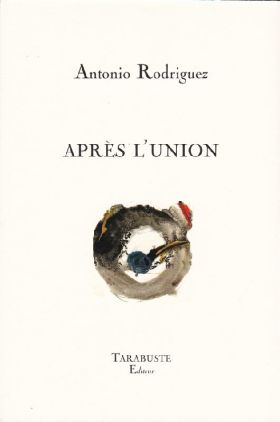
Mathilde Vischer : Depuis « Big bang Europa » (Tarabuste, 2015), bien que ces deux livres présentent bien évidemment quelques différences formelles, votre écriture se caractérise par des fragments ou blocs de prose distincts les uns des autres mais continus, elle se déroule en rythmes longs, faits de reprises, d’échos, dans une langue souvent charnelle et proche du chant. Comment qualifier cette forme ?
Antonio Rodriguez : Cette forme reste étrange et familière pour moi ; le résultat d’un long travail. Elle ne vient pas d’un projet préalable. Elle joue sur le trouble en alliant les contraires : des fragments rapides, saccadés, dans la montée d’un flux lent ; un lexique simple, une ponctuation rudimentaire, dans une syntaxe complexe et rythmée ; une prose qui se révèle avant tout poétique ; l’unité du poème n’est pas délimitée par une clôture. Je travaille longtemps mes poèmes, généralement sur plusieurs mois, par couches, et ils ne tiennent pas à la seule créativité d’un moment. J’aimerais qu’ils soient proches d’une voix singulière (qui ait l’air très personnel tout en se déployant dans l’histoire) : une voix, ici et maintenant, limpide mais après-coup, prise dans les superpositions du temps, la juxtaposition des lieux, les vues entremêlées.
Antoine Emaz écrivait justement que j’essayais de capter quelque chose de notre époque. En apparence, tout va très vite dans nos vies, la conscience passe sans cesse d’une chose à l’autre, mais par-delà les apparences nous sommes dans une grande lenteur, une impossibilité de bouger : entre un effondrement qui semble inexorable et une puissance qui essaie de tenir ou de se redresser. Ma forme poétique s’inscrit dans la rapidité, la fuite en avant, des incises continues, et une ligne de basse qui résiste, persiste, calme. L’humanité redoute son propre anéantissement, ses peurs d’autodestruction. Cet effondrement est bien plus profond qu’une crise économique ; il est dans l’imaginaire de nous-mêmes, terriblement inquiet et mélancolique. Notre temps a besoin de souffle, de formes, de symboles pour y faire face. La poésie convoque.
Le texte poétique reste un objet central aujourd’hui. Nous sommes dans des contradictions, un mélange d’impuissance et de désir absolu, une obsession de la mémoire et une difficulté à envisager l’avenir à long terme, dont l’Europe est le nom. Pour ma part, je n’ai qu’une seule réponse : la poésie ; la poésie collectivement, et la poésie individuellement, comme une forme, du souffle, des images fortes. Je n’ai que cela. Je ne me vois pas faire un essai ou un récit sur l’Europe. Ce serait vain. Pour moi, la poésie, quand elle montre sa nécessité, est l’écriture la plus aboutie dans l’alliance de l’incarnation et de l’intelligence.
M.V. : Cette forme contraste avec vos premiers livres. Qu’est-ce qui, pour vous, a marqué ce changement ?
A.R. : C’était en 2008. J’avais en tête de faire un troisième livre poétique et politique, qui serait Big bang Europa. Mon premier recueil, Saveurs du réel avait été une exploration de la « rupture » amoureuse par cinq formes différentes ; En la demeure, le deuil de la mère par des petites scènes sociales en vers libres. L’imaginaire était là, le corps, la matérialité, l’alliance de la brutalité et de la douceur, tout comme le quotidien ; mais j’empruntais des formes existantes. Lorsque j’ai élaboré le projet sur l’Europe, c’était un moment particulier de ma vie. J’étais dans une situation très précaire, je venais de me marier, nous avions visité Birkenau, c’était la crise économique, et j’avais toujours repoussé l’idée d’avoir des enfants. Le projet de famille m’avait paru assez consternant. Mais là, face au vide, je n’avais plus de doute, j’avais envie de plonger dans le vivant, dans le corps à corps de l’espèce. Je n’avais plus peur de l’autodestruction ni de me perdre. C’était une période très heureuse et contrastée, où la montée du Front national semblait déjà inexorable. Je ne savais pas où j’allais, mais j’avais une énergie poétique résolue dans une Europe qui semblait déboussolée par l’échec de sa constitution en 2005. Or le français m’est apparu comme la langue continentale, faillible par excellence, dans laquelle est venu le premier « non » ; la langue qui, par des gestes refaits des millions fois en mai 2017, porte en profondeur les tentations de l’autodestruction. C’est donc une langue poétique emblématique aujourd’hui, qui se nourrit de tensions, et qui devrait rayonner par-delà l’horizon national. Mais la langue reste empêtrée dans ce « oui/non », dans la peur de l’oubli, dans la perte d’influence, dans l’insupportable écart entre les appels à l’égalité et le sentiment d’être relégué au second plan dans l’indifférence.
Au début de l’automne 2008, je vivais à Angers, et près des quais de la Maine, j’ai assisté à la naissance de mon fils. Voir ce corps sortir du corps d’une femme, dans une maternité publique, au moment où la crise économique montait, au moment où j’entrevoyais le retour des nationalismes, m’a bouleversé. Ce fut un big bang en moi, qui a mobilisé mon énergie dans un projet complet d’écriture poétique. À partir de là, j’ai travaillé sur la forme qui pourrait dire les contrastes perçus ; ma poésie est la vie dont je suis le corps, les yeux, les mots ; héritage d’une généalogie continentale errante.
Je cherche une forme qui dépasse les formes que j’ai pu pratiquer. J’écris après une grande lassitude de la littérature, des postures narcissiques qui cachent mal le manque de puissance, une déception de l’exploration des possibles, un rejet du génie romantique qui, sans le romantisme, devient un génie narcissique — et, en même temps, je ressens une énergie formidablement positive par la poésie : de la mobilisation incarnée et de l’intelligence collective. J’aime notre époque, les gens sensibles que je fréquente. J’aime ces périodes d’extrême intelligence, de progrès fulgurants dans le relativisme, qui précèdent parfois, semble-t-il, les grandes guerres.
Au bout de plusieurs années, j’ai trouvé cette forme, étrange et familière, une prose poétique. Elle offre une incarnation dans la langue d’aujourd’hui. Je n’ai jamais cru trouver « ma propre voix », « mon propre style », ainsi de suite. Sauf que là, je me sens vraiment bien dans cette forme, dans cette incarnation ; je pourrais faire cela toute ma vie, c’est complètement adapté à ce que mon corps porte en puissance. Est-ce un hasard alors si je me sens particulièrement à l’aise pour la lire à haute voix ?
M.V. : « Après l’Union » propose, à plusieurs moments, une réflexion sur l’écriture, écriture de cet « après-le-vingtième siècle » (et de tout ce qu’il a vu comme horreurs) et de cet « après-l’Union », à travers les yeux d’un homme, poète, qui reparcourt certains lieux de l’Histoire du siècle passé et cherche à les dire.
A.R.: Nous entrons surtout dans les temps d’« après le témoignage ». Comment trouver une voix qui ne soit pas la répétition des témoignages (presque sacrés des survivants), ni une exploitation des victimes, de leurs souffrances dans nos fictions ? Reznikoff proposa une aventure poétique fondamentale dans Holocaust (1975), à la mesure du film Shoah de Claude Lanzmann (1985). Mais quelle est notre voix aujourd’hui ? Quelle est notre voix face au XXe siècle, après les témoins ? Il nous faut un « Pitchipoïen » qui touche en profondeur notre époque et ose se détacher sans oublier.
Je me tiens à distance du « devoir de mémoire », qui est un « rite » politique comme un autre, assez creux finalement. Comment ne pas être las des commémorations, des gerbes, de la minute de silence, des mémoriaux, de l’identification victimaire ? Il ne reste qu’à déposer des fleurs et à prendre une mine grave (les larmes ne coulant même plus). Notre époque est plombée par un deuil infini, comme l’a bien montré Camille de Toledo. Elle tente d’oublier par le souvenir ritualisé, à travers le prisme des formes spectaculaires (les films) ou du patrimoine muséal. Il n’y a rien de plus étrange, dans mon souvenir, que ces hordes de touristes, qui arrivent en cars à la caserne d’Auschwitz et finissent, après la « leçon », par manger des saucisses et des frites à la cafétéria du « musée ». Alors qu’à Birkenau il n’y avait personne, rien à voir, et tout était là : herbe, bouleaux, boue, rails, plaine. Tout était là, et je me rendais compte que les historiens ne peuvent parler du sentiment de plaine, de l’herbe, que les romanciers doivent y ajouter des personnages, des péripéties, que les essayistes doivent nous mettre en garde. Comme sortir de cet écueil ? De mon côté, je n’ai vu qu’une issue poétique, celle d’évoquer la relation à la matière des lieux, d’y déployer une poésie extrêmement matérielle et incorporée, qui travaille sur l’imaginaire du continent, mais en reconstruisant précisément le regard, la langue vers un regard « conjoint ».
M.V. Le travail d’écriture passe à travers le prisme de l’inscription de ces lieux au moment intime de la constitution d’une famille.
A.R. Naître en Europe, c’est comme naître dans un cimetière. Ce cimetière hante nos chambres. Il est vrai que d’amener le lecteur dans « ma » chambre peut paraître assez intime, mais c’est le lieu de l’écriture, le lieu où elle prend lieu. J’y vois une manière d’être au plus près des mains, de la voix, comme si je chuchotais des notes à quelqu’un dans cet espace-là. C’est une « Europe de chambre » : chambre d’écriture, chambre de lecture, chambre du couple, où apparaissent aussi les chambres d’extermination. J’aurais tendance à y voir l’ « extime » par excellence, la construction du soi intime par l’extérieur.
Le livre se compose comme une genèse poétique du continent. Nous sommes après la Chute, dans la fission généralisée, expulsés d’un paradis sans dieux et, au fur et à mesure, un « couple » crée le noyau minimal d’une famille, en sachant sur quelles grandes plaies du continent (Verdun, Omaha, Birkenau) ils le font. Vient alors un chant de noces mêlé à un kaddish du continent, litanie pour les enfants qui naîtront malgré tout. C’est l’archéologie poétique et imaginaire du continent, non sans tisser des liens d’ailleurs avec Ecorces de Georges Didi-Huberman, comme me l’a fait remarquer Florence Trocmé.
Dans mon imaginaire, je n’arrive pas à m’empêcher de voir les choses de façon très vive : je suis à côté d’une femme dans un lit, à regarder le plafond blanc de notre chambre, et à revoir, sur ce fond, le noir et les traces laissées par les ongles aux plafonds des salles d’Auschwitz I. De la même manière, je n’arrive pas à célébrer poétiquement une belle chevelure d’Europe sans penser aux montagnes de cheveux des femmes déportées. Il ne s’agit pas de se complaire dans cet imaginaire, mais de l’entrelacer avec celui des temps de paix, de nous donner un souffle nouveau, et de magnifier la chevelure d’aujourd’hui qui est venue après toutes ces chevelures entassées. L’humain, en tant qu’ « espèce aimante », doit y élaborer sa nouvelle forme, son élan « conjoint », qu’il a appelé sur notre continent « Europe ». De même, lorsque je regardais les vagues à Omaha, je repensais simultanément aux jeunes Américains blessés qui se noyaient dans l’eau salée et à l’échographie du fils dans les eaux douces du liquide amniotique. Cela pourrait sembler une profanation des lieux de mémoire ; c’est exactement le contraire : c’est la célébration de la vie avec tous les morts qui nous regardent et nous disent « mais qu’attendez-vous donc pour vivre ? ». C’est la vie à partir du vide originaire du continent, de sa béance, de ce qui a surmonté l’anéantissement ; le vide n’est pas le néant, plutôt le lieu de la recomposition : « matière d’une famille prise dans la matière du continent ».
L’objectif n’est pas de raconter ma vie, ou d’avoir un rapport biographique à ma propre famille. Je tiens plutôt à explorer un imaginaire, à en tirer les nécessités poétiques, une « saga familiale confrontée à l’Histoire » (comme l’a écrit Didier Cahen). Dans Big bang, j’évoquais le couple et ses « petits ». J’avais hésité à brouiller les cartes, mais il me fallait une famille standard : un couple homme-femme, deux « petits » de sexe différent. C’est un « standard », que je trouve porteur poétiquement (pour ses rapports à la « famille nucléaire », mais aussi au couple de la Genèse ou à la tradition de la « Dame » en poésie, incarnation de l’idéal). J’aurais pu partir sur des formes plus innovantes de la famille aujourd’hui ; j’y ai pensé. Mais, dans Après l’Union, je me voyais mal faire de la fiction sur ce point, simplement pour dire « vous savez, je ne parle pas vraiment de moi ». Le degré autobiographique n’est venu que pour mieux ancrer l’imaginaire et l’incarnation de cette poésie. Ce « couple » et cette « famille » de la trilogie sont des figures poétiques, un composite, mais il me plaît que cela puisse créer le trouble avec ma propre existence.
M.V. : Dans l’un des passages en italique qui ponctuent les différentes parties du livre, on peut lire : « à la fin, ce fut de prose, elle vint comme un noyau percuté de douceur, plus intense et intime que mes sensations, elles-mêmes accordées aux lieux, mais reprises et transformées ». Le poème, sous forme de prose, naîtrait ainsi de la confrontation entre le lieu, à la fois dans sa réalité historique, dans sa transformation, et le corps : « On n’efface pas le paysage, on ne tait pas le corps qui a vu » (p. 13). Le poème serait-il ainsi ce qui naît d’un assemblage entre le réel, l’émotion que suscitent les lieux du passé inscrits dans le présent, et un corps-récepteur multiple, qui les transforme par la langue et ainsi transforme la langue ?
A.R. : Le corps se fait le nouveau témoin du lieu, à partir de son ici et maintenant, mais il est pris dans un jaillissement, de tous les corps empêtrés dans la terre, du sable, des troncs, de sa mémoire, des archives, de ses peurs, de son avenir et des corps qu’il produit lui-même. Il n’y a pas de pédagogie, simplement des fibres partout, des ramifications dans la durée. Le corps pousse, amène la nécessité du poème, à se reconnaître dans la matière. Il ne s’agit pas tellement de décrire les lieux, mais de refaire l’imaginaire. L’essentiel n’est donc pas dans ce que « j’ai vu », mais plutôt dans ce qu’il y a encore « à voir ». Face à la brutalité et au silence des lieux, j’envisageais mal une poésie de la complainte, de la douleur. Au contraire, la douceur devait se lier à la douleur, mais en restant dans un geste « percuté », dans le rythme de la douleur contenue, sans oublier. Ces poèmes rejouent les sensations, les émotions vécues ; ils les élèvent à un degré bien plus intense que mon vécu, sans le trahir. Pour moi, ils portent davantage d’incarnation que mon corps vivant.
Par ailleurs, le corps n’est pas seul. Il y a le corps en couple, en relation ; l’homme et la femme ici. Il prend plus d’ampleur ainsi, dans la mesure où ils partagent le regard, où il y a une « attention conjointe » sur l’histoire ou les lieux. Cela se joue entre les personnages, mais aussi entre l’auteur et le lecteur. Dans Big bang Europa, leur regard commun créait une résurgence du sacré dans un musée. Ici, c’est certainement assez proche ; ces lieux ne sont pas de mémoire, ils sont dans le corps, imprègnent les gènes de ceux qui vont « enfanter », c’est-à-dire livrer cette expérience aux prochaines générations sur le continent. Ils doivent savoir, et ils font voir ; d’où le fait que ce lieu renverse le récit de la Genèse : sur la plaine du marécage, de la mort, celle de la Chute moderne, ils refont le couple premier, et rejouent une généalogie européenne possible par-delà la faute.
M.V. : L’articulation entre le poétique et le politique me paraît sourdre de la même jonction entre lieu et corps, comme le dit si bien l’exergue d’Ingeborg Bachmann : « Ce dont il s’agit n’est pas la guerre qui se déroule là où tombent les tirs ou qui pourrait être dépeinte à partir d’une scène de bataille, mais son reflet, qui est bien plus réel : sa pénétration dans la langue de tous, son effet d’après-coup sur la vie. » Le lieu est perçu par un corps qui vient après-coup, qui dira ce que ce paysage dépose en lui, aujourd’hui. Que peut apporter la poésie dans les questionnements politiques du XXIe siècle ?
A.R. : Pour moi, l’Europe n’est pas uniquement un problème politique. L’Union européenne si, mais l’Union n’est pas l’Europe. Ce qui m’intéresse, c’est le désir d’Europe, qui monte périodiquement dans l’imaginaire collectif depuis des siècles, sa nécessité pour la survie des groupes, sa rêverie ou ses menaces, et les divisions violentes du continent, « entre frères ». Je le prends comme un problème de la « matière » : l’espèce humaine étant une des formes de cette matière. Comment faire pour que la matière d’un continent prenne et tienne, pour que des centaines de millions d’individus puissent croître ensemble ? La peur de la guerre ou des extrêmes ne suffit pas ; il nous faut des projets (c’est le travail en politique) et un imaginaire (c’est peut-être un travail pour les poètes, qui cherchent aussi un souffle particulier). Nous pouvons rêver le monde comme un Commonwealth littéraire (sous le terme de « globalisation ») ou, aussi, comme une Europe littéraire. Celle-ci me paraît encore à mettre en valeur (même si elle existe déjà dans les faits). Elle peut se faire par des œuvres poétiques, artistiques, mais aussi par les universités, les institutions du savoir ou de la culture, et par notre grande force pour faire vivre l’espace public (cf. « Mobiliser tous les acteurs du réseau poésie », l’entretien récent de l’auteur avec Florence Trocmé).
M.V : On pourrait aussi retourner la question : le questionnement politique est-il poétique ?
A.R. : On aura compris que je ne suis pas favorable à une poésie engagée. Je ne défends pas du tout l’Union, mais j’essaie de la comprendre comme une étape, pour nos générations, infime pour toutes les générations qui ont rêvé d’une Europe garante de la paix, d’une vie meilleure. Je pense avant tout aux vies ordinaires qui ont été emportées par les grands mouvements de l’Histoire. C’est à partir de là que je veux écrire ; c’est le propre d’une poésie, me semble-t-il. On n’incarne pas des concepts, des idées, encore moins des administrations, mais des corps forcément dans leur langue, leur rythme et leur temps.
La question qui pourrait se poser alors serait de savoir si je fais l’apologie de l’amour ou de la famille, de la vie privée, pour se réfugier hors de l’effondrement de la vie publique. Le contraste entre le continent et la vie du couple n’est qu’un parallèle entre deux échelles : la plus grande (l’Europe) et la plus petite (la famille nucléaire). En voyant la plus grande s’effondrer, la plus petite tente de persister : qu’est-ce qui fait tenir ensemble ? Par quelle énergie ? C’est infime et infini. Ce qui la fait tenir, c’est l’énergie de l’attachement, le souci de la vulnérabilité, la responsabilité, l’empathie, le sentiment d’appartenance au groupe, l’attention conjointe pour survivre. Et là, nous avons le liant humain par excellence. C’est l’espace aimant, le noyau dans le foyer absent, qui tente de tenir face à l’éclatement généralisé, à la « pulsion fission ».
M.V : Dans Après l’Union, les corps sont aussi des lieux, à l’image de celui de la femme. Ce lieu du corps qu’est le ventre de la future mère est tout à la fois lieu de l’organique, de l’intime et de l’universel, et lieu d’une promesse (ou de son illusion), celle d’un monde neuf, inaltéré, même si les êtres issus de ce ventre seront aussi issus de l’Histoire et la porteront : ils « tiendront l’Europe entre leurs mains » (p. 95). En ce sens, l’enfant est aussi le poème, il naît de l’intime, aujourd’hui, mais dans la mémoire de ce vingtième siècle, comme semblent le suggérer ces questionnements de l’homme sur le point de devenir père : « a-t-il vu l’herbe dans ton ventre, celui qui est venu après les noces en Birkenie, (…) a-t-il vu la plaine que tu portais sous la jupe, celui qui ajusta son visage au tien, au mien, pour faire face à l’Europe (…) ? (p. 49)
A.R. : Oui. L’herbe et la plaine sont incorporées dans le ventre, et le visage de l’enfant se prépare à en sortir. L’enfantement me paraît plus important que l’enfant, l’action que le résultat. C’est l’enfantement qui produit le corps-à-corps du vivant. À partir de là, c’est simple : on donne la meilleure énergie répandue au hasard, et on accepte de mourir pour laisser la place. Enfanter, c’est croître en se décentrant de soi, accepter de n’être qu’un instrument de plus dans une extension qui nous dépasse. Personnellement, j’adhère à ce dépassement, sans savoir de quoi il est fait. Cela oblige à peser ce que nous voulons laisser, à concentrer la densité, l’énergie de nos formes, à consolider, tout en acceptant le cycle. Nous trouvons à la fin du livre une genèse inversée : les enfants refont la famille en sculptant la glaise, et ils soufflent dans la matière. Il n’y a pas de paradis, mais des gestes par lesquels ils nous recréent déjà. Tout cela alimente une mise en abyme un peu vertigineuse. Le livre est finalement du corps soufflé entre les mains du lecteur.
M.V. : Je ne crois pas me tromper en disant qu’il est rare qu’un poète parle ainsi de la maternité, à travers le regard de l’homme, du père, mais aussi de l’humain tout simplement, dans sa complexité intime et organique. Cela a-t-il été quelque chose d’évident pour vous ?
A.R. : Heureusement, il est possible pour un homme aujourd’hui d’assister à un accouchement. Il existe beaucoup de poèmes sur la sexualité ou sur les mourants ; très peu sur l’enfantement, notamment vu par un homme. C’est étrange, car c’est la chose la plus époustouflante qu’il m’ait été donné de voir. Je pense que c’est un problème d’imagination, de pudeur mal placée sur ce qu’est le corps, ou même la femme, avec l’euphémisme du « plus beau jour de ma vie ». C’est un euphémisme qui cache l’incroyable intensité du moment ; entre vie et mort, hapax de douleur pour elle et délivrance du groupe qui se recompose à son souffle. Je tenais surtout à être au plus près de l’expérience, tout en la magnifiant ; parce qu’elle est superbe, tout simplement. Plus jeune, j’avais toujours été un peu déçu par un poème de Francis Ponge, « La jeune mère », qui ne parlait pas de la matérialité de l’accouchement, mais du visage un peu fatigué de l’épouse.
Pour moi, c’est le fondement de la trilogie : les splendeurs et les misères du cycle des générations. C’est un vivier d’images et de rythmes pour comprendre l’espèce, ainsi que notre civilisation. Dans Big bang Europa, il y a une scène d’étable dans un musée qui rejoue la naissance chrétienne, mais avec une forte matérialité, faite de cuisses, poils et genoux ; dans la suite intitulée « Nativité lente », parue cette année en revue, il y a encore une longue séquence d’accouchement, qui ouvrira d’ailleurs le troisième tome de la trilogie, à paraître. C’est une réponse à l’accompagnement du mourant dans « Prose papy ». Dans l’un, la porte s’ouvre vers du lien vivant ; dans l’autre, elle se referme.
M.V. : « Big bang Europa » nous plaçait après la catastrophe, dans l’incertitude d’un monde en ruine d’où fuyait la famille ; Après l’Union nous fait remonter en amont, au moment de la constitution de la famille, d’un bonheur célébré sur des lieux dont la mémoire garde l’odeur de la chair brûlée. Où nous mènera le troisième volet de cette trilogie ?
A.R. : Dans le futur, forcément. Big bang Europa était centré sur le présent de l’écriture ; Après l’Union revient dans le passé. Le troisième volume permettra d’aller au bout du projet.