Étienne Faure, Et puis prendre l'air (2) par Jean-François Puff
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
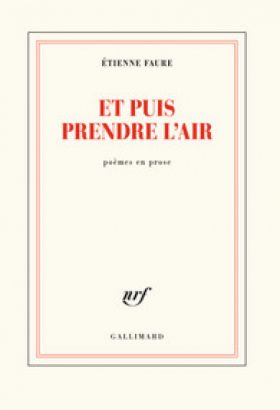
Le récent livre d’Étienne Faure, Et puis prendre l’air, porte en première de couverture l’indication générique : « poèmes en prose ». Cela surprend : « poèmes en prose » renvoie à un genre précis, à référer à une époque de l’histoire de la poésie – né au XIXe siècle, pleinement instauré dans le premier XXe siècle. Je ne vois guère que Christophe Hanna, dans ses Petits poèmes en prose de 1998, à avoir repris l’appellation générique : mais il s’agissait d’un titre, d’une référence spécifiquement à Baudelaire, et d’une pratique entièrement différente. La distance historique que je viens d’indiquer n’est pas de pure forme : c’est le ton du livre d’Étienne Faure et un aspect central de la poétique de son auteur qui sont ainsi impliqués, me semble-t-il.
Car ces poèmes sont véritablement des poèmes en prose, au sens historique du terme, dans lequel différents types de prose sont repris et travaillés par le langage poétique : la chronique, le portrait, la méditation, la note de voyage sont ainsi des modèles d’écriture sous-jacents. La mise en page, qui n’isole pas le poème mais le présente en séquences, tend à renforcer ce caractère de notation : il s’agit pourtant bien de poèmes en prose, isolables comme tels, malgré la relative brièveté de certains d’entre eux. Ces textes partagent avec la poésie en vers d’Etienne Faure un trait de style : il faut que ça tienne, du début à la fin, qu’il se constitue une unité de sens et de forme, que manifeste dans les deux cas tout un art de la chute.
Le recueil se structure en dix sections, et l’on retrouve le poète dans la qualité d’attention qu’il porte au proche, êtres et choses, dans une poétique de la flânerie, mais aussi au lointain, car le voyage est présent. Cependant, plus que l’espace, c’est le temps qui est la matière première de cette poésie. Il n’y a rien là que de banal, dira-t-on : c’est qu’il faut préciser. Baudelaire cherchait à saisir une qualité particulière du présent, propre à chaque époque ; ce n’est pas qu’Étienne Faure la refuse, mais sa quête est autre : ce sont plutôt des rémanences du passé dans le présent, des bulles de durée dans le temps, des formes touchantes d’anachronisme qui l’attirent au premier chef et provoquent l’écriture. La poésie retient ce qui est passé ou mieux encore le tout juste passé, qui se trouve encore là, provisoirement, et que volontiers on néglige. Sa temporalité est complexe : le thème du « décalage horaire », qui intervient dans le recueil, a valeur de figure.
C’est ainsi que le panta rhéi urbain trouve à se tempérer dans l’usage des bancs, qui offrent une provisoire possibilité de station. La section consacrée à ces objets publics donne un bon exemple de l’art du poète. Car le banc est véritablement une scène, sur laquelle se jouent nombre de saynètes quotidiennes où figurent tous genres de gens. Esthétique du croquis : il faut saisir, en quelques traits, le mouvement, le sens, l’esprit d’une situation. Ainsi de ces enfants aidant un chat à redescendre d’un arbre :
[…] The cat, ici, serait plutôt un cas parmi les taillis taillés où les enfants se sont ameutés. Taïaut ! Perchés sur le banc ils l’attrapent et le redescendent par la peau du cou, sous la rumeur des oiseaux. Arrière-petit-fils d’un chat de gouttière, il s’accroche, vertige, puis détale, de nouveau chatoyant. Minou, minou !
Autres lieux de station provisoire, ce sont les hôtels, fréquentés au cours des voyages, lieux de réflexion solitaire, dans lesquels on s’absorbe un temps : « des murs, en faire partie, faire partie des murs, être aussi meuble que la chaise ou la lampe qui me voient d’un bon œil – miroir – puis ne me voient plus, tellement je suis fondu dedans ». Ce sont plutôt les petits hôtels de province qui sont objets de poésie, et la remarque suivante a valeur emblématique : « L’Hôtel Moderne est souvent ancien. » Le goût des choses discrètement désuètes, que j’évoquais plus haut, s’y concentre ; de la même manière dans : « Comestibles : aux vieilles enseignes vaguement épargnées par le temps, on pouvait lire de tels mots pour annoncer la chair mangeable et un peu recherchée » ; ou encore : « basané se disait naguère, vocabulaire passé dans les livres jaunis ». Ces choses ne vont pas sans les mots qui les disent, et c’est une qualité toute particulière de la poésie d’Étienne Faure que de les saisir et de les conserver pour nous, nous permettant d’en goûter la saveur.
[…] Les enfants, eux, avaient droit aux bonbons fourrés à la menthe, au cassis, à la mandarine, au café, à tout et n’importe quoi de la grand-tante. Elle conservait dans une soupière de vieux bombecs collés à leurs papiers, impossibles à arracher, et qu’il fallait sucer comme ça, calés entre langue et palais. Avec leurs peaux recrachées après.
« Bombecs », « cloper », « pioncer », « illico », « rédacs », « clopin-clopant », entre autres vocables ; « toi qui as de bons yeux… tu seras mignonne de m’apporter… tant que tu es debout… » entre autres expressions, dans le recueil : on peut faire poésie de ces mots surannés, charmants, qui furent les nôtres et donc qui furent nos vies, et qui passent. Quant aux « mots liftés » de l’air du temps, il leur en faudra peut-être un peu pour livrer leur saveur, si ce n’est dans une perspective satirique. Il serait facile dès lors de taxer cette poésie elle-même de désuétude, considérant qu’elle se détourne des questions brûlantes qui doivent nous occuper, et de la langue littéraire contemporaine. Elle fait un pas de côté, elle sait nous arrêter, à contempler par exemple ce tas de choses anciennes, cave vidée sur un trottoir :
[…] des guéridons et des sellettes, des cache-pots, des passe-plats, des tabourets, des escabeaux sans marches, des abat-jour et des squelette de chaises, des ciels de lit, des paravents crevés, des rideaux en nylon, en cretonne, en organdi. Tout cela promis à l’asphalte où les pas maintenant se hâtent – ok ça marche –, en quête d’avenir.
Ce n’est pas seulement que la poésie d’Étienne Faure nous rappelle que ce que nous aimons et à quoi nous tenons si fort à présent deviendra ce bric-à-brac promis à la décharge : c’est aussi qu’elle nous laisse soupçonner ce dont elle se détourne. C’est-à-dire les signes dans le présent d’un avenir fort incertain, dans lequel nous avons de plus en plus de mal à nous projeter avec quelque confiance. Mais d’une part, elle nous rappelle qu’il y a tant de choses à voir et à éprouver, tant de choses diverses et de points de vue divers sur le monde ; et d’autre part, il y subsiste un espoir d’émancipation véritable. Il faut simplement y prêter attention :
L’année dernière il était au cimetière, ce petit œillet trouvé dans les poubelles près du mur des Fédérés, qui tient tête et relève le défi de vivre. C’est désormais une tripotée de ressuscités qui occupent la croisée : rien que des bras cassés, issus de pots en terre et en plastique, des dépotés ressurgis d’entre les morts. Et qui fleurissent post mortem la fenêtre dans un devoir de mémoire, dirait-on.