L'œil bande d'Emmanuel Laugier par Alain Mascarou
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
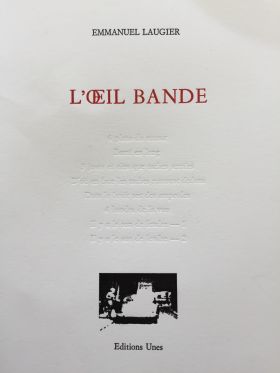
On envisage parfois l’apparition d’une œuvre comme s’inscrivant dans un horizon d’attente. Il arrive aussi que rétrospectivement les circonstances nouvelles la lestent d’un poids imprévu, et que les textes les plus abstraits nous paraissent alors d’une précision chirurgicale.
L’Œil bande : le titre a valeur doublement programmatique. Il exprime le rapport de l’image et du désir, de la vision et de la transgression. Il joue également sur l’ambivalence grammaticale : si l’on prend « bande » non plus comme verbe mais comme substantif, il souligne du poème sa nature de signifiant plastique, de déploiement dans l’espace. En fait, les deux acceptions sont liées : le dévoilement de la représentation est de l’ordre du désir. Il en va de L’Œil bande comme de La Mariée mise à nu par ses célibataires, même : mettre l’accent non sur le réel mais sur le processus de sa figuration, c’est désigner ce qui est en jeu dans celle-là, c’est-à-dire l’écart irréductible entre la pulsion scopique, qui déborde toute représentation, et la nécessité de cette dernière — au prix cependant de sa mise à nu. Notre hypothèse de lecture, c’est que ce premier recueil d’Emmanuel Laugier, écrit entre 1991 et 1995, inspiré de ses premières impressions d’exil à Paris, publié en 1996, et dont voici la réédition « revue et augmentée », s’inscrit dans la mouvance de la réflexion sur la figure et le figural * défini comme « expression d’une réalité en excès, en débordement sur l’ordre discursif et intelligible ». Mais il se trouve que dans l’intervalle de ces années, ce qui pouvait ne paraître que débat esthétique a pris une tournure politique. Ce qui était « chose vue », un sac de couchage gisant dans un coin de rue du Nord-Est parisien, a aujourd’hui une force d’interpellation à laquelle la poésie se doit de répondre, avec ses moyens.
La bande est soumise à la tension entre d’une part l’ « ici », le « ralenti » de l’écriture, le « plan » des pages, l’ « histoire » que la linéarité de l’écriture et la succession des plans mettent en forme, et d’autre part la béance qu’elles désignent — qui les devance, leur échappe en amont et en aval, les transperce, les troue de part en part. De cette zone interdite témoigne l’étrangeté du temps dominant, le présent : présent de narration, si l’on veut, mais en même temps présent hallucinatoire, tant sont rémanentes les impressions traumatiques et tant elles résistent à leur fixation, au point que leur répétition en différé semble exercer un effet hypnotique sur le lecteur. Or celui-ci est impliqué, il a moins l’impression de lire une œuvre que de collaborer à la reconstitution d’un Brouillon général, pour reprendre le titre de Novalis. C’est que la lecture se heurte constamment à de l’obstruction, alors même que titre et sous-titres proposent un code de déchiffrage, en empruntant au langage des arts visuels, peinture ou cinéma. Encore ces modes d’emploi insistent-ils sur la dé-figuration, « taches serrées » ou « plans de retour ». Il en va comme si le recours à d’autres pratiques de représentation, loin de forger une quelconque correspondance des arts, renforçait l’effet de la disruption du discours.
Mais cela passe d’abord par le traitement du verbe comme matière, tantôt fluidifiée, tantôt empâtée. Écrit « au plus ras », le poème de « la mémoire en plan ras et simple » utilise les mots, les segments d’énoncés, à l’égal de choses, plus attentif à leur qualité de matériau visuel, sonore, qu’à leur sens. Le plus souvent, il s’agit de phrases minimales, voire nominales, d’énoncés tronqués, intercalés, erratiques, elliptiques. Ils postulent une référence triple : l’espace urbain, la langue, l’œil qui retranscrit. Le vers, la rue, la vue, sont identiquement étranglés, retournés, distendus, — bandés, au sens d’étirés et de bloqués. Ainsi se crée un espace d’exil, par la langue, comme si le narrateur-spectateur butait sur le français et sa prosodie comme sur une langue étrangère, recourait à des traits de cette littérature mineure que décrivent Deleuze et Guattari à partir de Kafka. L’un des exemples les plus frappants, c’est le traitement des mots-outils, coordinations ou prépositions laissées en suspens, mais qui du coup sont affectées d’une surpoids sémantique, révèlent une épaisseur, une résonance, insoupçonnées : « dans, dedans, vers… ». Ces restrictions, ces empêchements, limitent aussi le lexique, et altèrent le rythme. La page espace, découpe, interrompt. Elle astreint la forme-vers à un minimalisme implosif. Le resserrement sur quelques objets (l’ampoule, le phare des voitures, une nuque), qui semble accentuer l’arbitraire de la représentation, va en faire éclater le cadre.
Cela, comme si le langage visuel était particulièrement apte à inventer l’écriture capable de faire sauter les digues devant ce qui surgit du réel. Les signes typographiques, à l’égal de chiffres ou de lettres, opèrent sur la page tels des inserts, des impacts, qui même s’ils ne contredisent pas le sens contrarient la lecture : « couper/séparer/écarter ». Le déchiffrement linéaire est interrompu par le signe, qui non seulement fait image, mais impose le paradigme de la vue comme mode privilégié d’apparition, dans la mesure où il stimule ce que le sens commun entrave et réprouve. D’où des enchevêtrements, césures, nœuds de sens, qui sont autant de manifestations de la pulsion réprimée.
Avec L’Œil bande la poésie descriptive devient à son tour sport de combat. Ramené à des signes plastiques (« barre, bâtonnet, cercle »…), formes simples et couleurs primaires, à quelques sensations ou affects (la faim, la solitude de Tous ceux qui tombent, l’abandon), à trois ou quatre pronoms pour désigner des personnes (lui, elle, « un qui », « quelqu’un ») le lexique tire de cette pauvreté une force insolite, une rage, une énergie rebelle. C’est qu’il s’en prend au vocabulaire, le dépouille, le décape ; il fait jaillir des éclats des termes les plus ternes. Ainsi, l’emploi rapproché de vocables et de formes verbales de même famille lexicale (« bouche, bande, sangle, coupe, claque, barre… »), grippe le sens, opacifie le discours, pour accentuer l’effet visuel, mais aussi sonore, au détriment de la fonction mimétique, comme le ferait la pression exercée par le peintre sur le tube, dont la giclée vient veiner la surface en suivant son propre élan. De la contrainte exercée sur le signe, quelle meilleure illustration que le traitement d’une lettre, le « v », qui intervient en tant que signifiant et signifié, tant au niveau plastique qu’au niveau iconique. En tant que forme, c’est une encoche, un angle rentrant, il évoque la pointe, l’écartement ; en tant que sens, c’est une lettre tracée, qui renvoie à l’ « ici » de l’écriture, mais évoque par son dessin la vulve aussi bien que le lieu-dit parisien La Fourche ; dévoilant à la fois l’espace du désir et le lieu hostile, le « v » « s’ouvre à l’angle des fourches ». Comment ne pas voir, dans cet enfoncement, cet élargissement, l’affirmation d’une résistance à l’espace coercitif, d’une délivrance, voire d’une jouissance, le dépassement de rapports conflictuels par la neutralité, l’arbitraire du signe ? Comme si le poème rendait réversible le rapport de force, grâce à la tension maintenue, la contradiction insoluble entre figuration et défiguration. Le kit de survie qu’offre un matériau verbal si fruste accentue l’effet réaliste (et on pense aux bœufs écorchés de Bacon ou de Rembrandt), alors que sa répétitivité ébranle, sans l’annuler, l’assise du couple signifié/signifiant. Il y a donc un rapport fluctuant, déroutant, où la lettre s’affranchit de l’esprit, un espace de dissémination en « lignes et zones, traits et taches a-signifiants et non-représentatifs », ainsi que Deleuze désigne certains phénomènes de la peinture de Bacon. On peut combiner des séquences, repérer des constantes comme la chute d’un corps dans le vide et y retrouver la décomposition du mouvement d’une chronophotographie. On peut mettre en série des flashs fugitifs qu’une sténo visuelle peut fixer, des collapsus à répétition. Mais jamais la lecture ne peut se stabiliser, s’en tenir à une interprétation sans envisager un « ou bien ». La lutte qu’engage le poème il la retourne contre lui-même, contre sa propre intégrité. Le texte est par endroit migraineux, vacillant entre étoilements de la vue et instants de clarté. S’il y a rapport entre sensations, c’est non dans le sens d’une synesthésie, mais toujours vers l’effet inverse, le déchirement de soi et du tissu du monde.
Le « je » de ce récit en faux semblant, loin de se retourner seulement sur l’expérience de la ville comme locus horribilis, est engagé dans un second retournement, où la sensation du moi ne se sépare pas du devoir de faire corps avec le milieu, si mutilant soit-il. Le poète ne trouve sa voix, le lieu de sa profération, que dans la capture de l’excès de sa perception, qu’elle soit cinétique ou sensorielle, dans la fixation de ces paysages traversés, traversants, imprimés dans sa rétine et qu’en creux il imprime sur la page. L’œil intervient en tant qu’organe passif et actif, incarné, sexué ; il est blessure charnelle, résilience, mémoire, corps et âme. À l’interface du poème et du monde, dont il est part entière, il ne renvoie pas un reflet, le double d’un modèle. Le plan de la page intersecte avec le plan de la vue, il ne s’y borne pas, pas plus qu’il ne la borne. L’œil rend manifeste ce qui échappe à la vue, et à la conscience, ce qui guette dans leurs marges, l’infra-sensoriel, l’infra-psychique, la profondeur qui « aspire » et qui « envahit », cette bouche d’ombre qui engloutit tout discours. L’œil désirant est dans le battement obstiné entre projection et introjection, l’interrogation inflexible sur cette lésion qui le constitue et qu’il opère, dans le corps du monde et du poème :
comme des phrases
mais qui tournent qui ne terminent pas mais
recommencent
se bandent
dans
Vingt ans après sa première parution, L’Œil bande d’Emmanuel Laugier confirme la capacité de la poésie à répondre à ce défi de plus en plus pressant : panser le lien de l’homme et de la Cité.
* J'emprunte la définition qui suit à l'excellente mise en perspective d'Olivier Schefer, " Qu'est-ce que le figural ? ", Critique n°630, nov. 1999, p. 912-925.