La Vie rêvée d'Antonia Pozzi par Géraldine Geay
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
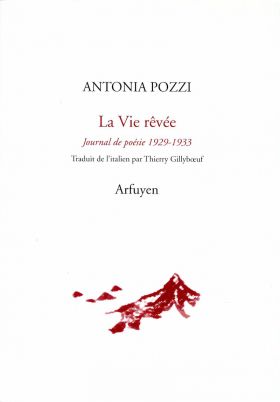
Visage pâle et poésie des sous-bois.
On entre à pas de loup dans La Vie rêvée - parce que c’est ainsi que l’édition d’Arfuyen veut nous y faire entrer. En introduction et en quatrième de couverture, en toute fin de livre aussi : partout Antonia la fausse pauvre devenue la pauvre Antonia. Thierry Gillyboeuf, traducteur de cette première partie du journal poétique d’Antonia Pozzi, ouvre cette édition, non par de l’admiration pour le travail de la poétesse, mais par une tendresse un peu trop personnelle. On croirait voir surgir un personnage des Olympiques de Montherlant : « Dans la matinée du 2 décembre 1938, une jeune fille grande et sportive, pas vraiment belle, mais dotée d’un charme vague et fragile… ». C’est le début du récit de son suicide. Ce suicide censé rendre le lecteur plus attentif, plus indulgent alors que la question ne se posait pas, ce suicide devenu le meilleur appât des réhabilitations. Thierry Gillyboeuf en fait son accroche en renversant la chronologie, plongeant dans les sous-bois (si chers à la poétesse) d’autres éléments de vie non moins violents mais plus vagues (des morts, des fuites, des amours malheureuses). Et, bien sûr, il nous présente Antonia Pozzi d’abord par son apparence physique. Le suicide et le physique, avant le chemin : toute cette approche, se voulant délicate, s’acidifie. Notre lecture risque de s’en trouver encombrée – ou de fuir, impatiente de rencontrer en tête-à-tête le corps du texte. Impatiente de découvrir qu’il ne se résume ni à une image de frustration féminine, ni à une vision de la Mort comme une reine.
Et pourtant, cette « Vie rêvée » est aussi malade que son introduction. Antonia Pozzi, qui a le don de la concision, qui sait faire acéré et jaillissant, réserve toute sa poésie à quelques pensées tristes, ce qui les muscle assez monstrueusement pendant que la Pensée et l’Invention s’atrophient. Si l’on peut être scandalisé que l’introduction commence par la décrire, on l’est bien plus encore de la difficulté voire de l’impossibilité pour Antonia Pozzi de s’arracher à la description littérale de son décor. Elle rend au monde, en somme, le regard de mépris physique qu’elle en reçoit. Le réduit, comme on la réduit, aux apparences physiques. Elle s’imagine en train de s’éventrer si l’enfant qu’elle portait n’était pas conforme à l’image qu’elle s’en est faite. Elle invente ? Elle n’invente qu’un diktat. Antonia est croyante, cela se sent, mais bizarrement la poétesse qu’elle est n’infiltre pas les images religieuses, se contente de les coller vaguement et rationnellement au paysage qui l’entoure. Beaucoup de montagnes, beaucoup de lacs, d’arbres, de fleurs (en bouquet ou seules et sauvages), d’oiseaux – beaucoup de cloches : Antonia Pozzi capte, mais émet a minima. Comme si tout était déjà juste, toutes les images possibles acquises sous ses yeux, et qu’elle n’avait qu’à en témoigner. C’est là que sa naïveté pose problème : même les synesthésies ne prennent pas. Dans Odeur de foin, l’odeur « a le poids d’une aile / qui vient de trop loin » et retombe « comme le souffle ». La correspondance avec le « cliquetis enroué de ce grillon » est impossible – Pozzi repasse par un sentiment interne auquel elle compare ce « cliquetis ». Les sens communiquent très peu. La rencontre avec le monde ne se produit pas. Les cloches ne signalent qu’elles-mêmes au lieu de jamais déranger la contemplation de la pauvre Antonia. Elle « voudrai[t] être un radis », est obsédée par son enterrement, les pierres, l’herbe et l'humus, mais sa poésie coince quand il s’agit d’ouvrir les images, de leur inventer une vie. « Dans les montagnes il y avait / la guerre », écrit-elle en quasi ritournelle dans La tuilerie : Pozzi, qui faisait de l’escalade, reste dans les sous-bois sans y développer une quelconque résistance, une quelconque force poétique. Lorsqu’elle est traversée par un sursaut de vitalité, cela donne des poèmes géniaux : Partie de campagne, La porte qui se ferme, Pensée de malade... Son écriture y fait brusquement muter le chagrin, rend au désespoir la possibilité d’un muscle. Mais les proportions sont insuffisantes pour la sortir du trou. Pour paraphraser Roland Barthes, son exclusion ne consiste pas à être placée à l’extérieur mais au milieu, dans un trou. Antonia Pozzi est trop cernée pour s’échapper, le poète trop au milieu du monde pour que son avenir soit dans un recul (vers l’extérieur, vers le sol ou vers le haut). Le fond des poèmes d’Antonia Pozzi devient rapidement l'humus sous lequel elle répète vouloir dormir – dans un sous-bois où tout est limité par le manque de soleil. La note biographique nous la dit alpiniste, mais ses poèmes nous décrivent chaque nuage d’Italie comme un ciel de Turner. Tout est couvert et bas. Les cloches renverraient par anticipation aux films de Pasolini si tout ne semblait pas, chez la poétesse italienne, plus humide encore que chez Keats. Il y a défaut d’invention, de révélation : sa poésie semble entêtée d’Allemagne et d’Angleterre comme autant de stagnantes fertilités. Des fertilités « rêvées », à peine rêvées, c’est-à-dire ni complètement absentes ni inventées, éventuellement inaccomplies mais surtout (et c’est le vrai problème poétique) non vues. Antonia Pozzi n’est pas une voyante. Dans Prière elle écrit « Seigneur, pour toutes mes larmes / redonne-moi une seule goutte de Toi / que je revive. » La rareté des (très) grands poèmes de cette Vie rêvée prouve qu’elle a subi leur grandeur comme des accès. Mais paradoxalement cela construit, page après page, une sorte de récit en poèmes, comme on dit « roman épistolaire », une passionnante rétrospective de ce qu’elle écrivit. Un recueil de poèmes inégal, mais un beau quoique effroyable journal. On y aperçoit en même temps toute la netteté de l’écriture qui aurait coulé aussi éternellement en elle sans son suicide, et l’ironie de ce don qui lui a fait croire que tout était, comme la qualité de son écriture, déjà joué. Tout s’est aggloméré en une difficulté face à laquelle elle s’est terrée.
Ce journal poétique est donc une enquête indispensable, reliant la qualité globale d’une œuvre et la détermination qu’y met le poète, et rappelant que n’importe où peuvent se cacher de très beaux poèmes. Mais cette enquête est aussi délicate, car elle risque à tout moment de relier l’intensité de la création poétique à l’intensité (voire aux preuves) des souffrances rencontrées par le poète. Or, pour que la poésie soit bonne, il ne suffit pas de ne pas être jolie, et il ne suffit pas non plus de ne pas passer l’hiver. L’écriture demande de passer, de passer la crise du témoin : « Ô vie, / pourquoi / mon sommeil / sans espoir / ne te pèse-t-il pas ? », écrit Pozzi dans Sommeil. Se cacher dans les sous-bois, garder le regard sur des lacs nettement clos et locaux n’est pas en soi une faiblesse : « Regarde : le ciel, dans l’eau, est moins vaste, / mais plus doux, plus radieux. » (Lac calme). Pozzi tient là une idée de poésie, un considérable et très moderne nœud de sens, dans lequel il y a par exemple l’écho de l’essor du cinéma. Mais elle ne se concentre pas, elle est distraite par elle-même et son « sommeil », par l’indifférence du monde à son égard. « Il aurait suffi qu’elle fût jolie », dit cruellement Montherlant, dans l’une de ses lettres, à propos d’une de ses admiratrices. Antonia Pozzi, dans son trou, n’a pas assez vu, rêvé fort et pensé pour passer ce mal-amour.