D’un pas déviant, Pierre-Yves Soucy par Philippe Blanchon
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
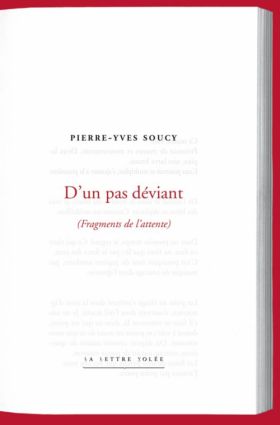
Une allitération en ouverture : attente / attention, depuis le sous-titre jusqu’à l’incipit. Redoublement de l’ouverture sollicitée – autant dire immédiatement qu’elle est placée sous le signe de la tension, d’une tension supposée – pour une disposition à la pensée, car, sans cela, pas de parole et moins encore de parole poétique.
Pierre-Yves Soucy revendique cette double-détente (attente et attention tendues par la contradiction) en ses fragmentations, discontinuités, ruptures et déviations… On ne s’étonnera pas, dès lors, que cette recherche – « disposition ingouvernable » – se fasse dans le plus grand secret, à l’écart, par l’écart. Ainsi, les éclairs suspendus de l’immanent – dialectisés par la nuit et la ténèbre – attendent leurs yeux autant que leurs oreilles. D’où naît la parole et vers où elle se dirige.
Le poète écrit « l’œil tient tête », et il faut entendre que cet œil accompagne la main qui creuse et qu’il a été aveuglé, simultanément, par la solitude, par son écart. Sa vue est d’un autre ordre en devenant parole : elle est comme antérieure, l’écriture ne pouvant avancer que dans la nuit – nourrie de la veille, de ses fictions et de ses ruses.
Redoublée aussi en sera son « alerte » car la veille a connu les humiliations et une brisure. L’œil peut être alors dévasté autant que causer la dévastation dans cette ouverture qui condamnerait à une coupure – de l’œil et du monde par le même mouvement – pour la seule vue possible. Partant d’une chute, d’une détresse, d’un naufrage, d’un dénuement, d’une patience par trop éprouvée – et parfois aveugle – il y a une opération violente, de « dépeçages » à l’œuvre. La mise à nu de l’œil pour la mise à nu de l’homme dans le monde, deux violences qui se répondent, se confondent et se confrontent. Ainsi du navire qui chavire, du vertige – qu’œil et oreilles provoquent – de ces naufrages connus de tous qui sont échecs dont la brûlure seule invite à un (re)commencement. Tant que ça bat, dans la poitrine et dans l’œil, ça n’en finit pas.
C’est le grand désordre de la poésie face aux « fraudes », aux « inutiles prophéties » ou aux « promesses intenables ». La seule station possible ? Dans un intervalle. Intervalle d’attente et d’attention qui fait les exilés et les nomades. Intervalle qui condamne au non-advenu, à l’inachevé ; intervalle de désordre et de violence contre le désordre et la violence des rites qui aliènent – enchaînent. D’où ce désordre ? Il est « sorti de l’enfance » et donc imaginez le déchaînement d’une candeur… Déchaînement d’une candeur d’une étrange espèce car elle connaît ses refus et les ruses du langage qui pourraient la contraindre au mutisme. La parole ne peut plus être qu’insurrectionnelle, sans même le savoir possiblement, ne sachant, ne découvrant qu’en s’énonçant son refus du silence plus contraignant encore.
Dans la contradiction à laquelle on ne saurait échapper la question est donc la suivante : quelle contrainte est la plus forte ? Le poème y répond de fait, tout en demeurant dans la contradiction ; il n’indique que la force dominante qui va pousser tous les sens à se placer à la vigie attentive. Sensible à l’imminence, imminence de toute parole comme de toute manifestation de l’existence. Depuis cette imminence, ce temps ramassant tout les temps par l’alerte, l’immanent contraint à l’infini, car ainsi que l’écrit Soucy : « la fin dévore ses proies » étant entendu que la violence du poème est inverse à toute prédation.
Si l’aigle attaque en ligne droite, c’est la déviation qui va s’imposer à toute trajectoire poétique : souffle, verbe, depuis la main et l’œil condamnés à la parole, comme nous sommes condamnés à la liberté. Le vol du poète boite, il est un pas voilà tout. Ce pas est « le langage intime de la marche », marche sans laquelle rien ne s’appréhende dans l’insaisissable de l’infinie mobilité de tout, il est déviant pour cette raison même, déviant et handicapé ainsi que l’entendait Musil. Raison même de la conscience de sa contradiction et de la simultanéité des contraires. Ainsi, la nuit / la ténèbre ; et le givre et la neige aussi blancs que noirs dans le poème de Soucy – comme ils le seraient dans un poème de Zanzotto.
La poésie de Soucy, de livre en livre, signe un effacement majeur, effacement du poète qui s’est su un élément du paysage qu’il a eu sous les yeux, de chacune des aspérités des océans, et qui s’est retrouvé embarqué sur un esquif fragile. Plus encore, qui accepte cet inconfort dénonçant la « lâcheté des refuges ». Ainsi effacé, par le blanc par le noir, il peut signer de son propre nom l’acceptation de sa propre disparition, et, paradoxalement, précisément au nom même de sa singularité, de son étrangeté.