Les Loups de Sophie Loizeau par Aurélie Foglia
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
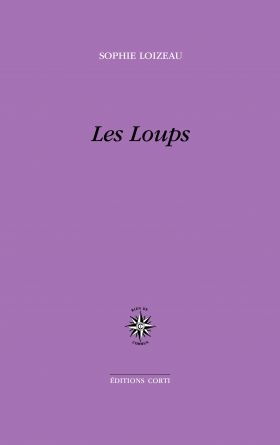
La poésie est un loup pour la langue
Quels sont les territoires de la poésie ? Le monde ? Le moi ? La mémoire ? Tout cela sans aucun doute, et au-delà. Le dehors est un dedans, et réciproquement. Sophie Loizeau s’aventure vers ces zones d’ombres qui appartiennent à la fois à l’espace réel et aux fantômes qu’on porte en soi, à la psychanalyse, à l’Amérique des Indiens et à la maison familiale, après La Chambre sous le saule (PUR, 2017). Elle aussi se construit des « cabanes », en écho à Jean-Marie Gleize (Le Livre des cabanes, Seuil, 2015) ou à Marielle Macé (Nos cabanes, Verdier, 2019). Elle va vers ce qu’elle appelle des « contrées », rappelant au passage les fonctions premières, rituelles, de la poésie : incantation, hypnothérapie, purification. « Je n’ai pas hésité à m’isoler et à jeûner dans les règles / de l’art sur la montagne ». Cet art consiste aussi à « nettoyer » le texte lui-même de certains mots figurant entre crochets, tels « abattage légal », « insécurité », « tourisme », « guerre », « viol », « investisseurs » ou « anti-loups », toute cette négativité à l’œuvre et cette mort omniprésente dont la poète purge son propre texte, à la fin, par un double « recours au rituel de la sauge ». Elle doit y procéder d’urgence, car « c’est décidément d’un monde abîmé qu’il s’agit, écrit Marielle Macé dans Nos cabanes, et abîmé par des pratiques précises, celles du capitalisme avancé et de ce qu’il fait aux vivants, au sol, au sentiment même du commun. »
Il faut donc tenter de vivre dans les ruines de ce monde, avec la présence persistante de nos fantômes. « Avec la crémation pas de fantasme cada /vérique : sur le dossier de chaise / les jambes vides du pantalon » rappelle Sophie Loizeau dans ce livre tendu au défunt père. C’est aussi rappeler le fantôme de soi : « je peine à me coïncider » écrit-elle, quand, dans une sorte d’autoscopie, le moi se dédouble et se surprend dans le temps avec un effet de décalage, de sorte que Sophie Loizeau se lance, par l’écriture, dans la superposition de ses propres images. De plus, l’auteure de La nue-bête (Comp’Act, 2004) et d’Environs du bouc (Compact’Act, 2005) retourne vers une sauvagerie propre. « – or sauvage la terre ne le fut / jamais que pour l’homme et la femme blanches dit Standing Bear ». Plusieurs fois en effet revient la « complainte de la femme blanche », qui dit ce que c’est que d’être femme, que d’habiter ce monde plus menacé que menaçant. Diane, la femme-déesse moderne de La Femme lit (Flammarion, 2009), est chez elle : courant les forêts, caressant ses loups. Chassant, traquant du même coup les souvenirs, son désir, ainsi que les mensonges tragiques d’une civilisation. Déchiquetant la langue par lambeaux, à belles dents.
Comme Apollinaire avait écrit son bestiaire dans Le Cortège d’Orphée, Sophie Loizeau fait des loups le cortège de Diane. Auxquels s’ajouteront la chouette, la tortue, etc, tous les animaux si vulnérables d’être en proie à l’homme, qu’ils soient ou pas de grands prédateurs. Car la poète, dans ce livre, chante avec les loups – « je m’assouvis du chant qu’ils font », eux qui « tout en chantant hurlent », d’un chant mêlant « voix d’enfants et vieilles voix » ; chant profond, puissant, venu des tripes, de la souffrance, de l’expérience de la mort qu’on vit à travers les proches, les parents, irremplaçables et perdus. C’est un « rut / lyrique propre / à la célébration et à l’extase ». Le passage du temps est aussi celui de la poésie, qui se décline par totems, réveillant les uns après les autres les livres dédiés à des moments-phares de l’existence individuelle, traçant peu à peu dans l’air toute l’architecture invisible de l’œuvre. Les animaux donnent leurs noms, en écho aux totems indiens qui savent révéler aux hommes « leur parenté avec les quadrupèdes », « du temps où j’étais « Rêveuse-de-Mystère vers / deux mille quatre / La Femme-Lit Femme-pleine / d’Inquiétude Élan-Femelle-rouge à ma façon / d’élever mon veau et de faire front ».
Le titre lui-même prend tout son sens dans cette logique puissante de nomination. Qu’est-ce qu’être loup ? La poète en donne cette définition extensive au seuil du poème 4 : « est un loup quiconque de la nature et par nécessité à elle ». On voit à quel point la qualité de l’être-loup outrepasse cette seule espèce pour s’étendre à d’autres : « les cygnes sont des loups », « les derniers peuples nomades sont des loups » ; « moi non / née blanche française ma vie / douce pas du tout / âpre est la meilleure des vies / pour une femme. » Avec ce correctif qui intervient pourtant juste après en italique : « n’empêche je suis un loup ». Pourquoi ? Parce que son « cœur est un concentré de vie sauvage ».
L’animalisation du moi traduit bien par exemple le rapport instinctif à la mère, déjà très marqué dans Ma maîtresse forme (Champ Vallon, 2017), au résultat d’un travail de digestion qui reproduit celui de la chouette. « Dans mes pelotes de réjection pêle-mêle : Maman. Ses petits os rien que de les voir. » Le pathétique travaille au corps. Le processus physiologique-linguistique du poème (de la femme-oiseau que devient à ce moment Sophie Loizeau) tient à cela : « j’avale des choses entières », qu’il faut ensuite disséquer du bec. Écrire de la poésie c’est aussi déposer ses « sécrétions » (« il fait comme font les loups il écorce les arbres et dépose ses sécrétions ») ou ses excréments, qu’ils souillent ou qu’ils se souviennent, parce qu’ils restent, dans le langage animal, d’indispensables marqueurs de territoire et les signes témoignant d’un passage.
Et une écopoétique se dessine : un territoire de louve, avec ses tanières et ses failles. Le saule familier, sauvé par le père, l’amande blanche de la maison familiale comme un cocon. Le château dont le parc chasse la femme écrivant, trop colonisé par les bruits des hommes, empêchant la solitude qu’il faut au poème pour le faire naître. Risquant de frapper de péremption la pastorale, rappelée avec force par le philosophe-poète Jean-Claude Pinson, l’insertion de l’homme dans son propre corps, dans ce corps augmenté qu’est encore parfois la nature, avec ses lumières, ses odeurs, ses pistes et ses caches. Le bien-être consiste alors à se lover dans son biotope ; et ce sont aussi des protestations et des combats contre – ce qui pollue, ce qui esquinte, ce qui tue. C’est la plainte que dépose la Mer « représentée par / la femme aux cheveux verts et longs » contre les humains. Ce sont les tortues et les espèces assassinées qui s’offrent aux regards dans tout le scandale de leur vulnérabilité mise à mal. La poésie enregistre les dépositions des grands muets de l’Histoire. Elle offre ce « parlement élargi dont nous avons besoin », écrit Marielle Macé, parce qu’elle « emploie son effort à qualifier ces voix non-voix, ces pensées non-pensées ».
Au final, le geste de Sophie Loizeau est simple, élémentaire même ; geste de rattachement, dans un terre-à-terre revendiqué, sans dépassement : « toucher la terre / avec la main n’a rien de transcendant ». La surface devient la seule profondeur sensible qui permette la vibration et l’accès à toute l’intensité insubstituable de l’existence, dans son ivresse à vif et nue. La poésie hurle avec les loups. Cette philosophie enracinée, immanente, revient de livre en livre comme une basse continue, ici à la faveur d’un « Premier chant de peau » : « désormais le reste de notre existence sera pour jouir ça a commencé ».