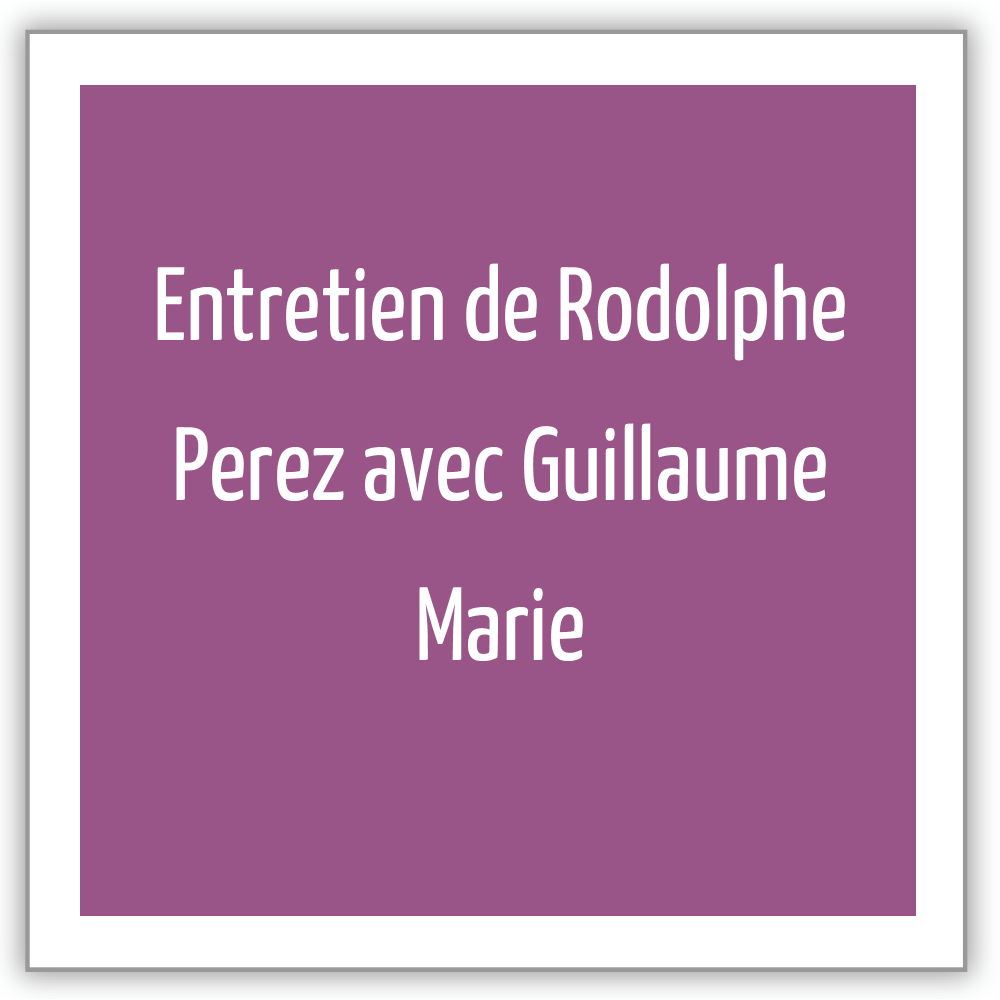Entretien de Rodolphe Perez avec Guillaume Marie
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
Rodolphe Perez : Dans ton nouveau texte paru aux éditions Corti tu mets en scène Benoît Labre, figure singulière qui fait notamment l’épreuve de l’épuisement et de l’abandon dans une recherche du dépouillement. Pourquoi cette figure a-t-elle trouvé un écho propice à l’écriture pour toi ?
Guillaume Marie : La question du pourquoi est toujours compliquée. Il se trouve un moment, j'imagine que c'est comme cela pour beaucoup d'auteurs, où ce qui nous hantait depuis des mois prend en quelque sorte consistance. Alors on n'a plus le choix, on y va... Je crois que jamais je ne me suis dit, avant de commencer : voilà où je veux aller, avec telle ou telle intention.
R. P. : Le livre a ceci de singulier qu’il semble recourir dans sa forme à l’épure de sa thématique, autrement dit tu développes de manière fragmentaire des moments d’écriture qui jouent aussi d’une forme de dépouillement et de minimalisme. Comment as-tu pensé cette forme même du texte ?
G. M. : Je voulais en quelque sorte respecter la position très singulière de Labre, qui a tâché toute sa vie de mettre de l'espace entre lui et le monde. Je ne voulais pas m'imposer en tant qu'auteur, pas le surplomber, encore moins inventer des éléments trop décoratifs ou accessoires. J'ai tenté de trouver, d'un point de vue de l'écriture, la bonne distance. Par exemple, cela m'a paru tout de suite impossible de le désigner autrement que par "il", un pronom qui tend à l'impersonnel.
R. P. : La clarté est aussi celle de l’écriture. D’où vient ta propre curiosité d’auteur ? Où se situe ton intérêt pour Benoît Labre pour qu’il en vienne à innerver ainsi ton travail et faire œuvre ?
G. M. : Ce qui m'a touché, pour ne pas dire bouleversé, dans l'histoire de Labre, c'est cette situation intenable dans laquelle il se trouve continuellement, disons, entre le monde et sa vie intérieure. C'est quelqu'un qui a vécu une marginalité radicale mais qui a pourtant souhaité, par exemple en tentant (en vain) d'entrer dans des monastères, ne jamais s'éloigner de la vie des hommes. S'il est un reclus, c'est malgré lui, et parce qu'il lui était tout simplement impossible de composer avec les règles communes.
R. P. : La question de l’espace est primordiale dans ce texte est au-delà. Il y a, dans l’ensemble de tes écrits, une économie des lieux et une interrogation de la spatialité – c’est le cas dans Les Watères du Château, aux éditions Bouclard, comme dans La fin du monde, co-écrit avec Samuel Deshayes et publié aux éditions Lanskine, fusse dans ces registres différents.
G. M. : Oui, tu as raison. Disons que dans ces livres, comme dans Je vais entrer dans un pays, il est question d'un itinéraire. Pas d'un point de vue métaphorique : non, un véritable itinéraire géographique. Cela vient du problème, je crois, bêtement, de trouver une place où l'on peut être soi-même. Dans la Fin du monde, la faille qui parcourt le monde et finit par engloutir toute chose connue ne cherche pas le mal, elle cherche, presque joyeusement, à montrer comme elle accomplit bien son métier de faille.
R. P. : Comment la forme de l’errance et de la recherche du personnage te sont-elles apparues ? Pourquoi cette question du déplacement ?
G. M. : Benoît Labre a passé sa vie à marcher. Et je crois, du moins c’est mon hypothèse, que même épuisé et au bord de la mort, à 35 ans, il marchait encore, au moins en esprit. La marche est paradoxalement l'endroit qu'il a trouvé. Un endroit mobile, mais de recueillement et d'alignement avec sa vie intérieure. De mon côté, c'est en tâchant de suivre son rythme dans cette marche, à ma façon, que j'ai composé le livre.
R. P. : Dans le dépouillement à l’œuvre, qui prend donc la forme aussi de cette impersonnalisation, se joue toujours une confrontation au monde extérieur, et à une certaine pression qu’il plaque sur le personnage. Comment as-tu travaillé cette voix du monde qui s’oppose souvent au personnage ?
G. M. : Je voulais régler son compte au monde, à mon sens assez inintéressant s'il n'offre pas de place à des personnages comme celui-là ; à quoi rime-t-il si seuls les gens beaux, solides et intelligents y trouvent leur compte ? A rien.
R. P. : Ce qui est vraiment troublant, c’est le rapport matérialiste au monde chez Labre. Il refuse l’élévation – et ses ersatz que serait une supériorité de l’intelligence ou de la beauté. Comment penser, par lui, la possibilité de ne pas refuser le monde extérieur et d’y conserver la foi en le mouvement ?
G. M. : Je ne dirais pas qu'il refuse l'élévation, du moins dans le sens d'une extase. On peut dire que la prière intense qu'il pratiquait est au contraire une forme de suspension du temps, de la faim, du corps en général. C'est cela qu'il cherchait, et c'est par définition impossible – puisque nous avons un corps, d'autant plus dans un monde sécularisé comme le sien. L'historien Sylvain Piron, auteur notamment d'un formidable essai sur Christine l'Admirable, explique bien comment la lévitation, pour prendre cet exemple, a été suffisamment documentée dans l'histoire pour que les historiens ne prennent pas ce phénomène à la légère. Non, la question est plutôt, selon lui : pourquoi peu à peu les humains n'ont plus réussi à léviter ? Labre intervient dans ce moment d'une victoire de la rationalité, dans la fin du XVIIIe siècle, et c'est l'une des positions intenables qu'il occupe : être à la fois un mystique en quête de grandes extases dignes du Moyen Age et vivre dans l'Europe des Lumières, à la veille de la Révolution.
Une autre de ses positions intenables, et cela répond je crois à ta question, est le fait qu'il suive radicalement sa voix intérieure, sans jamais choisir d'être un reclus : il vit dans le monde, et dans une grande ville (Rome), au milieu des gens. Labre représente ce balancement entre la soif de marginalité et le besoin de se frotter aux autres. L'une de ses réponses à ce tiraillement a été le mouvement perpétuel, puisqu'il n'a pas arrêté de marcher, comme ces oiseaux qui volent toute leur vie, qui ne se posent même pas pour dormir. Le chemin est devenu son point d'ancrage, même réduit à quelques rues romaines à la fin de sa vie. Une autre de ses réponses a été de ne plus se laver : endosser l'habit de la puanteur c'est sortir de la civilisation. Je crois que lui, comme Diogène d'ailleurs, font part d'expériences limites qui nous invitent à reconsidérer nos efforts réalisés pour nous conformer au monde, et forcément à repenser quelle distance il est nécessaire de mettre en lui et nous.
R. P. : Aussi, Labre ne se situerait-il pas plutôt du côté d'une mystique presque négative, par sa recherche du dépouillement et de la perte ?
G. M. : Au contraire, le dépouillement et la perte font partie de la définition du mystique. Simone Weil dans La Personne et le Sacré : « Tout l'effort des mystiques a toujours visé à obtenir qu'il n'y ait plus dans leur âme aucune partie qui dise « je ». »
R. P. : Ce refus de la sécession d'avec le monde est exemplaire. Est-ce que ce geste politique est réfléchi chez lui ? Parce qu'il y a sans doute un refus de la conformité du monde (ne plus se laver) mais qui est aussi accepter les couches que le monde dépose sur nous, et ne plus s'en défaire.
G. M. : Non, ce n'est pas un geste réfléchi. Je crois précisément qu'il a choisi de ne pas réfléchir, mais au contraire de laisser sa voix intérieure guider entièrement ses actions. Il fait, si l'on veut, la marionnette : son parcours est un abandon à ce qu'il est très profondément.