Daniel Biga - L'amour d'Amirat par Christian Travaux
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
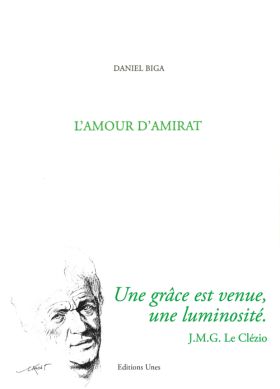
L’amour d’Amirat c’est l’amour de la vie
(p. 34)
En 1984, paraissent la première Semaison de Jaccottet, L’Herbe des talus de Réda, et Au jour le jour, le premier volume, chez B. de R., des carnets de Paul de Roux. C’est assez dire, par ces titres, par ces noms, que les planètes, en poésie, cette année-là, ont gravité toutes autour d’un même soleil, d’une même recherche de clarté, plus de lumière, plus de couleurs, et une plus grande volonté de réel et de concrétude. En 1984, année solaire s’il en fut, paraissait L’Amour d’Amirat de Daniel Biga, réédité aujourd’hui. Et c’est la même gravitation autour d’une source solaire, la même belle contemplation de la terre et de la nature. La même tentative, aussi, de trouver une autre écriture pour dire le réel au plus juste, le quotidien des jours qui passent, et des nuits où tremblent – frileuses – les étoiles dans le ciel noir. Lire L’Amour d’Amirat, c’est lire, dans chaque page, sur chaque ligne, le frêle bonheur d’être vivant, sous le ciel clair, sur notre terre, pareil à l’herbe des talus.
Des notes. De courts paragraphes, longs d’une page ou longs d’une ligne. Au jour le jour, des notations, comme pour un journal intime. Des essais de poèmes aussi. Mais peu de dates, sinon à la fin du volume : « Le Barlet d’Amirat, 1977-1978 ». Amirat, petit village des Alpes-Maritimes, et le Barlet, « un hameau aux trois quarts en ruine » (p. 46), mais qui avait – précise Biga – « jusqu’à cinquante habitants là où [il est maintenant] seul » (id.). Daniel Biga y séjourne de 1977, arrivant vraisemblablement en novembre 76 (p. 9), jusqu’en 1978, après janvier, semble-t-il (p. 124). Il y restera, solitaire, pendant des mois, avec, toutefois, quelques visites de sa femme et de sa fille, des rencontres de voisins, ou des descentes, rares, au village. C’est un choix volontaire de vie, par rejet absolu de tout ce qui oppresse, et qui opprime, la routine, l’ordre social, le travail. Et il s’en amuse lui-même, pensant à sa feuille d’impôt, à ce qu’il devra y écrire : « clochard ? ermite ? poète ? cultivateur économiquement très faible ? vagabond ? contemplateur d’étoiles ? » (p. 29). C’est, surtout, un choix d’écriture, pour que l’existence quotidienne retrouve un sens, retrouve goût, et qu’enfin les yeux soient lavés, et l’âme, le cœur, renouvelés.
Et c’est miracle de le lire. À chaque page, il s’étonne de tout. De chaque chose, il s’émerveille : du feu qui brûle dans la cheminée (p. 9), qu’il nomme « ma télévision à moi » (p. 23), aux escargots, qui courent, qui courent (p. 24), qu’il appelle, très sérieusement, « notables de la montagne » (p. 48) ; d’une taupe « moi épluchant au seuil de la maison » (p. 29), à toutes les plantes, et il s’enchante « de leurs tiges leurs feuilles leurs fleurs » (p. 55) ; ou, encore, de l’araignée, de la fourmi (p. 60), de tout insecte inconnu de lui, dont il découvre l’existence (p. 24), aux étoiles, « ô mes étoiles innombrables au bord de l’océan » (p. 115). Tout est chant du monde, chant du vivre, et occasion nouvelle de chant. Tout est sujet à découverte, et tout est à redécouvrir. Et, au Barlet d’Amirat, dans sa solitude, Daniel Biga réapprend tout, ou bien plutôt il réapprend ce que nous tous nous négligeons, ce que nous ne considérons pas assez, ou pas assez digne, et qui est, pourtant, l’essentiel. S’asseoir, ainsi, dans la présence des choses, parmi les nuages blancs (p. 21), ou s’asseoir cul nu dans la neige (p. 119) ; boire à la source et se baigner dans un torrent (p. 89) ; contempler ses couilles à l’air, et sa verge encore verte (p. 61). Et puis, rester « face au soleil / dos au mur de la montagne / ici et maintenant (p. 27).
Ici et maintenant est, certainement, ce que Biga réapprend de plus essentiel, de plus utile, l’art d’être là, là où nous sommes, et rien de plus. Le luxe de savourer l’instant, d’être vivant sous le ciel clair, corps et chair plantés sur terre. La leçon qu’il tire de cela est, alors, des plus précieuses. Regarde, écrit-il, regarde :
« Remontant le ruisseau où tu cherches du cresson observe : boue sous tes bottes bulles écume éponge de la terre escargot glissant sur tige Soulève cette feuille : une limace dorée y vit Observe ce que tu écrases ce que tu ne vois qui ni plus ni moins que toi existe […] penche-toi dessus les corolles penche-toi ! regarde de près…
Sois humble humble souviens-toi : humilité sortie de secours vers les choses simplement parmi elles à ta place » (p. 34).
Dès lors, il n’est pas étonnant de le voir tout énumérer : les bruits (p. 11), ce qu’il mange (p. 17), les arbres (p. 45), le nom des fleurs (p. 55), tous les lieux jusqu’aux lieux-dits près de chez lui (p. 67), ses plantations (p. 69), les insectes (p. 83), les animaux (p. 102), et ses objets du quotidien (p. 39), jusqu’aux « il faut », verbe de contrainte qu’il égrène pour « apprendre à vivre » (p. 69-70). Et même une suite de « coucou ! coucou ! coucou ! » (p. 72), pour rompre sa solitude.
« Oui ici les choses simples sont un cadeau merveilleux » (p. 30). « Chaque seconde [est] signe et merveille » (p. 130). Il faudrait pouvoir tout citer, tant chaque phrase contient en elle un potentiel de bonheur, une moisson de joie. Si ce qu’il éprouve est de l’ordre d’un « bonheur élémentaire » (p. 92), si tout est beauté, et beauté, « oui […] beauté gratuite » (p. 37), c’est donc que ce que ce nous vivons ici, tous les jours, dans nos vies, est temps perdu, est vie perdue, dépense vaine, quand il suffit pour être heureux d’une herbe, d’un soleil qui se couche, d’un peu de pluie. Et de la paix du ciel, le soir, quand on est simplement assis face à l’espace, face au vide du ciel noir, qu’on contemple indéfiniment. Écrire, alors, serait écrire, mais pour dire qu’on est vivant, comme le demande Daniel Biga (p. 10), pour dire la chance de chaque jour, de chaque instant, pour faire l’éloge de ce qu’on voit comme la louange de ce qu’on vit. Ma Terre : « Sois bénie – écrit-il – respectée sous les étoiles » (p. 36).
Élevons, donc, comme le fait Biga, un chant de grâces face au vivant, qu’il soit « Essence Universelle d’avant les religions », comme il l’appelle (p. 42), « Innocence Euphorique » (p. 50), ou bonheur d’être simplement. Et saluons, comme il le fait, chaque matin de notre vie, le soleil « Grand Matinal Pur-Flamboyant Haut-Silencieux » (id.) pour ce qu’il nous donne de joies à espérer dans la journée.
La vie ne vaut que pour cela.