Insouciances du cerveau d'Emmanuel Fournier par Pascal Poyet
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
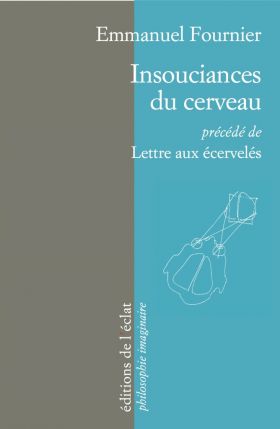
Emmanuel, je fais, comme à mon habitude, avec ton livre comme avec une personne : je tourne un peu autour avant de l’aborder. Et même, avant de tourner autour, je le cherche. Je le cherche dans la librairie, cette librairie[1]. Or il se trouve, sans doute parce que tu allais venir, que tes livres ont été réunis au même rayon, et que celui-ci, Insouciances du cerveau, peut-être aussi parce qu’il est publié dans cette collection, « Philosophie imaginaire », la même que tes premiers livres, Croire devoir penser et L’Infinitif des pensées[2], je l’ai trouvé avec quelques autres au rayon philosophie. Mais je me souviens que lorsque j’avais cherché Creuser la cervelle[3], ton autre livre sur « l’idée de cerveau », c’était en vain que j’étais allé voir au rayon philosophie où se trouvent la plupart de tes livres ; que j’étais même allé, sans trop y croire, au rayon poésie, où beaucoup de tes livres, il me semble, pourraient pourtant se trouver, et qu’un libraire m’avait indiqué cette table dans un coin de la librairie qui m’était totalement inconnu : le rayon des sciences. Cette dispersion des rayons de ton travail est à la mesure du morcellement du moi dont il est question dans tes livres, toutes ces facettes ou ces morceaux du moi, de toi, qui un peu à la manière d’un jeu de dominos s’assemblent sous ce que tu as appelé ailleurs ton « pauvre nom »[4]. Ce moi « dispersé en tous sens », comme tu l’écris dans ce nouveau livre, — mais n’allons pas trop vite. Je tourne donc autour de ton livre, que j’ai trouvé plus facilement que le précédent — quoique cette fois j’aie d’abord voulu me rendre au rayon sciences — et je regarde comment il est fait.
D’abord le titre. Insouciances, au pluriel, du cerveau. Dois-je entendre que nous sommes les insouciants (que nous ne nous soucions pas, ou ne devrions pas nous soucier du cerveau), ou bien que c’est lui, le cerveau, qui « insoucie » ? Retrouver ces mots au début de ton texte m’offrira quelques pistes : « Ici commence un livre d’insouciance [cette fois au singulier]. J’apprends que je ne sais rien, sinon que mon cerveau sait et apprend pour moi tout ce qu’il faut, qu’il me donne conscience de ce qu’il veut, quelques miettes par-ci par-là… » ; plus loin : « Ai-je tort de me faire tant de souci quant à la conduite de ma vie ? » ; et plus loin encore : « Va, mon cerveau ! Tu peux te mettre en mode insouciance à mon sujet. Je t’emmène avec moi, j’insoucie avec toi. »
Après l’ouverture en forme de lettre « aux écervelés », ton livre se présente comme une alternance de Carnets et de Suites. Alternance interrompue deux fois par des Notes méthodologiques, et suivie d’un Épilogue et d’une Table permettant de comprendre cette structure d’un coup d’œil. Je feuillette. Les notes des Carnets (ils sont quatre) sont datées et numérotées : juin 2015, juillet 2015 (Carnet d’Ouessant, est-il précisé — comme il y en avait déjà dans l’Infinitif des pensées — cette île au nom en forme de participe présent semble bien te convenir, à toi dont le nom rappellerait plutôt un infinitif), septembre-octobre 2015, puis novembre-décembre 2015. Respectivement 29, 34, 39 et 25 notes ; soit 127 notes sur quelque six mois, alternées avec quatre Suites constituées cette fois systématiquement de 16 remarques chacune (numérotées aussi). 16 fois 4, cela fait 64 remarques. Le nombre de notes des Carnets est donc le double du nombre de remarques des Suites, moins 1. Cet 1 en moins qui laisse la structure de ton livre ouverte, indéterminée ou in-terminée, un toujours à faire qui me rappelle l’infini ou indéfini dont il est question, au moins de façon sous-jacente, dans ton travail à l’infinitif, de Croire devoir penser à Philosophie infinitive[5], qui, volontairement, reparaît en poche en même temps que paraît Insouciances. Tu en parles ici encore, de nos « caractérisations jamais achevées », dans de belles pages sur l’identité ; ce que tu appelles notre « ressort à l’indétermination ». Outre que dans cette alternance de Carnets et de Suites, il me semble assister et, ou prendre part à l’élaboration de ton livre, j’aime à croire que, lecteur, je suis cet 1 que tu n’as pas rempli.
Ces Suites ont des titres, toujours en forme de questions : « Pourquoi écouter le cerveau ? », « Comment faire parler le cerveau, comment lire la pensée ? », « Que faire dire au cerveau, pourquoi le lui faire dire à notre place ? », « Quelle oreille prêter au cerveau ? ». On voit qu’il va, dans ce livre où il s’agit beaucoup d’imagerie, être question de, je te cite, « façons de parler » et de « façons de penser », de langues et de grammaire. « Les mots et la grammaire, demandes-tu dans le premier Carnet, ne disent-ils pas aussi mes pensées ? N’y sont-ils pas un peu pour quelque chose dans la diffusion et l’acceptation de toute pensée, y compris la cérébrocentrée ? »
Parmi les passages de ton livre qui échappent à mon décompte, je relève d’une part les deux Notes méthodologiques, que l’on trouve, la première entre les Carnets d’Ouessant et la deuxième Suite (« Comment faire parler le cerveau »), la seconde entre le troisième Carnet et la troisième Suite (« Que faire dire au cerveau »), et, d’autre part, cette « Reprise en quelques noms », à la fin de l’épilogue, concluant le livre. Je commence par elle : trois pages qui se détachent magnifiquement, reprenant, dans une grammaire très singulière, puisque c’est sans un seul verbe, la réflexion amenée dans les quelque 170 pages qui précèdent. Un texte uniquement constitué de substantifs (de noms) et des mots grammaticaux qui permettent de faire des phrases avec eux. Sans oublier les signes de ponctuation, qui sont, dans cette grammaire sans verbes de soutien, d’une importance renouvelée :
« — Alors quoi ? Dénonciation d’un cerveau sans cervelle ? “Beau cerveau, mais de tête point.” Non, pas d’ironie possible non plus. Ou alors, à fond : Respect pour le nouvel être cérébral et le nouvel inconscient ! Respect pour notre cognition et notre cérébralité ! Et respect pour la science et ses vertus ! Pas d’autre issue qu’une positivité. Debout le cerveau ! Sus aux soucis ! Adieu inquiétudes et retenues ! Au diable méfiances et suspicions ! »
Or, et tu vois que je commence à aborder ton texte, à l’aborder sérieusement, ce qui est très parlant, si j’ose dire, dans cette Reprise, c’est le ton sur lequel elle est écrite. Ce ton, je dirais qu’elle le donne rétrospectivement à tout le livre, c’est-à-dire qu’elle me fait comprendre que tout le livre cherche un ton. Un ton à opposer à ce que tu appelles la neurolangue. Je trouve dans ton livre une espèce de balancement entre une certaine ironie d’une part et l’usage et la critique de l’analogie d’autre part. Deux registres. Communiquent-ils ? Dirais-je que c’est une affaire de vases communicants, que lorsque le ton se remplit d’ironie (« à fond »), le propos se vide d’analogies, et vice-versa ? Cette « Reprise en quelques noms » prolonge l’expérience de ta récente Comédie des noms[6] : écrite à Venise — Ouessant, Venise, tu confies décidément beaucoup de choses à l’île ![7]— en « langue substantive », comme tu dis, elle est le pendant inattendu à ta philosophie infinitive — et c’en est également la traduction —, écrite, quant à elle, en l’absence de noms, avec les seuls verbes à l’infinitif, les participes présents et les mots grammaticaux qui, si nécessaire, les font aller ensemble (phraser). Ces « langues » ont en commun qu’elles excluent les pronoms sujets ; il n’y a donc, à l’infinitif comme au substantif : point de « je ». Ce « je » dont la place, la valeur, l’usage, la pertinence même, sont remis en cause d’un bout à l’autre d’Insouciances. « Me voir comme une représentation de mon cerveau, voilà qui devrait rabattre le caquet de mon “je” ! » Cette affaire de cerveau double de moi-même, prétendu siège de mes pensées, voire pensant à ma place, est bien une affaire de grammaire. La première Note méthodologique, à laquelle je viens maintenant, est précédée d’un exergue à l’infinitif :
« Chercher à percer, à pénétrer, sans pourtant achever de le faire. Laisser se cacher toujours un peu. Faire semblant de ne pas pouvoir, de renoncer, de détourner. S’empêcher.
Pour désirer encore. »
Cette première Note méthodologique nous dit qu’à plusieurs reprises ici, tu as employé une méthode d’écriture que je te connais d’autres textes comme Les Verbes de la désolation et Les Verbes de la consolation[8], où tu revenais sur cette expérience de l’écriture infinitive, et qu’alors tu nommais « collage de morceaux préparés ». Ici tu parles de « transposition » ; qu’importe, nous ne quittons pas le vocabulaire musical. C’est d’ailleurs également par un terme musical, « transcription », que tu as nommé ces textes de Nietzsche ou de Wittgenstein, entre autres, que tu as récrits pour le seul instrument de l’infinitif. Or, tu nous expliques ici que la seule façon honnête pour toi de répondre à une invitation qui t’avait été faite de participer à un hommage à Michel Foucault à l’occasion de l’anniversaire de la parution de Naissance de la clinique, avait été de tenter une expérimentation de langage et de philosophie, de faire véritablement un essai : de transposer dans le domaine des relations cerveau-pensée ce que Foucault dit des relations au corps de la maladie et de la folie. Cette expérimentation, tu la prolonges ici avec un autre texte de Foucault. La seizième et dernière remarque de la troisième Suite, titrée « Internement cérébral », est annoncée comme une transposition d’Histoire de la folie à l’âge classique. Foucault écrivait que : « L’enfermement, c’est la pratique qui correspond au plus juste à la folie éprouvée comme déraison, c’est-à-dire comme négativité vide de la raison, la folie y étant reconnue comme n’étant rien. » Tu écris : « L’encérébration [ce sera ton mot], c’est la pratique qui correspond au plus juste à une pensée [tu as remplacé folie par pensée] éprouvée comme négativité vide de la raison scientifique. Paradoxalement, la pensée y est reconnue, mais reconnue comme n’étant rien. » Et Foucault continuait : « C’est-à-dire que d’un côté, elle [la folie] est immédiatement perçue comme différence (…) ; et d’autre part l’internement ne peut pas avoir d’autre fin qu’une correction (c’est-à-dire la suppression de la différence, ou l’accomplissement de ce rien qu’est la folie dans la mort). » Et toi : « C’est-à-dire que d’un côté, elle [la pensée] est immédiatement perçue comme différence ; et d’autre part, l’encérébration [son internement] ne peut avoir d’autre fin qu’une correction (c’est-à-dire la suppression de la différence ou l’accomplissement de ce rien qu’est la pensée) ». Plus loin, tu précises : « L’encérébration désigne une position décisive : l’attitude où la pensée se trouve recluse, et — dans la forteresse de la boîte crânienne — liée au cerveau, aux lois de la morale cérébrale et à ses règles monotones. » (« On croit avoir affaire à des lois de l’esprit, ajouteras-tu dans un fragment du quatrième Carnet, quand ce ne sont que les règles d’une langue. ») Foucault écrivait de la folie arrachée à cette liberté imaginaire qui la faisait foisonner encore sous le ciel de la Renaissance, qu’elle s’est, en quelques siècles, « trouvée recluse, et, dans la forteresse de l’internement [ta boîte crânienne], liée à la Raison [ton cerveau], aux règles de la morale et à leurs nuits monotones. »
La science, dis-tu dans cette troisième Suite, fabrique du cerveau une « image moyenne » ; un cerveau calculé qui n’a besoin d’exister chez aucun individu, mais auquel on cherchera à aligner son comportement. Toute singularité est un « écart statistique ». L’homme normal, c’est l’homme non-ceci, non-cela. Mais on m’explique aussi mes plus grands écarts en termes cérébraux. Bref, je n’en sors pas ! Si quelque chose ne va pas, j’accuse mon cerveau, « ce n’est pas moi, c’est lui ! », dis-je de ce « double » de moi-même (moi, l’écervelé qui dit « je »), et je peux aussi garder l’espoir qu’avec les progrès de la science, cela s’arrangera. « En attendant, écris-tu, mon cerveau me condamne. » Arrivé à ce constat, c’est, disons, logiquement que tu en viens à emprunter la langue de Foucault et à suivre le cours, c’est-à-dire le ton, de sa critique de la folie et de l’internement, et, recourant à l’analogie — analogie dont tu t’es attaché par ailleurs à nous « montrer » les méthodes pour y échapper[9]— à remplacer sa forteresse de l’internement par celle de la boîte crânienne.
« Interner » devient « encérébrer » (qui donne « encérébration ») ; il faut l’entendre comme « encerveler », lequel est défini, après ta « Lettre aux écervelés », comme l’acte de tout ramener au cerveau, de voir (le monde, l’homme, la pensée) à travers le cerveau, en faisant référence à lui. Je peux dessiner l’analogie de cette façon : l’internement est à la folie ce que l’encérébration est à la pensée ; même si, bien sûr, en allant consulter le texte de Foucault, je reste aux abords de ton livre, qui n’est pas un livre bilingue Foucault/Fournier. Et tu te questionnes, immédiatement après cette transposition, en exergue au quatrième Carnet : «“Pensée”, ne peut-on substituer ce mot à celui de “folie” ? Ce serait réduire la folie que l’assimiler à la pensée ; mieux vaut viser l’inverse : non pas réduire, mais augmenter la pensée en la rappelant à la folie. Qu’est-ce que penser ? Et déraisonner ? »
Mais parler de bi- ou plurilinguisme, comme je viens de le faire en passant, ne me semble pas déraisonnable, puisque d’une part tu as toi-même présenté les fragments en vis-à-vis de Mer à faire comme une écriture en deux langues, français d’un côté (ou toute autre langue « avec narrateur, sujets, verbes et compléments », précisais-tu), infinitif de l’autre (« langue pour verbes et conjonctions ») — à quoi il faut ajouter le dessin[10]—, et que d’autre part ici, dans la deuxième série de Notes méthodologiques, tu expliques que tes lectures dans le domaine des neurosciences, la fabrication des images cérébrales, leurs enjeux sociaux et leurs implications pédagogiques, ont fourni à tes Insouciances, « un champ où se lancer et des langues entre lesquelles se déplacer ». « Les langues, dis-tu, sont des sortes de lieux qui nous font sortir de notre lieu ordinaire et qui nous font penser autrement. » « Les diverses langues qui peuvent se composer pour nous valent par les éclairages et les enrichissements qu’elles se donnent, mais aussi par les échappées qu’elles nous donnent, l’une par l’autre. Il nous en faut de nouvelles pour nous découvrir et nous échapper de nous-mêmes, de ce que nous avons figé, des lieux identitaires et des différences où nous nous enfermons. » Je referme cependant les guillemets, alors que sont redistribués les dominos. « Changez de langue, proposes-tu à l’autre bout de ton livre : non seulement vous ne verrez plus les choses de la même façon ni avec la même nécessité, mais vous n’aurez plus du tout affaire aux mêmes choses. » C’est déjà ce que montraient les transcriptions infinitives.
« Comment réveiller la pensée quand elle s’enlise et qu’elle dort ? », te demandes-tu. N’est-ce pas là le vrai sujet de cette critique de la neuro-imagerie et de la vision (du monde, de l’homme, de la pensée) neurocentrée ? Cette nécessité écervelée (« hors de moi, indéterminé ») d’expérimentation de langage et ce que j’appelais la recherche d’un ton sont une réponse. Elles font d’ailleurs l’objet de quelques lignes dès la première Suite : « Moquez-vous comme vous le devez de ce système extravagant. Savez-vous ce qui arrivera ? On vous prendra pour un obscurantiste. Méfiez-vous du jargon, des fantasmes et des dogmes dont le cerveau s’entoure, opposez-leur un ton différent, des termes autres, on vous fera passer pour un poète, parce que vous cherchez à réfléchir et que vous vous efforcez de ne pas céder à un langage. Pourtant n’est-ce pas d’abord sur le terrain de la langue que se jouent la lutte et les résistances ? » (Je souligne.)
« Ne pas céder à un langage », c’est à l’évidence pour cela qu’ont été écrites ces Insouciances. Tu en donnes le projet dès les dernières notes de ce premier Carnet. — C’est que l’enjeu est de taille et les questions nombreuses : « Que me veut le cerveau ? Que veut-il me faire comprendre ? De quoi veut-il m’aider à me dégager à travers lui ? N’avais-je pas assez de mon “je” pour me doubler ? Qui suis-je ? Qui derrière lui ? ». Et le projet du livre s’expose en termes de réponses, mais pas de réponses aux questions ; c’est à la note suivante, et c’est moi qui souligne : « Aux images cérébrales fonctionnelles, répondre par des croquis de cerveaux [et il y en a, en effet, parsemant le livre], des notes, des remarques et des brouillons explicatifs. Aux séries des coupes du cerveau, répliquer par une suite d’annotations. Confronter une imagerie littéraire du cerveau [et la critique de l’analogie que j’ai décrite ici] à l’imagerie par résonance magnétique. Deux poésies. » — « Deux poésies », écris-tu ; j’aurais tendance à n’en voir ici qu’une seule digne de ce nom. Et je commence à croire que je n’avais pas tort d’aller voir si je trouverais tes livres au rayon poésie, car ton travail est bien de cet ordre : répondre, répliquer, confronter, poésie contre poésie.
Ici, Emmanuel, je commence ton livre d’insouciance : c’est un livre de philosophie et c’est un livre de poésie, cette poésie qui cherche à réfléchir (qui est réflexive, s’interroge sur ses moyens), ne cède pas à un langage, se déplace entre des langues, des grammaires ; poésie brouillon-explicative, qui est croquis, remarques, annotations, essai, qui sort (et nous fait sortir) de son lieu ordinaire. Pour désirer encore, avant la nuit monotone.
[1]Texte écrit en préparation à une conversation avec Emmanuel Fournier, à l’occasion de sa venue à la librairie Ombres Blanches, à Toulouse, le 4 octobre 2018, pour la présentation de son livre : Insouciances du Cerveau, L’éclat, 2018.
[2]Croire devoir penser, L’éclat, 1996 ; L’Infinitif des pensées, L’éclat, 2000.
[3]Creuser la cervelle. Variations sur l’idée de cerveau, PUF, 2012.
[4]L’espace domino & Méthodes pour échapper à l’analogie montrées à la façon des dominos, contrat maint, 2005.
[5]Philosophie infinitive, L’éclat, 2014, réédition L’éclat/poche, 2018.
[6]La comédie des noms, Éric Pesty, 2016.
[7]Lire Se confier à l’île, Locus Solus, 2016, et le texte d’Anne Malaprade sur Sitaudis :https://www.sitaudis.fr/Parutions/se-confier-a-l-ile-d-emmanuel-fournier-et-francoise-peron.php
[8]Les verbes de la désolation & Les verbes de la consolation, contrat maint, 2012.
[9]« Résister à l’analogie, c’est résister à confondre, ou plutôt à devoir le faire d’une seule manière. » Méthodes pour échapper à l’analogie montrées à la façon des dominos, op. cit.
[10]36 morceaux & Mer à faire, Éric Pesty, 2005.