Dominique Fourcade. voilà c’est tout par Michaël Bishop
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
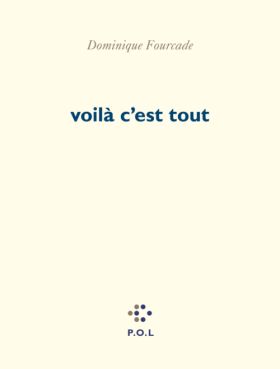
Le poème comme partage, discours libre, prose, geste de rassemblement fait de sauts, parenthèses, site d’une si vite oubliée non-différence de X et Z où accueillir ‘l’angoisse’ de l’autre (16) et ‘un moi dont le curseur se déplace sans cesse’ (18). voilà c’est tout pourtant est loin d’offrir ce tout, même si le titre inscrit simultanément face à la vieillesse un faux signe d’adieu. La rhizomaticité que déploie la parole de Dominique Fourcade reste certes immense, impulsive, sans aucun raisonnement global pour discipliner ses randonnées : Pollini, Shostkovitch, Mahler, Cunningham, Boulez, Cage dans une petite rafale par exemple, sur la même page. Oui, Gaza, affirme-t-il, est l’emblème ‘monstrueux de quelque chose de général aujourd’hui’, mais ce tout que blasonneraient quelque part guerre et amour fusionnés reste plus complexe, ‘événementiellement’, intellectuellement, émotionnellement. Le poème ne se laisse nullement contenir-circonscrire-concevoir si facilement. Opérer des ensembles (14 micropoèmes + le non-inimportant précisions et remerciements), des échanges, des interpénétrations, très librement articulés, parfois oniriques, hallucinants, ce n’est qu’aller, vacillant, dans le sens d’une orchestration, vite réorchestrée-désorchestrée, comprend Fourcade (38), pleinement conscient d’ailleurs que l’‘objet de mon amour tu n’as jamais le même corps qu’hier, je sais ça’ (35). L’aimé et le détesté, le réjouissant et l’horrifiant dansant, inextricables, compris comme dans un troublant rapport qui semble essentiel au dépliement du réel. ‘Faire le métier sans mélancolie’ reste en principe le mantra idéal de l’œuvre de Fourcade dans son intégralité, et même ici ; mais le poids du présent tel que Fourcade le voit et le soupèse – et on ne voit, ni ne soupèse pas tout, cet impossible, dirait Bataille, malgré l’innombrable arborescence d’évocations-méditations-accusations, ces thèmes ‘[sans] thème’, dit-il (111), sans fin surgissant, s’entretissant – ce poids et ce présent s’avèrent enfin acte et lieu de ‘tresse [et] détresse’, tressage et dé-tressage en effet – fatalement, destinalement.
Écrire pour Dominique Fourcade reste ainsi ce ‘risque [d’être à la fois] le mitraillé et le mitrailleur’ (20), risque de se voir l’objet de tout ce qui est perçu comme hostile, risque de devenir celui qui, souffrant, horrifié, ‘ce nouveau moi écrivain que le désastre a révélé’, ne cesse d’attaquer, de ‘tuer’ à son tour, son écriture plongée dans des ‘cadences [et l’enjeu même de ma vie’ transformés ‘sans retour’ (25). Face à ce qui est, ce qui se fait, comment trouver, fonder alors une justice avec la justesse requise ? Fourcade répond que tout exige que ‘l’éros continue’ et que pour ce faire, ‘il faut qu’il y ait de l’art’ (30). La mission de celui-ci consisterait à chercher ‘une nouvelle forme événementielle qui suspendrait la tragédie’, opérant le ‘soulèvement’ rêvé (31). Un seul vers, même en prose, suffirait, déclare-t-il, mais ce vers s’avère ‘au-dessus de mes moyens’ (33), avoue-t-il. Le spectre de l’impossible resurgit. L’humain empêcherait-il sa propre et inhérente humanité ? Un acte qui impliquerait toute une existence-écriture, centré sur la ‘prière’ et le ‘pardon’ – Fourcade pense à Charlotte Delbo – qui, mais qui, pourrait atteindre à une telle pureté, une telle sainteté ? Écrire ‘aux prises avec la réalité d’aujourd’hui’ (52), comme Fourcade le recommande et pratique, s’y opposerait on ? Mais l’aujourd’hui a ses ‘profondeurs archéologiques’ (52) qui complexifient, risquent constamment de déformer, distordre, les idéologies du moment noyant amitiés, amours, tout comme les ‘innocences’ et les ‘ignorances’ que nous ne voulons même pas admettre. ‘Un rapport de vérité avec l’atroce de la réalité’ (43) dont rêve Fourcade, comment percerait-il les voiles de nos partis pris, instables ou figés, afin de dénicher de telles vérités? Certes, la langue, comme l’affirmait Hugo, n’offre aucun mot qu’il faudrait, peureux, refuser. Elle est faite pour l’expression de ce tout qui hante l’esprit de Fourcade. voilà c’est tout, pourtant, est souvent sur le point de se laisser étouffer par le sentiment d’une culpabilité, d’une honte, dérivant ainsi vers une quelque peu cavalière et perverse idée d’une obligation de tout réécrire, toute son œuvre à la lumière de ce masochisme. Une tension existentielle règne ainsi partout. Ne serait-ce pourtant pas oublier que la violence, l’indécence, l’horreur ont toujours existé ; oublier que la guerre Israël-Hamas et la guerre russo-ukrainienne, ne sont que les derniers épisodes d’un vaste et, dirait-on, inachevable drame planétaire ; oublier aussi que d’autres épisodes déroulent ailleurs, aujourd’hui, leurs terreurs, manifestement civilisationnelles ou secrètement domestiques ? Certes, Fourcade comprend que le poème doit ‘oser’, accepter même le ‘devoir’ de témoigner (81-2). Et, en fin de compte, voici ce que Fourcade accomplit ici à sa guise, quoique – et il le sait – vacillant, comme tout écrivain écrivant à sa table, entre tristesse-indignation à distance et ce qu’il appelle ‘sophistication, le fume-cigarette’ (47) à cause, précisément, de cette distance. Entre, aussi, une violence accusatrice et l’impulsion fondamentale d’un amour, d’une compassion, d’un désir de partage humain, d’essentielle non-différence malgré le fait de notre individuation.
‘Âcre nacre écriture’, semble conclure Fourcade (53). Le poème, site et geste d’une matière irritante-contestatrice et, inséparablement, éclatante-lumineuse. Et cette inséparation replongeant l’écrit dans le cercle de ce vaste risque où même le mantra fourcadien de l’amour se trouve menacé. ‘Je te préviens, lit-on, que nous pourrions nous aimer et que c’est un danger extrême’ (99). Mais quel danger guette le poème ? À la fois sa ‘pudeur’ et son ‘impudeur’ (54) ? Sa pulsion de mort comme sa pulsion de vie (55) ? Le ‘tout’ considéré comme un site d’irréconciliable, exigeant pourtant l’impulsivité d’une nécessaire ‘continuité’ (55) ? Le poème, existe-t-il même pour résoudre de telles oppositions ? Ses binarités intrinsèques sembleraient impossibiliser une telle ambition. Et la prose, n’inciterait-elle pas argument, positionnement, déclarativité, Foucade en restant toujours conscient ? voilà c’est tout voudrait, certes, sortir de ce cercle vicieux des oppositions, mettre de côté le noir des Pinturas negras de Goya (96), y voir plutôt le salut d’un art pointant vers une lumière même si sentie malheureusement absente, noyée par l’angoisse peinte. Ce qui le pousse à aller vers le chant du scriccciolo, d’un petit oiseau appelé troglodyte (65-77) ; vers, implicitement, un langage originel, primitif, loin, emblématiquement, de nos rationalisations pseudo-sophistiquées, si souvent conflictuelles. Revenant pourtant vers son mantra fondateur, Fourcade réaffirme que ‘les trois mots je t’aime sont le moteur de recherche’ de la vie, comme de la poésie, même si le risque reste, implacable, indéracinable, de ‘thémer’ (111) – d’arguer, de se cramponner aux idé(ologi)es. Comment éviter ce piège? Aller au-delà de l’impossible qui semble s’ériger, site d’un mur en ruines ? Dominique Fourcade finit, me semble-t-il, par opter pour une vision du poétique comme ‘un travail de silence, le courage consist[ant] à ôter du son, à s’établir dans très peu de son’ (60). Comme si tous les mots inscrits perdaient leur fixité, leur savoir, leur signification, noyés dans un silence, celui d’une ‘neutr[alité d]’arbre’ (128), que j’appellerais ontologiquement résurrectionnel et auquel on consent. Rêve que trahit, hélas, le quatorzième micropoème du recueil.
Mais peu importe sans doute, cependant, car le poème fourcadien, honorable, fidèle malgré tout à son rêve persiste à murmurer silencieusement amour et ce désir éblouissant à son centre.