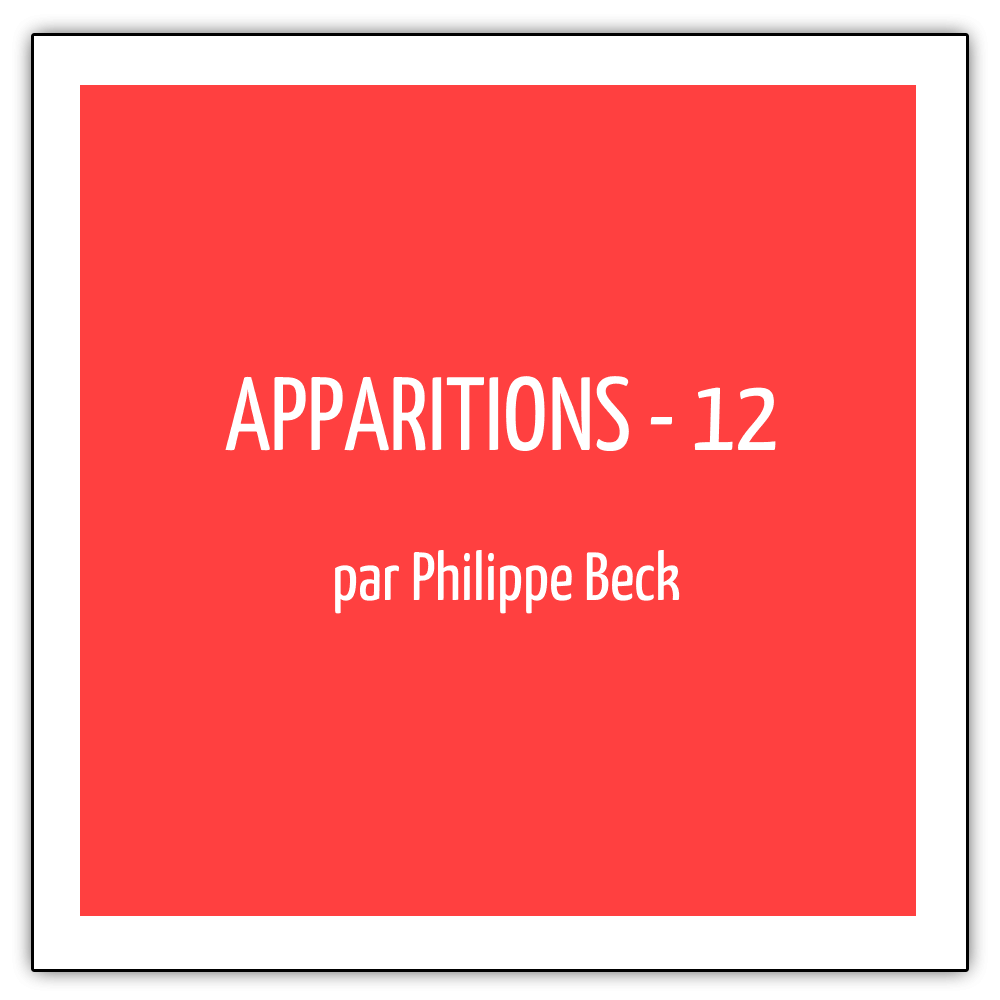APPARITIONS - 12 par Philippe Beck
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
12. Art et assassinat.
La vie conforme désigne ou bien la vie indifférente aux œuvres ou bien la vie que les œuvres répriment. C’est dans la répression culturelle que naît la possibilité du meurtre. Par répression culturelle, il faut entendre, non le fait toujours possible que la culture vivante soit contrôlée ou surveillée si elle n’est pas détruite, mais le fait que la culture même, en tant qu’elle ne vit plus en chacun, le plus souvent réprime et collabore avec la répression politique de sa vitalité. Car, au contraire de ce qu’on croit souvent et qui est un effet de la culture répressive même, le meurtre ne traduit pas une défaillance ou une absence de la culture ; il devient praticable dans l’étouffante conformité qu’engendre un pieux respect pour des œuvres qui ne vivent plus en nous, alors qu’elles sont censées relancer l’esprit d’une communauté humaine à travers le temps. Et lorsqu’elles n’inspirent plus rien, il nous semble que les œuvres d’art nous sont indifférentes. Or, les humains cherchent des créations réussies, désespérément. Ils n’y sont jamais indifférents. Ni le beau ni le bien ne s’effacent entièrement des esprits, ni l’idée de leur unité dans l’art. Le courtier rêve d’écrire des poèmes.
La phrase de De Quincey, « Toute chose en ce monde a deux anses » (détournée d’Épictète, selon qui la poignée morale seule permet de la porter), signifie que le vase de la réalité dépend de la conjonction des deux manières de s’en saisir, l’éthique et l’esthétique. Nous avons deux mains. L’essai De l’assassinat considéré comme un des beaux-arts, conférence fictive prononcée devant une « Société des connaisseurs en meurtre », est sans cesse remanié entre 1827 et 1854 et publié d’abord dans une revue conservatrice écossaise. La Grande-Bretagne post-révolutionnaire en 1819 a voté des lois pour réprimer les mouvements populaires. Les sociétés politiques sont surveillées, les crimes fascinent à travers les journaux à grand tirage et les récits judiciaires. Le règne puritain de Victoria (1837) se prépare au moyen d’une moralisation extrême. Or, à y regarder de près, la « conférence » enveloppe une sorte d’essai symétrique dont l’enjeu est l’art considéré comme l’une des manières de tuer. L’assassinat est la négation de toute possibilité éthique, c’est-à-dire du monde commun tel qu’il est vécu. L’art surgit quand la morale dont il est hanté ne suffit plus à garantir une existence vivante. C’est alors que l’esthétique risque de détruire l’éthique, en laissant pourtant le vase à son imperfection ; son maniement devient malcommode et l’intégration des âmes physiques au quotidien devient incertaine, à la fois menaçante et menacée. Sans doute, l’art n’est pas moral en lui-même, et c’est pourquoi il fait violence à l’état des corps moralisés que nous sommes. Une morale désigne l’ensemble des règles de comportement sur lesquelles se fonde un régime politique donné. L’intensité du processus artistique correspond à une violence adressée au monde commun qui opprime autant qu’il est opprimé. La nécessité de « sortir du rang des assassins » (Kafka, 1917) ne perd aucunement sa valeur, car « la plupart du mal est accompli par des hommes qui ne se sont jamais décidés à être bons ou mauvais » (Arendt). Pourquoi cette indécision entre le bien et le mal, qui rend possible le mal au nom de la morale conformante ? Elle ne peut trouver son explication que dans l’impuissance répressive de la culture, dans l’effacement du geste véhément des œuvres qui contrarient l’époque. Et encore, les œuvres irritent souvent le monde contemporain de travers au point d’en mimer (et d’en accélérer) la destruction. Certaines avant-gardes, en décrétant l’épuisement de l’humanisme, non seulement ne l’ont pas détruit (il survit sous l’aspect d’un fantôme insistant et ambigu), mais ont échoué à créer un monde où la conformité cesserait de se retourner contre ses habitants. Elles ont rêvé un monde neuf, cohérent et bigarré, donc authentiquement vivant. Les meurtriers d’aujourd’hui ne se présentent pas au hasard comme ceux qui savent définir l’homme, positivement ou négativement ; ils sont conscients qu’une telle définition de la nature humaine est le fondement de la répression future. L’art a symptomatiquement connu et connaît de tels explorateurs criminels, au nom du futur. Car l’art sert aussi sournoisement au rêve d’épuration de l’humanité par elle-même.
Pourquoi De Quincey semble-t-il juger les crimes comme on jugerait des symphonies ou des tableaux ? Pourquoi prendre le risque du malentendu, s’il ne s’agit en rien d’une macabre complaisance pour l’esthétique du meurtre ? Saintsbury parle d’une « plaisanterie menée avec un tel sérieux que la frontière entre satire et admiration devient dangereusement mince ». Thackeray évoque « un paradoxe fantasque poussé jusqu’à l’extravagance » et Carlyle « d’étranges et périlleuses subtilités ». Est-il seulement question de « rendre le terrible attrayant » et de « jouer avec l’horreur comme un homme joue avec un jouet », comme le pense Chesterton ? Chesterton ajoute : « La plaisanterie est si élaborée qu’elle cesse presque d’être une plaisanterie. » Tout tient dans le presque. Le malaise moral qu’entraîne la perspective de De Quincey peut s’expliquer et jeter une lumière sur l’indifférence esthétique (la froideur de l’émotion) pour les images du crime. Le meurtre apparaît dans la réalité ; il se présente à la sensibilité de chacun. Il impressionne, relativement. Oscar Wilde simplifie le problème en disant que « la critique supérieure traite de l’art, non en tant qu’il est expressif, mais en tant qu’il fait impression ». Le crime réel n’est pas de l’art ; il impressionne cependant dans la mesure où il se manifeste dans le monde. Burgess (1967) dit que « le nuage d’Hiroshima » fut « un objet esthétique avant d’être un objet moral ». La forme spectaculaire du champignon atomique conditionne le jugement et l’enjeu se précise : il faut penser le conditionnement par lequel une impression (la force d’une forme réelle) engendre une expression (la pression d’un fond à communiquer, la traduction morale). Ce n’est pas l’expression du scandale éthique qui engendre l’impression de ce scandale, parce que l’expression n’est aucunement contrôlée par une intention authentique ; le mode d’apparaître d’une réalité détermine la couleur du jugement. En d’autres termes, le jugement appartient au monde des phénomènes qui fait pression sur ses intentions. La tension entre le choc et le cliché en tant qu’ils constituent « les deux aspects d’une même présence » (Susan Sontag) exige l’intervention des mots pour penser l’usure fascinante, l’indifférence esthétique (l’impassibilité dans la jouissance) de la représentation d’une catastrophe. Le cliché représente une réalité sans la pensée. Il prolonge le pur phénomène impressionnant et tient lieu de jugement. Il est le lieutenant de la morale imparfaite qui fait souffrir. Dans la théorie du sublime renversé par laquelle De Quincey pense le meurtre à la manière d’une scène, la terreur, la stupeur, l’intensité émotive paradoxale, une forme d’ivresse esthétique analogue à celle que provoque l’opium, entraînent une dissociation éthique et l’absence de la pensée que réclame néanmoins l’existence du crime. L’ambivalence morale du tableau de l’horreur est l’objet même du langage si « le fait de penser prévient le mal » (Arendt). En indiquant que le crime est « un art mineur », De Quincey souligne la discrétion du problème esthétique impliqué dans son événement. Et, en parodiant le langage d’un critique d’art qui prendrait pour thème une scène de crime, il suggère que le refoulement (l’affaissement) de l’impression que le crime produit, au nom de l’expression qu’il exige, prépare d’autres crimes. Pour que la morbidité de la contemplation de l’horrible, qui est le propre de l’assassin, ne gagne pas le spectateur, il faut que celui-ci ne visite plus le monde comme un musée des horreurs inavoué et considère d’abord le moment esthétique de son irresponsabilité. L’art lui-même doit se saisir de sa possible complicité avec le crime qu’il représente, s’il fait l’impasse sur l’enjeu de la représentation. Cet enjeu est une pensée. Aristote ne disait rien d’autre, déjà, dans sa Poétique : « l’instinct de représenter est implanté dans l’homme dès l’enfance ; une différence entre lui et les autres animaux étant qu’il est la créature la plus représentatrice, et par représentation il acquiert ses premières leçons ; et un plaisir non moins universel est ressenti pour les choses représentées. Nous en avons la preuve dans les faits de l’expérience. Des objets que nous regardons avec peine en eux-mêmes, nous nous réjouissons de les contempler lorsqu’ils sont reproduits avec une fidélité minutieuse : tels que les formes des animaux les plus ignobles et des corps morts. La cause en est encore qu’apprendre donne le plus vif plaisir, non seulement aux philosophes mais aussi aux hommes en général ; cependant dont la capacité d’apprendre est plus limitée. » La représentation d’une charogne ne doit pas faire de qui l’apprécie une charogne (une victime-bourreau) à son tour. Et l’art conspire au meurtre s’il croit seulement le dénoncer en le représentant. La co-habitation de l’art et de l’assassinat est la preuve que le premier trouve dans le second sa cause fondamentale, sa raison d’être et de disparaître « entre satire et admiration ».