Jack Kerouac, Mexico City Blues par Tristan Hordé
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
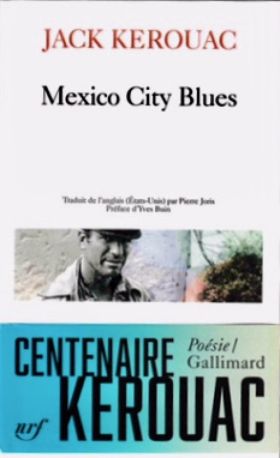
Le centenaire de la naissance de Jack Kerouac a remis en librairie plusieurs de ses ouvrages, dont Mexico City Blues, seul livre de poèmes édité de son vivant. Écrit au mois de juillet 1955, publié en 1959, Mexico City Blues a paru en français en 1976 (Christian Bourgois), traduit par Pierre Joris et c’est cette traduction qui est reprise. Le livre est une longue suite divisée en 242 chorus, qui se voulait en poésie ce qu’était l’improvisation en jazz. Le préfacier, Yves Buin, définit l’ensemble comme « Écriture spontanée qui exige la désinhibition, l’absence de censure, l’usage des processus de l’automatisme et de l’association libre ». Ces principes étaient pour l’essentiel partagés par un groupement d’écrivains réunis sous le nom de Beat Generation (nom introduit par Kerouac), qui comprenait notamment William Burroughs, Gregory Corso, Allen Ginsberg ; ils sont tous présents dans les chorus, avec un aîné, William Carlos Williams, et des écrivains classiques comme William Blake et Samuel Johnson, Pope et Oscar Wilde.
Les poèmes rendent aussi hommage à de grandes figures du jazz des années 1950, en particulier à Charlie Parker, considéré par Kerouac comme « le Musicien Parfait », « un grand musicien et créateur de formes », « Musicalement aussi important que Beethoven / Mais sans être reconnu comme tel ». Comment restituer le rythme du jazz avec des mots ? Kerouac use de vers très courts et abandonne souvent la cohérence, la logique du discours, ce qui peut correspondre à l’improvisation du saxophoniste ou du pianiste : « As-tu vraiment besoin / du mot juste / As-tu vraiment besoin / Évidemment c’est / Complètement stupide ». La question du sens ne doit pas se poser, ce qu’affirme clairement Kerouac, « Ne cherche pas le sens », et qu’il met en œuvre, par exemple dans ces vers : « Pan Matador / Pazatza cuaro / Mix-technique / Poop / Indio / Yo yo catlepol / Hurlement lune / Indien / Ville & Cité ». À l’improvisation qui n’est pas réglée dans le temps peut correspondre l’énumération, procédé très fréquemment employé dans les chorus ; mais elle est également imitée quand, dans une suite, un fil relie les mots : à partir de « aigre-doux » on passe à « chou », puis « soupe au chou » et « choucroute ». La traduction ne rend pas complètement compte de l’influence de la musique et il est intéressant de relire les poèmes originaux :
I know I am dead
I wont camp. I’m dead now.
What am I waiting to vanish ?
The dead dont vanish ?
Go up in dirt ?
How do I know that I’m dead.
Because I’m alive
And I got work to do
Oh me, Oh my,
Hello - Come in –
(dernière partie du chorus 235)
À côté de cet aspect, dominant, pour être en phase avec le jazz, Kerouac ne néglige pas des formes plus classiques, avec même celle du récit, par exemple pour rendre hommage à Charlie Parker. Cependant, le récit entrepris sur un sujet (« Mais maintenant je vais décrire / les fous que j’ai connus ») s’engage sur une autre voie, introduisant la mère, puis la langue se dérègle (« et plouffant et / blouffant ») et la possibilité du récit est rejetée, il n’a pas sa place dans les chorus : « c’est facile de devenir fou / parfois je deviens fou. Ne peux continuer mon histoire, / j’écris en vers. / Pire / N’ai pas d’histoire, rien que des vers ». Rapportant à sa manière un extrait du Satiricon de Pétrone, Kerouac le termine par « Est-ce vrai ? » et conclut « Petronius Arbitum - / élégant pédé, / mon cher » [pour Petronius Arbiter].
Toute la vie de Kerouac s’engouffre dans Mexico City Blues, les souvenirs d’enfance, la mère et le père, la nécessité de l’écriture, les angoisses. Beat signifiait « brisé, défoncé » et, dans la langue des exclus, être beat impliquait le refus de la société américaine. Cette mise à l’écart volontaire a été liée pour Kerouac à l’usage de la drogue et, surtout, de l’alcool, et a entraîné une difficulté de vivre qui s’exprime crûment parfois dans les chorus, « Merde et misère / Je souffre absolument / attendant sans merci / Que le pire arrive, / Je suis complètement perdu / Il n’y a pas d’espoir », « Et tout est foutu sur cette scène ». Une sortie existe cependant, la tentative d’atteindre le Vide et le Rien — mots récurrents dans les chorus — du bouddhisme, religion à laquelle Ginsberg l’a initié. Le livre est nourri de références à la religion et ce n’est pas l’aspect le plus attachant aujourd’hui. Des vers ramassés rappellent le fond de la doctrine, « c’est que / rien / naît vraiment / ni meurt », doctrine qui est condition d’équilibre : « Ce qu’il me faut Solide dans / Ma tête l’image du Bouddha ». Les musiciens admirés par Kerouac ne peuvent qu’être associés au bouddhisme et, d’abord, le premier d’entre eux, « Charley Parker ressemblait à Bouddha ». Écrire à propos de la religion est par ailleurs présenté comme la tâche la plus utile, « Alors que dois-je faire / À part écrire cette poésie / Instructive ».
On peut ne pas apprécier ces chorus qui exhortent à « suiv[re] le vide » et à lire des dizaines de fois « Tathagata », l’une des épithètes de Bouddha ; on (re)découvre avec beaucoup d’intérêt le lyrisme sans limite de Kerouac s’essayant avec succès à écrire comme s’il improvisait au saxophone alto : il faut l’entendre lire ses chorus. Yves Buin dit justement que « coexistaient en lui la nostalgie précoce de l’infini et la marginalité libertaire ».