La Grande Dactylographie, Ludwig Wittgenstein par René Noël
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
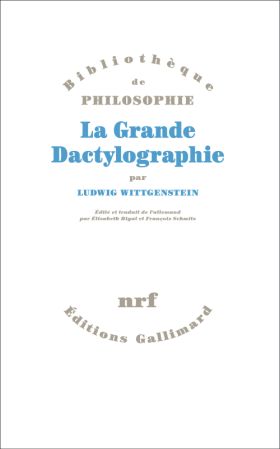
Une obscurité positive
La Grande Dactylographie est un livre en chantier, délaissé par Ludwig Wittgenstein, né en 1889 à Vienne et décédé en 1951 à Cambridge, qui figure un état intermédiaire de sa philosophie, entre l'édition du Tractatus philosophicus en 1921, seul livre publié par lui de son vivant, et Remarques sur les couleurs, De la certitude, publiés par ses exécuteurs testamentaires qui ont pour objet la philosophie de la psychologie, ces deux derniers écrits quasi prêts, quelques mois, quelques jours seulement avant la fin de la vie du philosophe autrichien, à être publiés par ses soins, incarnent une ultime évolution de sa pensée.
Projet de livre que Wittgenstein élabore et dicte, La Grande Dactylographie, conçu après son retour à Cambridge en 1929, reprend la partie traitant des fondements, des règles des mathématiques de La grammaire philosophique, la première partie étant centrée sur la grammaire, la compréhension, l'intention, la croyance, la signification des propositions. Il présente une version programmatique, synthétique des Recherches philosophiques, se veut un ouvrage de philosophie complet traitant des usages de la langue propres à accoucher d'un langage, de propositions, livre que le philosophe autrichien renonce in fine à finir de corriger et à publier, laissant le manuscrit avec ses hésitations, son inachèvement tel qu'il nous est proposé aujourd'hui à la lecture.
Pour établir une pratique, les règles ne suffisent pas, il y faut aussi des exemples (De la certitude, p. 139). Partant des faits, adoptant une méthode inductive, le second moment de la pensée du philosophe viennois est influencé - en dehors de Bertrand Russel et de Gottlob Frege dont les livres ont motivé l'écriture du Tractatus - par l'esprit de G. C. Lichtenberg, Karl Kraus, Lewis Caroll, Sigmund Freud, par le Witz, le mot d'esprit grammatical qui permet d'argumenter et de définir, selon de nouveaux critères, la profondeur.
Les usages des mots, des expressions de la langue ordinaire, dynamique, allant à la rencontre des propositions du Tractatus auxquelles Wittgenstein n'a jamais prétendu renoncer, sont la substance en mouvement, la vie même exprimant le devenir et la liberté de la langue. Autrement que G. W. F. Hegel qui mêle indistinctement parler courant et langue philosophique, le philosophe viennois s'efforce de clarifier le sens des expressions afin de désensorceler les usages des mots, de les rendre transparents et aussi immédiats que la lecture des propositions liées entre elles, mais statiques dès lors qu'elles ne sont reliées au monde des faits que par un principe de réalité qui imite un principe d'identité qui gouverne l'histoire de la philosophie dans des sociétés où les opinions sont proscrites. La critique toujours urgente de ce même nécessairement déterminée par les atavismes, les modèles d'éducation, ne doit-elle pas tenir compte de ces mouvements de fond des modes d'organisation des pouvoirs orientant les règles des différents langages et leurs contradictions, de la même façon qu'en balistique, pour atteindre son but, il faut viser ailleurs que vers le cœur de sa cible ?
Les voies et détours des sens, des significations des mots et des expressions, interprètent le monde à l'exemple de l'exécution d'une partition musicale, Wittgenstein s'appuyant souvent soit sur la dénomination des couleurs, soit sur la musique de concert pour faire entendre les moyens et les buts de sa philosophie. À ce titre, les usages de la langue participent de l'agir, orientent l'action, font l'histoire et dessinent le temps, les voies de labyrinthe au même titre que les étymologies, les associations de mots, les morphologies de la phrase étagent en son sein les niveaux et les évolutions de la langue, d'une façon décisive. Wittgenstein a une pensée originale, qui traverse les générations, parce qu'elle libère d'une façon inattendue la question de l'interdépendance des phénomènes constituant un fait, tout coule d'Héraclite, lié aux contextes d'énonciation toujours singuliers d'une expression, c'est ainsi que s'établit une temporalité, une lecture du temps singulière à l'abri du relativisme et du solipsisme, de conceptions de l'histoire humaine réduite à la juxtaposition de concepts fondamentaux déroulés, aussi bien que la ficelle d'un yo-yo, de Parménide à Husserl, de haut en bas, linéairement et séparée radicalement des histoires des hommes et de l'humanité de l'homme.
L'accord entre la proposition et la réalité n'est un accord entre l'image et ce qu'elle représente que s'il est analogue à l'accord entre une image du souvenir et l'objet présent (p. 102). Les propositions sont des images équivalentes à des pictions telles que Jacques Roubaud les définit. Les Pictions désignent des points nodaux, limites, sensibles et intelligibles, aux confins du visible et de l'invisible, du dicible et de l'indicible et se suffisent à elles-mêmes. Images sans images, elles n'ont pas besoin d'en référer à une surréalité, à un impossible pour exister, le noir, bloc de mémoire sensitif qui les constitue, d'une obscurité positive, se décline en analogies multiples, innombrables que les paroles et les écrits maintiennent en vie en y ajoutant et en les transformant.
Qu'en est-il des propositions se trouvant dans des poèmes ? Ici, on ne peut certainement pas parler de vérification. Pourtant ces propositions ont un sens. Elles entretiennent, avec les propositions pour lesquelles il existe (une) vérification, le même rapport que les scènes de genre aux portraits. (p. 103) Wittgenstein établit bien la distinction entre philosophie et poésie. La plupart du temps, il dit ne pas comprendre, dans le sens philosophique qu'il donne à ce mot, la poésie, par exemple à la lecture de poèmes de Georg Trakl. C'est que la poésie a une liberté d'action considérable.
Le non-sens que l'on obtient, lorsqu'on aligne des sons qui ne permettent de reconnaître ni des mots familiers ni une quelconque syntaxe familière. La seule chose qui est préservée dans ce cas est l'alphabet ou le système phonétique. (Dire et ne rien dire, Jacques Bouveresse, p. 101). Certains poètes reconnaîtront ici les avant-gardes, le constructivisme, le surréalisme, affirmant que l'alphabet est la seule et unique contrainte. D'autres, dont Emmanuel Hocquard, trouvent dans la pensée de Wittgenstein un appui pour s'autoriser à actualiser les contenus des formes héritées. Certains y lisent un sauf-conduit offert à la poésie concrète, orale. Wittgenstein se serait peut-être tenu à titre personnel proche des poètes objectivistes américains, de Louis Zukofsky, liant le sujet à leur siècle, lecteur lui-même des poèmes Johann Peter Hebel et de Chritian Morgenstern, mais cela reste indécidable, tant le poète de Cambridge ne feint pas d'accorder à la poésie une autonomie effective, parente de celle que lui-même observe du point de vue philosophique.