Muriel Pic par Jacques Barbaut
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
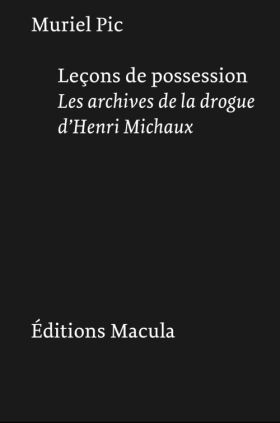
S’introduire dans ces Leçons de possession par le biais d’une scène intime, barrée, secrète sinon sacrée, rue Séguier (Paris VIe arr.) : Henri Michaux, méditant, est assis dans un fauteuil au motif fleuri à côté de la cheminée dont on aperçoit les pinces à feu, tel que l’a photographié en 1964 Gisèle Freund pour l’un des rares portraits autorisés, reproduit page 189. La séance peut commencer…
Entre la publication en 1954 de The Doors of Perception (Les Portes de la perception) d’Aldous Huxley, qui expérimente les drogues, la mescaline en particulier, sous la supervision d’un docteur, et celle de L’Herbe du diable et la Petite Fumée : une voie yaqui de la connaissance de Carlos Castaneda en 1968, s’insère la décennie psychédélique des intoxications volontaires tentées par Henri Michaux.
Ces « archives de la drogue », consistant en quelques cahiers et liasses de feuilles volantes, sont les notes manuscrites prises durant les expériences d’« intoxication » (parfois juste après), et sur lesquelles Michaux revient régulièrement, même de nombreuses années plus tard, pour composer les livres situés entre Misérable Miracle (1956) et Les Grandes Épreuves de l’esprit (1966), essentiellement.
Ces livres dits « mescaliniens » sont commentés et relayés abondamment par la littérature médicale et scientifique, tandis que « la réception littéraire s’avère plus timide ». (p. 20)
Pour dire les flirts souvent poussés entre médecine et drogue, ou science et poésie, passons par le médecin aliéniste Jacques-Joseph Moreau de Tours, évoqué tout au long de ces Leçons, qui découvre le cannabis lors d’un voyage en Orient, décide de le faire connaître et d’en étudier les effets, en créant à Paris, en 1843, un club pour amateurs qui se réunit en l’hôtel de Pimodan, sur l’île Saint-Louis, où, afin de goûter le dawamesc, une pâte sucrée à base de haschich, se retrouvent, un temps, Daumier et Delacroix, Dumas et Nerval ; ajoutons Théophile Gautier, qui publiera Le Club des hachichins (1846), etCharles Baudelaire, Les Paradis artificiels (1860).
Là, Moreau de Tours conduit ses expériences personnelles et collectives : selon lui, les effets du haschich étant similaires aux symptômes de la folie, la prise de la drogue s’avère un moyen privilégié d’exploration du psychisme humain — le résultat de ces études étant synthétisé dans son traité Du haschich et de l’aliénation mentale (1845).
Si les recherches médicales sur les drogues ont commencé au début du XIXe siècle, elles ont abouti dans les années 1960 à une révolution psychopharmacologique, soit à l’élaboration puis à la commercialisation « d’une large gamme de médicaments psychotropes : neuroleptiques ou antipsychotiques, anxiolytiques (dont benzodiazépines), antidépresseurs, somnifères, qui deviennent un marché porteur de l’industrie pharmaceutique ». (18)
Les labos ont besoin de testeurs volontaires, de cautions intellectuelles ou artistiques, tandis que Michaux, explorateur méthodique des continents noirs, intouchés, amoureux de l’interdit, désire éprouver — il se définit dans les notes de la drogue comme un « cochon d’Inde investigateur », un « cobaye obéissant », un « lapin tordu » —, se procurer aussi des doses de produits rares, hautement surveillés. Ce sera donnant-donnant : drogue contre texte et vice versa.
« L’écrivain sera cité dans de nombreux travaux psychiatriques et thèses de médecine, ses texte reconnus parmi les meilleurs documents sur l’hallucination toxique. » (45)
Quand le poète se retrouve le sujet d’une étude savante, publiée en 1963 par les laboratoires suisses Sandoz, consacrée aux hallucinogènes, il en ressent une « bouffée de joie ». (43)
11 avril 1959, Henri Michaux fait partie des premiers volontaires à essayer la psilocybine sous surveillance « de la faculté » — et les médecins, Jean Delay à leur tête, qui l’entourent de noter ses paroles durant la séance ;
à 15h55 : C’est indicible, on n’a pas le moyen de dire cela ;
et, à 17h : Je n’aurais pas pu dessiner car ça aurait dépassé le cahier.
Le 14, Michaux écrit au botaniste et mycologue Roger Heim, à l’origine de la réunion, pour une mise au point : « Que serait-il arrivé si j’avais été seul ? J’ai été formé dans la solitude, ne travaille, ne pense, n’écris, n’éprouve que dans la solitude et je me gaspillais en paroles, en des sortes d’explications pour étrangers. » (63)
Dès l’origine, précise Muriel Pic, « l’écriture de l’auto-observation sous drogue est tout autant un défi scientifique que littéraire et artistique ». (87)
Parmi les drogues essayées, la prédilection pour deux d’entre elles, soit, dans son vocabulaire usant d’apocopes (« Michaux met une majuscule aux noms des drogues », nous précise-t-on), le « Ha » et la « Mesc » — les distinguant notamment par ceci que « le Ha donne chute vers le haut (si je puis dire) » tandis que « la Mesc secoue et rejette en tous sens » —, le « H » pour Henri et le « M » pour Michaux, et parfois l’une après l’autre : « Ce fut comme un miracle sur un miracle » (« bloc petits carreaux »).
« Michaux apprécie le “ doigté optique ” du haschich, bon à étudier, et l’utilise aussi pour relancer les effets de la mescaline. » (67)
Mais qu’est-ce au juste qu’un miracle ? « une conviction qui passe dans un système nerveux » (208), répond Michaux qui en propose cette définition toute personnelle.
Ces notes, le plus souvent parcellaires — des mots ou passages restent aussi illisibles au sens strict, non déchiffrables, asémiques par ricochet —, jouent avec les limites de la signification.
Voici la retranscription d’un texte écrit après une prise de haschich, « La langue anglaise », trouvé dans le « cahier rouge » :
pourquoi j’ai un livre anglais que je prends [illisible] / c’est qu’être cette langue qui / parce que cette langue qui [illisible] parfois [illisible] / j’entends cette langue, [mieux] même qu’en temps / ordinaire cette langue renforcée et timbrée et / poussée par le souffle, qui est un [illisible] peut me / en somme de me trouver à l’étranger […].
Les difficultés extrêmes à noter « l’indicible », couplées au pénible déchiffrement ultérieur d’une écriture manuscrite « hirsute » (celle-ci se diluant, se muant parfois insensiblement en lignes plus ou moins zigzagantes), induisent ce que Muriel Pic nomme « la voie des paronomases » (p. 139), où Michaux crée à partir des (grâce aux ?) hésitations, des traces incertaines — ici dois-je lire « retentissement », « ralentissement » ou « rétrécissement » ; « saintement » ou « sereinement » (« liasse à détruire ») ? ; là « vigilant » ou « voyant » (« dossier vert ») ?
« L’illisible devient fécond dans ce qui peut être désigné comme une philologie poétique, où l’échec de la lecture devient une réussite de l’écriture. » (145)
Achevons par ces quelques thématiques, effleurées ici, mais notablement développées dans ces remarquables Leçons :
la cénesthésie, comprise comme l’attention portée à la vie organique et sensible (ou « l’espace du dedans »). Michaux en donne cette acception dans les archives de la drogue : « Je suis contemporain de la sensation », tandis que Muriel Pic écrit : « Michaux fait de l’écoute du corps une poétique » ;
la dépersonnalisation : « Ce sont les perturbations de l’esprit, ses dysfonctionnements qui seront mes enseignants » (162), soit aussi la volonté de connaître les Autres présents en soi, de se mettre dans leur peau, de « faire parler son fou » ;
la néologie induite par la volonté de traduire la nouveauté, les aberrations de tout ordre (la « grimaciation », les personnages « désauréolés »…) ;
le style, celui des drogues, celui du corps ;
le charme (« au plus vieux sens de ce mot ») ;
l’extase (érotique et spirituelle) ;
la transe…