Un Caractère en couples par Matthieu Gosztola
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
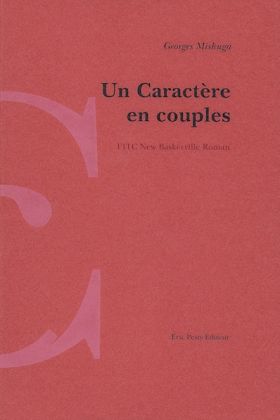
Dans « Langage quotidien et rhétorique sans éloquence », Levinas note : « On peut […] se demander si la pensée commence dans l’accueil du donné par la perception avant que le langage ne l’ait façonné. Le langage ne serait pas seulement appelé à exprimer – fidèlement ou infidèlement – une pensée préalable, tout intérieure : sa rhétorique ferait partie de l’acte intellectuel et serait l’intrigue même où se noue un ceci-en-tant-que-cela ; ceci-en-tant-que-cela au cœur d’un donné qui serait déjà monde, selon l’acceptation heideggerienne [...] ».
En cela, le langage se développe en nous, fait son inlassable chemin en chacune de nos cellules, invisible, avec le même naturel que l'habitude et l'oubli, tels que Lacan a pu les décrire dans « Propos sur la causalité psychique » : « L’habitude et l’oubli sont les signes de l’intégration dans l’organisme d’une relation psychique : toute une situation, pour être devenue au sujet à la fois inconnue et aussi essentielle que son corps, se manifeste normalement en effets homogènes au sentiment qu’il a de son corps. »
Georges Mishuga l'a bien compris. Aussi cet artiste genevois – qui pratique le dessin, la typographie, la vidéo et la musique, la fabrication de livres ou d'objets – veut-il réinventer le langage. Le réinventer, c'est-à-dire le faire apparaître dans sa structure propre. Et non pas dans notre structure intérieure avec laquelle sa prétendue structure finit par se confondre pour nous. Mishuga fait en sorte que le langage apparaisse, et ait une vie propre qui ajoute sa vie à notre vie ; il fait en sorte que le langage sorte de notre corps, de nos structures de pensée pour faire rejaillir sur nous, sur notre corps et sur nos pensées, l'évidence de sa vie, de sa malice et de son intrépidité – de ses manques, aussi.
S'il nous invite à réinventer le langage, c'est pour réinventer notre façon de percevoir le donné du monde. Et pour réinventer le langage, Mishuga s'y prend en géographe, en géologue, en archéologue, en amoureux. Il remonte le cours du langage, pour capter la première pulsation de lui, le langage ; celle par quoi le trait d'eau de pluie devient mince filet d'eau, sans jamais savoir qu'il deviendra cours d'eau, puis rivière, puis fleuve. Cette première pulsation, c'est celle de la lettre. Non plus envisagée dans la façon qu'elle a de s'accoler à d'autres lettres, pour former des mots, puis des phrases. Non : perçue dans sa seule entièreté. Qui, pour nous, apparemment, n'a aucun sens puisqu'il s'agit toujours pour elle – la lettre – d'être rejointe par d'autres lettres, car c'est seulement de ce fait qu'elle pourra trouver un sens et ainsi cueillir – a posteriori – sa légitimité. L'auteur considère que chaque lettre a une existence. Une individualité. Une humanité.
Mais Mishuga va plus loin, bien plus loin. Après avoir procédé de la façon que nous venons de décrire, il nous invite à penser chaque lettre non pas dans sa solitude, dans son entièreté qui est solitude (prétendument indispensable pour ce qui est de l'intelligibilité de son sens, celui-ci fût-il une seule parcelle du sens que recomposera le mot qu'elle contribuera à faire naître), mais dans la façon qu'elle a de pouvoir être liée à une autre lettre... par elle – intensément – élue, à ce point liée à elle qu'il n'est plus guère possible pour elle dans son existence, et dans l'existence de son existence, de revenir en arrière. On le comprend vite à la vision, page après page, de ce magnifique ouvrage (magnifiquement édité) : il n'est plus permis pour ces deux caractères – qui se sont mutuellement élus – d'être moins que deux, et de telle sorte, dans une étreinte de folle délicatesse, effleurement immobile qui autorise toutes les mobilités de l'esprit, de telle sorte qu'ils puissent devenir – enfin – un.
Une brume se lève de ces pages, érotisme diffus, qui tient aussi aux courbes indolentes et savantes des lettres, et qui réveille lentement, par sa fraîcheur, – sans rien brusquer –, ce passage d'un poème en prose que nous avons débusqué dans un Cahier manuscrit de Valéry : « La douceur de la chose effleurée répand dans tout l'être dont la main l'effleura […] une sorte de message d'inquiétude voluptueuse, qui, dans l'instant même, transforme le présent, l'aveugle sur le reste des choses, lui donne un penchant d'avenir, un avenir instantané sèche ou humecte la bouche, suspend le souffle, échauffe le visage, serre le cœur et fait du regard un chef-d’œuvre d'éloquence […] ».
Et les caractères réveillés par l'auteur, nous touchant par leur étreinte, par leur humanité soudain évidente, développent, en plus de la douceur inquiète car amoureuse telle que décrite (pour le secret de son cœur) par Valéry, et cela de la plus précise (quoique de la plus métaphorique) des façons, le « s'accorder à l'autre » tel que le définit Levinas dans « In Memoriam Alphonse de Waelhens » : « un s’accorder à l’autre, c’est-à-dire un se donner à lui […]. Autrui, qui à l’affection est unique et qui, de par cette unicité, n’est plus simple individu d’entre les individus, réunis dans un quelconque genre qui leur serait commun, l’unique qui précisément est autre à toute généralité, m’est lié [...]. Il ne saurait se représenter et se donner à la connaissance dans son unicité, car il n’existe de science que du général. Mais le non-représentable, n’est-ce pas précisément l’intérieur qui, apprésenté, est approchable ? »
Ce non-représentable, par l'étreinte infinie de ferveur et de douceur que composent les caractères ainsi superposés, l'auteur le rend – belle et douce sommation que chaque blanc de page met en scène – représentation, mais sans jamais faire en sorte que le non-représentable bascule dans le représentable. En somme, il s'agit d'une représentation qui est faite toute de non-représentable, et cela parce que jamais les lettres s'étreignant, les lettres amoureuses, ne troquent leur pure visibilité, et la beauté de leur apparition contre un sens qui aurait trait à une sémantique, simple ou complexe, affirmée ou balbutiante, une sémantique qui les pousserait à enfermer leur déploiement dans la rigueur de la logique et ainsi à ne plus être les vecteurs – enchantés et enchanteurs – de la musicale gratuité d'un don : le-don-de-la-présence, de-l'un-à-l'autre, de-l'un-pour-l'autre – le don sans donation que sont vivre-et-aimer quand vivre est avoir été rendu à soi-même, au réel ego, au plus pur, celui qui n'est pas captif de frontières ; avoir été rendu à soi-même, c'est-à-dire à l'indéfini (et qui pourtant a visage) de la beauté et à l'infini de la mer, et avoir été rendu à cet infini par une rencontre, et par l'éblouissement et l'émerveillement qui en ont découlé (desquels se lèvent ces vers de Péguy dans Eve, vers que nous citons – imparfaitement – de mémoire : Nos chemins vont dans les fraisiers Et parmi la glycine et le long des rosiers Avant de paraître au pied des cathédrales). Qui.en.ont.découlé.qui.en.découlent... Cet éblouissement et cet émerveillement tenant tout entiers au fait d'avoir pu connaître l'autre, et au fait de continuer, jour après jour, nuit après nuit, cette connaissance, qui est tout.
Continuer, comme un enfant ébloui marcherait au pied de la mer, et au pied des étoiles, sans chercher à brusquer les flots et le ciel, sachant que la mer et le ciel l'abritent, alors même qu'il n'est pas encore en eux.
L'enfant défait ses vêtements. Il avance un pied après l'autre. Ce sera tout à l'heure. Il sait qu'il n'est pas encore dans la mer, dans le ciel. Et, augmenté de cette connaissance, il sent en son corps que c'est faux. Il est déjà en eux. Ayant été appelé si fortement par le ciel, par la mer, il a conçu son corps à ce point comme une place pouvant être épousée par leurs contours (ceux du ciel, ceux de la mer – il aime se répéter ces noms communs qui pour lui sont des noms propres)... qu'il est devenu entièrement leur infini ; entièrement, mais peu à peu, sans même s'en rendre compte (tout s'est joué quasi à son insu : il ne se serait jamais imaginé...). Aussi, au moment précis où il entre dans le ciel, où il entre dans la mer, ne ressent-il rien d'autre qu'une bouleversante douceur, qui est celle que l'on éprouve quand l'on s'est rejoint soi-même entièrement.