Bête de cirque de Tiphaine Samoyault par Philippe Beck
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
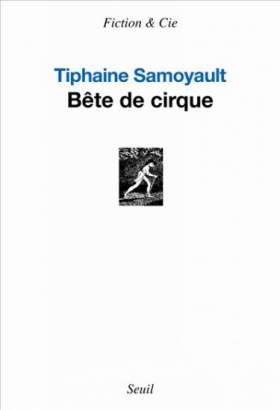
Le cirque de la paix
« Personne n'osait dire qu'il avait honte ni chercher les raisons de la honte. »
L'excès est l'un des premiers mots du livre singulier de Tiphaine Samoyault. On peut appeler ce livre un essai dramatique, intimement « salué par le poème », ou encore une autobiographie collective. Le poème est aussi ce qui n'apparaît pas dans la vie de tous, à l'instar du « e » muet de la femme, dit T.S. En esprit vigilant, elle détecte les signes de la tragédie commune dans la honte que pense son livre. Le « début de [s]a honte » tient dans le « fait de [s]e donner en spectacle ». Mais il ne s'agit pas seulement de la honte d'une personne entre mille, entre mille désirs de s'exprimer ; l'enjeu, c'est une sorte de honte commune, que le livre révèle. On peut l'appeler d'abord la honte de l'apparition. Cette honte d'apparaître est immédiatement liée à la honte de « faire la guerre sans la faire » (car la guerre implique l'ombre aussi) : on devra penser aux réalités de la paix civile des apparitions et des jeux d'apparition loin de Sarajavo, dans la guerre continuée par d'autres moyens, où s'estompe « la différence ami/ennemi ». (Samoyault sait bien les périls de la distinction de Carl Schmitt, comme les périls de sa disparition.) Qu'est-ce qui, dans la honte reconnue, affrontée par l'écriture, doit nous permettre de retrouver un « présent pur, du temps épais comme de l'argile » où l'on peut « laisser la forme de sa main » ? L'auteur a médité la force de la « main négative » et de la signature singulière ; on le vérifiera. Le deuxième mot important, une fois que la honte et l'excès ont été rapprochés aux limites de quelqu'un, c'est le mot « responsabilité », « notre responsabilité ». Or, cette responsabilité, entée sur un « devoir d'humanité », engendre un paradoxe : la « vigilance », la conscience des « deux certitudes contradictoires » (celle du « plus jamais ça » et du « plus jamais dans ça ») « nous » efface « de l'histoire telle qu'elle s'est toujours écrite ». La honte repose donc sur la difficulté d'apparaître avec responsabilité dans un monde sans ennemis fixes. Un monde où les ennemis disparaissent, et pas même dans l'ombre, est un monde qui annule « la possibilité de la résistance ». Comment apparaître, jouer du clair-obscur pour « rencontrer un moment l'histoire » ? Le drame du livre, c'est le drame de la relation entre une « génération précédente », « chargée d'oubli » pour agir, et une autre génération qui n'est pas « une génération perdue ». Le « réel hostile » continu est ce qui justifie de « traduire autrement la révolution » par la transmission, d'une génération à l'autre, d'un « mélange » (précieux comme le miscere d'Horace) entre « distance critique » et « empathie ». La nouvelle génération, cependant, ne dispose que d'une « participation incomplète » où l'apparition risque l'ambivalence ou l'échec de l'ambivalence, la « hantise » qui remplace « la peur ». « L'abstraction », dans l'action incomplète, c'est la hantise de la responsabilité, mais privée de la peur qui « intercède pour l'homme », comme peut dire un poète cité dans la prose sobre et tendue de Samoyault.
Il ne s'agit pas d'une nostalgie de la peur. La honte doit se « maintenir intacte », car elle est « une part de l'expérience » de quelqu'un, la teneur de la « pauvreté en expérience ». La honte est ce qui peut renvoyer la hantise à la peur. T.S. a « honte d'avoir voulu avoir peur » en allant à Sarajevo, et pourtant cette volonté renvoie à la conscience qu'en régime « sans peur » « occuper une place », c'est « la prendre à quelqu'un ». Pourquoi ? Parce que, s'il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de résistance des places ; il risque aussi bien de ne pas y avoir d'amis, de différents aimés dans « le cercle des amis ». Dans la génération qu'une honte peut raccorder à la peur qu'elle ne doit pas perdre de vue, quelqu'un (T.S.) manifeste « beaucoup de présence pour pouvoir [s']absenter ». (« Attendue nulle part, il me fallait être partout en partance. ») Cette disparition dans l'excès d'apparaître (ou cette apparition par excès de disparaître) a pour cause la honte de ne pas disposer d'ennemis. Or, on parvient à être « moins dur envers soi », envers la peur qui sommeille dans la honte, en domptant la hantise de n'avoir pas d'amis. Il n'y a « pas d'intérêt à se transformer en fantôme », à ne pas apparaître et à « jouer à se faire peur ». C'est que « l'héroïsme du quotidien » (Pavese) exige un « héroïsme résistant » (malgré le défaut des « figures héroïques »), qui est aussi un courage, une « joie », une « tranquillité » de ne pas disparaître dans une « continuité » des générations. La fin de la « gêne » et du « manquement » est à ce prix. En attendant, la chance est liée à la disposition que précise le livre : une mélancolie sans nostalgie. « Pourquoi tout avait-il été recouvert par une mélancolie définitive, nos actes comme notre pensée, comme nos manières d'aimer, de procréer et d'écrire (...) dans le ressassement de nos gestes plutôt que dans le dépassement de soi ou le renouvellement de nos vies ? » L'« origine commune » ne se trouve pas seulement « dans des formes plus ou moins réussies de convivialité ». (« La conversation n'était pas tout. ») La « honte » permet d'accéder à un « temps ralenti » commun, qui suspend l'hypothèse de la convivialité et semble individualiser l'expérience quand elle renvoie au sort de tous : « Ma honte n'était pas honte de quelque chose ou de quelqu'un mais une honte inassignable qui ne pourrait pas s'atténuer. » La honte, c'est « l'horizon collectif des générations nées après », mais sans elle la hantise oublie la peur qui donne son sens indéfini à la responsabilité humaine en lui restituant un « plein présent », une possibilité d'aimer dans la résistance. La « tâche à venir », c'est encore « la lutte au cœur de la guerre, pour établir le lieu où la guerre s'arrête et où, de fait, la langue change ».
Pourquoi est-ce que la prose de Samoyault désigne l'oscillation d'une génération entre la métaphysique et la poésie ? Parce que les « nés après » se divisent entre ceux qui apprennent la peur et ceux qui ne l'apprennent pas. Dans la peur, la poésie est « tendue vers l'autre », donc proche de la politique qui, pourtant, « se contente de composer avec ce qui existe, pas avec ce qui manque ». La poésie est ce dont « on ne doit pas avoir honte du tout » : « La présence de la poésie, d'un tremblement des ordres et des frontières, nous permettait d'être comme un autre et toujours un peu deux, comme si nous étions dans la seule compagnie d'un feu. » Par « le désir » qui transit sa langue, la poésie conjoint en puissance a) la politique dont elle sort et b) le manque dans « le vent de l'événement ». La métaphysique dispense du feu du désir qui anime la poésie ; elle dispense d'une communauté de lutte et fournit une « vie sans résistance » (Augustin, de civitate dei). L'orphisme (le vol prométhéen, selon Pausanias plutôt qu'Ovide) ne fait pas une politique. Mais la poésie se pratique aussi contre un dogme orphique, s'oppose à l'ambition de changer le monde au lieu de changer des dispositions dans la langue. La poésie est ce qui interdit l'imposture et permet, avec l'amour et l'amitié, « l'échange des places » : l'échange n'est pas l'équivalence des mots et des places et c'est par lui qu'une paix dans la langue « maintient des brèches, des voies par quoi quelque chose s'écoule ». L'idée de la prose, c'est la poésie, et l'exactitude du poème exclut la synonymie sans exclure l'échange : « la synonymie est ce qui enclenche la guerre », car c'est la concurrence des mots non échangeables qui crée l'inexactitude violente, le conflit des places et des paroles. T.S. dit : « avec mes amis, vers qui mon attention se trouve de nouveau dirigée, je peux échanger ma place, non parce qu'ils sont pareils que moi, mais dans ce qui les rend différents (...) Ce sont nos différences que nous essayons d'échanger. » Une poétique de l'amitié détermine la prose de la vie, comme une amitié pour la poésie permet d'échanger les places différentes et singulières, entre « la voix » et « le livre », le flux et la loi, « ni dans la loi ni hors-la-loi ».
Reste « que tout est encore ouvert, comme d'habitude » : l'idée de l'échange ne fait pas l'échange et chacun sent « la ressemblance entre l'amour et la guerre », que l'idée de la poésie ne réduit pas (elle n'est pas seule).
La non-synonymie, la différence dans le désir de l'échange, la pratique de la non-équivalence des termes, des paroles, ne fonde aucune paix profonde dans le monde comme il va. Le cirque, le lieu du spectacle des paroles et des apparitions, est comme le ventre, qui « protège » et « bloque aussi » ; c'est un « siège » où les différences équivalentes (les indifférences) sont comme protégées par leur concurrence. Entre « protection » et « oppression », l'amour comme la poésie « invente » des « rituels » ou des « formes ». L'amour se fait guerre ou haine quand son objet est le « voisin immédiat », le proche, l'équivalent ; avec lui, la langue se fait « de bois », qui encercle en s'enflammant ou en noyant. L'identité de l'équivalent se fait haïr. Inversement, « une phrase violente et vraie », à hauteur de la guerre persistant dans l'amour, se fait aimer parce qu'elle « donne une assise » à l'autre. Tant que la guerre ne cesse pas, tant que l'équivalence menace de remplacer la différence, « l'usurpation » (l'ambivalent échange des places) devient « imposture » et renforce l'absence d'assise de quelqu'un, le « vide rendu à l'informe ». T.S. réaffirme ainsi le principe de Keats, ou le principe de l'impersonnage : « l'appropriation de traits de caractère, d'attributs et de comportements appartenant à autrui », cette hypocrisie, ce jeu, est la disposition au poème, au discours qui disparaît pour apparaître. Keats dit : le poète « n'a pas de moi, il est toute chose et il n'est rien ». Or, c'est bien le poème ou la poésie, « tremblement des frontières », qui autorise à « sortir » des « cadres fixés, à se mélanger, à devenir inassignable [comme la honte même], irrécupérable et distinct », quand « l'imposture » est ce qui empêche de « se mouvoir » et de « respirer ». Ce que le drame révèle par l'essai apparaît alors : que l'imposture peut aller avec l'anonymat, la disparition dans « les livres des autres », par « empathie ». L'impersonnage ne disparaît pas, il signe, et l'empathie peut bloquer la signature si elle fonde la honte « d'être soi » : « la lisière » est « ténue entre devenir double et se trouver sur le point de disparaître ». L'écriture est signature : « devenir écrivain serait une façon de m'engager sans que quelqu'un échoue à ma place ». L'écriture suspend l'échange en vue de l'échange, en vue de l'autobiographie de tout le monde, indisponible pour l'heure.
Naturellement, le fait de s'en tenir à soi, à la place apparente de l'écrivain, se paie d'un siège possible, d'une « solitude armée », d'une « assignation à résidence », en un mot : d'une guerre qui ne dit pas son nom, préférable à la paix violente de la disparition et de l'anonymat. La question de l'usurpation honteuse et mobile revient d'autant plus sûrement que l'imposture de ne pas « se mouvoir » dans le lieu de sa propre signature tend à la remplacer. En signant tranquillement, je risque « de ne pas avoir honte de ma honte ». L'écrivain comprend alors qu'impuissante à « ne pas avoir de langue à soi » dans « l'espace de la place attribuée » elle ne peut « trouver de raisons » qu'en elle-même. Elle affronte « l'écriture qui n'efface pas aisément l'individu, même derrière la langue commune ». Le passage des frontières, que la poésie propose ou suggère utopiquement, voilà ce que l'individuation risque toujours de compromettre, à cause de la guerre continuée entre les êtres, les assiégés. En signant (en marquant l'apparition), je rencontre la guerre, le reproche : « Il faut toujours que tu te fasses remarquer. » Le cirque est le cercle où « chacun » peut devenir le « singe savant » en acceptant de se distinguer. « La puissance de soi sous le regard d'un autre » implique le cirque et son chaos déterministe, sa contradiction guerrière, la « nostalgie » au cœur de l'affrontement : « il arrive que plus on cherche à se distinguer des autres, plus on a honte de ne pas leur ressembler, de ne pas être assise au milieu d'eux. » La honte de la participation incomplète s'expose maintenant au désir d'équivalence dans l'imposture et « l'adoption d'un style ». Qu'est-ce que ce monde théâtral, ce « zoo où chacun » montre « l'autre après l'avoir enfermé » ? C'est un ensemble de cris sous la différence des styles soumis à l'usage : « On continuait à avoir peur de tout ce qui s'écartait des formes et des normes mais on en avait fait un jeu intégré et intégral où chacun était susceptible de devenir celui que l'on montrait du doigt en rigolant. » Cela veut dire que la loi est celle d'une extermination sournoise, d'une production de monstruosité, un système des disparitions violentes. Le monstre est l'exception qui confirme la règle. Comment, dès lors, aimer le cirque, aimer le monde ? Comment « ne pas rester au milieu de la piste du cirque » ? Le cercle de lumière met « tous les corps sur le même plan », et le monde est un cirque sans limite, le cirque de l'apparition. Comment « trouver une issue dans un endroit rond » ? Il faut accepter sa rondeur : « en sortir », c'est « s'en sortir » grâce à « la réflexion de soi dans l'autre ». Le cercle, la « piste » des apparitions devient « à la fois le temps, l'espace et la relation ». L'amour permet l'apparition dans l'échange des places, « l'imitation » sans équivalence, toujours exposée à l'imposture non réfléchie (la singerie envahie ou le mime assiégé). Voilà donc quelques leçons précieuses de ce livre ferme, signé, sans ironie (si l'ironie « fait de celui qui la pratique avec un art extrême un qui est déjà mort »). Il n'est pas excessif de dire que Bête de cirque tire sa force d'une idée du poème et de la disposition poétique, par « balancement entre soi et une idée de soi » : celle de « l'araignée superlative dont les hautes pattes feront du corps un abri assez large pour accueillir du monde et dont les fils se tendront suffisamment pour faire des ponts ». Cette araignée-balançoire ressemble beaucoup à l'araignée d'eau de Coleridge, qui n'oublie pas « le battement » et l'appui aux temps faibles ; elle diffère de la bête qui, dans « le cirque des familles », dans « la communauté » cherchée et vite légendée, « se dresse » et se laisse désigner en oubliant le risque de disparaître. Il faut bien consentir à un cercle autour de soi (le contraire d'une « prison »), un voisinage neuf, par le « tremblement » et non l'effacement des limites. Ce consentement ou cette éthique doit fonder « une communauté qui n'inclut ni le narcissique ni le bourreau, car elle est formée de ceux qui ont besoin d'autres « moi » pour survivre. » Cela s'appelle aussi aimer : « donner ce qu'on n'a pas » à ceux qui en veulent. Il y faut sans doute une honte neuve, la honte de la victime, du relecteur qui rêve de « tourner la page » pourtant, la honte du « juste devant l'injuste ». Le secret se dévoile dans un paradoxe qui fait aussi le prix de la « révolution poétique » : « la honte, c'est la disparition du regard », quand « le corps sans yeux regarde ». Il faut un tel regard pour convertir la lumière, car « la guerre privait donc de lumière mais elle apprenait à la chercher ensuite dans tous les tunnels, dans les endroits toujours à l'ombre, dans les replis de l'être ». C'est pourquoi la honte s'appelle enfin « la mémoire du présent », « une lumière braquée sans pudeur sur ce que d'habitude nous ne voulons pas montrer ». On comprend qu'« on a honte parce qu'on a appris quelque part à ne plus rien cacher ». La perte de l'ombre rend possible une lutte lumineuse pour la paix des échanges, « proches de l'animal, mais séparés de lui, quasiment libres ».