Déplace le ciel de Leslie Kaplan par Anne Malaprade
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
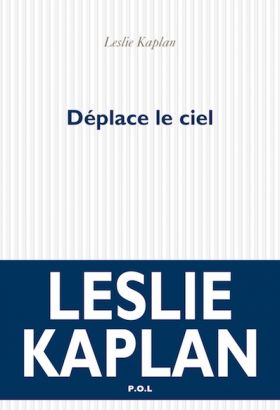
Leslie Kaplan déploie ses livres selon un mouvement toujours ample et généreux : L’Excès-l’usine, Le Livre des ciels et Le Criminel formaient une sorte de trilogie fondatrice, six romans participent de la série Depuis maintenant. Cette fois, c’est vers le théâtre (pour le théâtre constituerait une direction et un mode d’emploi trop autoritaires) et vers les actrices Frédérique Loliée et Élise Vigier qu’elle se tourne avec Toute ma vie j’ai été une femme (2008), Louise, elle est folle (2011), puis, aujourd’hui (demain en fait, puisque la pièce, créée en novembre 2013 à Cavaillon, est montée jusqu’en décembre au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis), Déplace le ciel.
La structure est aussi simplement évidente que chez Beckett : deux voix venant de nulle part, un décor traversé par toutes les paroles, les pires comme les meilleures, banales, expérimentales — « un bar, une télé » —, un objet — « un ordinateur » : de quoi faire du tout à partir du rien, du vide et du plein, du creux et de l’intensité, du rêve malgré le réel. L’important est de trancher entre ces modalités. On peut certes traîner la douleur et la mort, les répandre, s’y confondre, s’y noyer. On peut aussi leur échapper à partir des mots, de ceux qui, adressés, destinés, manifestés, écoutés donc, deviennent paroles. On prend alors appui sur la phrase, sur ses articulations. On monte, on gravit, on saute, et c’est soudain un autre ciel qui se déploie, qui se déplace, illumine et réfléchit la terre. Il suffit d’un écart pour qu’un travail vivant (aimer, découvrir, jouer, penser) donne souplesse et liberté à la respiration du sujet, et place ses étoiles intérieures selon une constellation inédite. Les voix sont ici désignées par des lettres, F et E, mais c’est la typographie qui discrimine les échanges, rythme le dialogue, rapporte les propos télévisuels ou radiophoniques. Caractères italiques pour l’une, romains pour l’autre. Le dialogue tourne autour d’un point essentiel. Quoi, comment, à qui dire ? Pourquoi s’adresser à l’autre plutôt qu’à soi-même ? Contre qui, avec qui parler ? Que faire du silence lorsque les signes le cernent ? Utiliser, jouer, ou se jouer des mots et de leur caractère arbitraire ? S’en moquer, s’y lover ? Comment aller du français à l’anglais, passer d’un monde à l’autre ? A quel tempo voyager du féminin vers le masculin, de l’ici vers l’ailleurs ? Et pourquoi ne pas offrir à la parole ce que la chanson, la ritournelle, la mélodie apportent de décisif ? Quels accents intimes donner à sa langue ? Selon quelle immensité intérieure habiter les phrases des autres ?
Le titre de la pièce n’est pas un constat, encore moins un ordre. Déplace le ciel : ce sont les mots du désir, la formule de cette force intime qui permet à chaque sujet parlant de porter sa question jusqu’à l’Autre, tout en modelant un monde commun qui pourrait accueillir la diversité des altérités sans écraser les différences. Terre, ciel, villes, champs, animaux, hommes, femmes, enfants. Les vaches, les serpents et les singes : les animaux que donc nous sommes, ou ne sommes pas, ou plus. Pas de ciel dans ce bar, aucun ciel à la télé, et encore moins dans l’ordinateur : l’infini est dehors et immanent à la voix, support d’une phrase sans majuscule ni point qui a toutes les audaces, toutes les fantaisies. On rit avec F et E, sans jamais rire d’elles, puisqu’on n’en sait pas plus que celles-ci. On partage et reconnaît leurs interrogations et leurs doutes. La transgression ne consiste pas à montrer sur scène certaines parties intimes de son corps, à choquer, à révéler, à exhiber ce que l’on croit devoir cacher : la télé s’en charge, merci bien. Cette tentation reste un geste qui ne se constitue pas comme acte. Ou un acte raté qui n’a rien d’une création. Cependant certaines phrases — à entendre comme les modalités mélodieuses propres à une pensée chantante — déploient, déconditionnent, déplient l’humain, et font surgir des possibles. Un autre ciel, du ciel dans le ciel, du mouvement dans le décor, un coup de vent, et une autre respiration anime la vie. Ainsi E n’est plus prisonnière de sa recherche obsessionnelle, elle s’est déplacée, s’est écartée de sa douleur. L’a non pas étouffée mais déréglée. Au début de la pièce, cette voix féminine ne peut rien dire d’autre que le manque de Léonard. Au fil de son déplacement, elle fait l’expérience d’un manque généralisé, et liste tout ce qui l’arrache à elle-même : la série des maux qui la renversent, l’ensemble des hallucinations qui confisquent sa singularité. En perdant ses repères, en heurtant sa propre passivité, elle s’y prend autrement avec les mots, avec F, avec les hommes, dans l’écoute et l’échange bienveillants. Léonard, pas plus que Godot, ne réapparaît. Et pourtant le désir de plaisir, comme le plaisir de désirer chanter, parler une langue étrangère, découvrir la langue de Shakespeare ou de Faulkner, voyager, rêver, la possibilité de dire non de mille et une manières, sur tous les tons, dans le bruit et la fureur, et la joie aussi — tous ces désirs se déterminent : le ciel est grand ouvert, il suffit, lorsqu’on a retrouvé l’énergie pour aller vers le monde, de sortir du bar, d’éteindre la télé, de fermer l’ordinateur. « déplace le ciel/il n’y a pas de solution/il n’y a pas de résolution/mais une chose est sûre ma belle/le monde est grand ouvert/et il n’y a qu’une chose à faire/entrer dedans, direct/entrer dedans direct ». Sans virgule donc, sans pause, sans arrêt, sans recul : déplacer son corps jusqu’au bleu du ciel, y aller, en anglais et en français, dans toutes les langues, pour que circulent les émotions, la pensée et les mots. Des idées jusque dans les choses, les choses dans les mains des hommes, afin que vive l’étonnement, et que la parole réponde à l’affect par la pensée, la pesée des mots, l’élan des corps. En attendant Godot finissait sur une immobilité interminable*. Déplace le ciel fait le choix du mouvement et du départ, puisqu’on n’a qu’une vie, dans ce monde-ci, et que c’est " depuis maintenant " qu’il faut les inventer, avec ou sans Léonard. Une sorte de réalisme intégral et littéral, par lequel le corps de la langue s’éprouve comme justesse et vérité.