Du rock, du punk, de la pop et du reste de Jean-Michel Espitallier par François Huglo
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
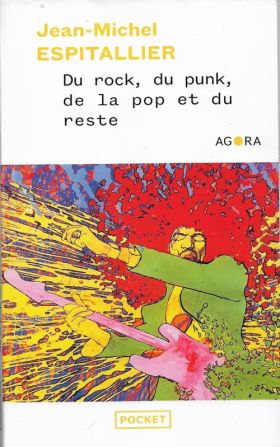
Cela commence par du concert (l’intro : « Billetterie », le chapitre 1 : « Attente, apparition, première partie, rappel ») et finit (« The End ») par des réécoutes solitaires « pour la trois cent millième fois » qui rappellent le grand acquiescement du monologue final de Molly Bloom —« oui »— et l’équation amoureuse de la fin d’Abbey road. Batteur, Jean-Michel Espitallier balance, et passe du live à la biblio-discothèque, de l’anecdote perso (en plus de cinquante ans de rock, il en a vu !) à l’analyse historico-sociologique, de la critique de la mythologie rock à la dévotion et au désir de sacré. Même si toute cette histoire n’est que « collages partout, bordel sans nom », mélange, métissage, et « comme chacun l’a deviné, moi et les casiers bien rangés… », il faut bien nommer les choses. Le titre le fait : rock, punk, pop, et le reste. Le texte aussi, dans son courant continu, son flux. Il lui arrive même, passage à l’alternatif, de les opposer.
Il y a bien une « fracture entre rock et pop (et leurs centaines de sous-genres) », dichotomie « sans doute inaugurée par le conflit purement médiatique entre les Beatles, "ces voyous qui jouent les gentlemen", et les Rolling Stones, "ces gentlemen qui jouent les voyous". Let It Be vs Let It Bleed ». John Lennon lui-même reprenant, « comme pour se reprendre » et « se faire pardonner Sgt Pepper », des standards des sixties dans son album Rock’n’Roll, deux ans après Pin Ups de Bowie, confiera « que le meilleur des Beatles avait été le rock minimal de leurs débuts », ce qui revenait à jeter la « grande éponge » (Sting) de la pop, à la sacrifier sur l’autel d’une pureté originelle fantasmée. « La France est peut-être pop plutôt que rock. C’est-à-dire, pour emprunter un raccourci un peu sans nuance, légèrement plus esthétisante, plus cérébrale, plus arty et de préférence branchée sur le Royaume Uni ». Elle est aussi « sous la surveillance du surmoi de la tradition catholique, de ce terrible qu’en-dira-t-on latin ».
Comme le montre le film de Dan Graham, Rock My Religion (1984), inspiré par Max Weber, le rock est « globalement une affaire de pays d’origine protestante », et donc capitaliste. Il est « né en même temps que la culture de masse, s’en est nourri et l’a nourrie ». Sa langue est celle « du premier marché mondial ». Les « cargos du plan Marshall » ont débarqué « d’abord dans les grands ports anglais ». Si, aux Etats-Unis, comme l’a dit le révérend Jimmy Snow, « rythme et métissage » ont été « le péché descendu sur Terre » au début des années 1960, « le puritanisme de la société britannique nécessitait avec plus d’urgence qu’ailleurs en Europe de faire sauter les blocages moraux, sociaux et culturels ». Alors que « la contre-culture française trouva dans l’existentialisme et l’hédonisme Saint-Germain des Prés, le situationnisme, le communisme (bientôt le maoïsme) des outils de résistance et de subversion, les Anglais, plus rageurs, plus popus en somme, avaient l’intuition que le changement viendrait des guitares électriques ! ». Pour autant, ils n’étaient pas des brutes : « politiques d’éducation égalitaires » des universités britanniques, ouverture d’écoles d’art « qui deviendront un creuset artistique majeur pour des dizaines de futures rockstars ». Terrain propice à l’aristo prolo, au working class dandy (et lettré).
Rock dans l’énergie (« au commencement était le rythme. Le Verbe vient après, et (…) sans le rythme, le Verbe… chique molle, truc raplapla ! »), Jean-Michel Espitallier l’est aussi dans son amour du live. Il transforme en portrait de l’artiste la photographie de son jeu de scène. Presley : « Pelvis guimauve ». McCartney : « Éternel jeune premier joyeux sautillant ». Dylan : « Nobel folkeux livré avec son harmonica ». Gilmour : « Sympa sérieux incarné ». Bryan Ferry : « Crooner vintage ». Zappa : « Pierre Boulez moustachu farceur prises multiples ». Freddy Mercury : « Castafiore cuir-moustache ». Buddy Holly : « Premier de la classe agité ». En « Frenchy but chic » : Daho, Bashung, Françoise Hardy, Gainsbourg… Mais Espitallier est pop dans l’éclectisme de son écoute. Dans « Grace » de Jekk Buckley, il entend « des choses découvertes il y a cinquante ans ou il y a trois semaines (…). Du lourdement patrimonial ou du très pointu, de la muzak et de l’underground, du mainstream et de l’avant-garde, du éhontément kitsch ou de l’élégamment sophistiqué, tout ça en réconciliation apaisée, dialogue fluide, mitoyenneté sans accroc, déhiérarchisation assumée ».
Renversées les idoles, démontée la « machine à standardiser », oubliés les « modèles déposés », ces images auxquelles rocker et fan doivent se conformer, dédaignés le narcissisme par fétiches interposés, « la provoc pépère et l’illusoire libération de tout, sur fond de régression sociale, d’horreur économique et de censures morales tous azimuts », que « reste »-t-il ? L’intimité d’une lecture, une sorte d’amitié. Regardant « (deux fois !) Get back, le documentaire de Pete Jackson sorti fin 2021 », Jean-Michel Espitallier passe « près de (deux fois !) huit heures dans l’intimité des Beatles ». Il est « presque devenu un Beatles », et ressent à la fin « comme un chagrin (…) Mes meilleurs amis me manquaient déjà. La magie continuait d’opérer ».
Parti à la rencontre de Syd Barrett, il était revenu sans relique de sa vraie croix. « Et s’il n’était pas là, alors où était-il ? Et où sont-ils, ces spectres familiers qui nous hantent en nous tenant parfois la main ? ». Pas plus d’original au fétiche que dans Tintin, L’oreille cassée. Mais en réécoutant un disque acheté en Allemagne en 1978, « Hoping Love Will Last » de Steve Hackett et Randy Crawford, il éprouve quelque chose comme le trébuchement sur les pavés disjoints dans la cour de l’hôtel des Guermantes : « je me suis alors demandé comment ce morceau de même pas cinq minutes pouvait me mettre instantanément en grande joie, éveiller de grands questionnements, et avec quelle puissance, quelle justesse, quelle profondeur. Ce regard sur ce que j’avais perdu et découvert, rencontré et abandonné, sur ce que j’avais construit, accompli, raté et réussi, oublié et compris depuis quarante-cinq ans. Il m’avait fallu ce morceau de même pas cinq minutes, connu par cœur, pour réactiver, encore, dans une sorte de griserie, de fièvre, dans un état second joyeux, sans nostalgie, sans regrets sans remords, ce besoin de me repenser. Ce besoin de me retrouver (…). Soudain, la mort n’existe plus. Soudain, le monde est une boule à facettes ». Autre réminiscence, ou plutôt « acte manqué hypermésique » et « petit retour du refoulé », le jazz, « jamais loin de la route du rock ». Conflit des générations ? Allons donc ! George Martin n’est pas le dernier des Beatles. Et Paul, qui chante Fats Waller, n’a —heureusement— jamais tué son père.