Guillaume Apollinaire, La Beauté de toutes nos douleurs par Pierre Vinclair
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
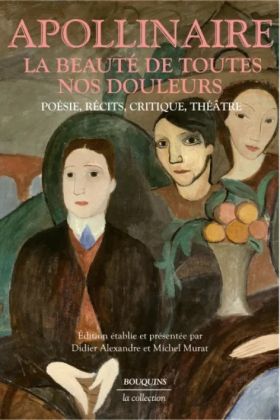
Peut-être parce qu’elle était un peu caricaturale, la célèbre et désormais ancienne Querelle des formalistes et des lyriques a eu l’avantage de mettre en évidence deux rapports très différents de l’écriture à la temporalité. Pour les premiers, le poème devait introduire une rupture significative dans l’histoire, notamment dans celle des formes. Ce qui existait vraiment, c’était l’odyssée de la littérature ; le livre de poèmes était significatif s’il parvenait à faire croire qu’il s’inscrivait dans cette fresque en l’infléchissant. Pour les seconds, le poème devait introduire une rupture significative dans l’existence, c’est-à-dire dans la temporalité subjective de son auteur. Ce qui existait vraiment, c’était la vie affective avec ses peines et ses épiphanies, ou les interactions difficiles entre le moi et le monde ; le livre de poèmes était significatif s’il parvenait à faire croire que se jouait avec lui, sur le modèle d’une Vita nova rimbaldisée, mitterandisée voire goldmanisée, un changer-la-vie. N’est-il pas intéressant que ces deux partis, celui des formalistes et celui des lyriques, aient pu revendiquer la figure d’Apollinaire comme tutélaire, les premiers le voyant comme un grand inventeur et les seconds comme un grand amoureux ? C’est, diront les concernés, qu’il y a plusieurs Apollinaire : l’expérimental de « Zone » et l’élégiaque du « Pont Mirabeau ». Que ces deux poèmes non seulement appartiennent au même recueil, mais qu’il s’y suivent, ne les trouble aucunement : afin de s’approprier l’auteur, chacun accepte d’en aimer l’un et de mépriser l’autre. Et l’on tire argument de sa mort précoce pour prophétiser que, eût-il après avoir été trépané à la guerre survécu à la grippe espagnole, il aurait été définitivement grand — « à l’évidence » — dans l’un ou l’autre camp.
Ce qui frappe à la lecture de La Beauté de toutes nos douleurs. Poésie, récits, critique, théâtre, l’édition établie et présentée par Didier Alexandre et Michel Murat de la partie la plus significative de l’œuvre d’Apollinaire, c’est que celui-ci n’était ni un auteur lyrique, ni un auteur formaliste, ni un auteur tantôt lyrique et tantôt formaliste. Car un troisième rapport au temps se jouait dans son écriture ; la coexistence, dans ce gros volume (plus de 1800 pages), de la poésie et de la poétique, mais aussi des autres genres qu’il pratiqua (contes, critique d’art, théâtre), permet de le reconstituer. Apollinaire n’était pas un formaliste, d’abord, parce qu’il prétendait moins faire quelque chose à l’histoire de la poésie, que procurer à son lecteur ou sa lectrice une expérience intéressante. Répondant à une enquête en 1906, il écrivait d’ailleurs : « “Vers libre et classique, poésie et prose, théâtre, poème et roman’’ me paraissent des formes également excellentes. Je ne pense pas qu’aucune d’elles soit sacrifiée au bénéfice des autres. » Et c’est un fait que jusqu’à la fin, dans son œuvre les vers réguliers coexistent avec les formes nouvelles. En 1917, il suggère encore que « toutes les formes sont bonnes. Le vers peut être libre, régulier, libéré, calligrammatique » : les innovations d’un poète ne sauraient avoir pour enjeu d’ajouter son nom à la glorieuse Fresque de l’histoire irréversible. Pour autant, un tel œcuménisme ne signifie en rien qu’Apollinaire soit « lyrique » (au sens de la Querelle), puisque pour lui la valeur d’une œuvre d’art continue de tenir, comme dans la « peinture pure » de Delaunay, à la construction de la réalité dans et par la forme : « les grands poètes et les grands artistes ont pour fonction sociale de renouveler sans cesse l’apparence que revêt la nature aux yeux des hommes », écrit-il dans « Sur la peinture ». Comment dépasser cette apparente contradiction ?
Dans « L’Esprit nouveau et les poètes », Apollinaire avance que « le nouveau existe bien, sans être un progrès. Il est tout dans la surprise. L’esprit nouveau est également dans la surprise. C’est ce qu’il y a en lui de plus vivant, de plus neuf. La surprise est le grand ressort nouveau. » Voilà donc le troisième rapport à la temporalité que nous cherchions : par-delà lyrisme et formalisme, le poème doit être le lieu de la surprise. Ce qui compte n’est pas d’introduire une rupture significative ni dans l’histoire des formes, ni dans son destin personnel, mais de faire du temps de la lecture l’irruption d’un événement. En fétichisant qui les structures de l’histoire littéraire, qui l’existence affective des corps, formalistes et lyriques loupent rien de moins que l’intérêt du texte — qui ne peut être, ni au-dessous ni au-dessus, que dans le drame du texte même. C’est le poème qui doit se faire odyssée, pas l’histoire littéraire ; le poème dont la vie doit être changement, pas le poète. D’où l’importance, par exemple, du classement des pièces d’Alcools, avec l’alternance des poèmes courts et des poèmes longs, « Le Pont Mirabeau » juste après « Zone » : car ce temps dont l’épaisseur est à prendre en compte, et dans lequel doivent avoir lieu des événements, est celui du déploiement du texte. De ce point de vue, le premier poème d’Alcools avec ses changements incessants de lieux et le deuxième du recueil, avec sa danse hétérométrique, se rejoignent malgré l’opposition superficielle de leur style : tous deux sont des espaces énergétiques où continûment des surprises adviennent.
Il y aurait évidemment beaucoup d’autres choses à dire sur ce volume, où les textes, introduits par des notices éclairantes (tant sur le contexte de l’écriture que sur ses enjeux), sont accompagnés de notes de bas de pages qui enrichissent notre rapport à une œuvre que l’on croyait connaître (saviez-vous que le « cou-coupé » était le nom d’un oiseau ?), mais laissons plutôt la parole à Apollinaire lui-même, répondant dans sa lettre du 15 mars 1918 à Charles Maurras qui l’avait accusé de n’avoir trouvé avec le calligramme qu’un simple truc : « Croyez-vous bien, cher Maître, qu’un sonnet ou toute autre forme poétique ancienne aurait produit autant d’effet. Non certes ! Un sonnet n’aurait pas eu les honneurs d’un écho. Tandis qu’un calligramme a déterminé la surprise et la surprise est un élément moderne qui s’il n’est pas et ne peut être l’essentiel ni dans les arts ni dans les lettres, ni ailleurs n’en est pas moins une chose qui compte. » La surprise n’est qu’un moyen, un « ressort » disait-il plus haut, de l’esprit nouveau. Un peu plus loin dans la même lettre, il écrit pour rallier le nationaliste au mouvement moderne : « Dès l’âge de dix ans je me suis exercé à la poésie. Les uns tenaient pour le vers régulier, d’autres pour le vers libre, d’autres pour le vers libéré, d’autres encore pour une sorte de laisse ou verset fondé sur le souffle. En innovant avec mes calligrammes dont le premier justement représentait le ciel étoilé, je n’ai songé qu’à un délassement poétique, repositorium Apollinis. Il y a loin de là à un truc et à ce compte un sonnet serait aussi un truc. […] Je suis né à Rome, de sang italien et de sang polonais. […] Je suis en France depuis l’âge de trois ans et la seule langue que je connaisse bien est le français. D’autre part, j’ai gagné sur les champs de bataille ma naturalisation dont le brevet me fut apporté devant Craonne, il contient en toutes lettres la mention sous-lieutenant au 96e régiment d’infanterie et quatre jours après que je l’eus reçu les Allemands me baptisaient français avec le sang jailli de ma tête où la cicatrice d’une trépanation en forme d’étoile est le plus beau calligramme que j’aie encore dessiné. » Si la beauté, comme le dit le vers du « Chant de l’honneur » qui donne son titre au volume, qualifie nos douleurs, c’est seulement pour autant qu’elles ont une forme.