La Baie des cendres, Stéphane Bouquet sur des photo-graphies de Morgan Reitz par Jean-Claude Pinson
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
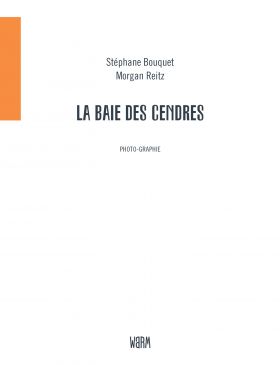
« Photo-graphie » (avec un tiret), tel est le sous-titre de La baie des cendres, un récit très singulier de Stéphane Bouquet accompagnant des… photographies de Morgan Reitz. Le tiret est ici important. Signe ambivalent, il ne conjoint pas seulement, il disjoint.
Disjonction : chacun, photographe et écrivain, suit son chemin, et les deux parties du livre paraissent s’ignorer l’une l’autre. Les photos ne viennent pas documenter un récit, comme c’est le cas par exemple dans les romans de Sebald. Et le texte ne vient pas davantage éclairer, commenter des photographies. Cependant, si ces chemins sont des parallèles qui semblent s’ignorer, elles participent d’une énigmatique géométrie non-euclidienne, finissant, on ne saurait dire ni où ni comment, par consonner et se rejoindre. La disjonction se retourne ainsi en conjonction.
Conjonction : le récit de Stéphane Bouquet se déploie en neuf séquences qui, sans jamais les commenter, font cependant écho, en quelques points, aux neuf photos de Morgan Reitz. La première séquence, par exemple, évoque un ciel « aussi orange qu’un jus multifruits bio vitaminé » qu’il n'est pas difficile de repérer sur la première photographie. Conjonction encore en ce que le photographe comme l’écrivain, selon la logique de leur médium propre, mettent l’un et l’autre en œuvre une poétique qu’on peut définir comme celle de l’« estrangement » (de l’ostranénie chère aux Formalistes russes). Pour Morgan Reitz, cela consiste en un traitement de la lumière et de la couleur qui s’éloigne sensiblement de tout naturalisme et fait penser plutôt à quelque chose comme un pictorialisme, mais sans concession aucune à quelque complaisance « artiste » que ce soit. L’habitant de Nantes (comme c’est mon cas) reconnaîtra sans mal quelques lieux et paysages de sa ville (les quais de l’Erdre en face de la Préfecture, le village de Trentemoult sur la rive sud de la Loire, l’imposante usine Beghin-Say…). Il les reconnaîtra, mais en même temps ils lui paraîtront être passés de l’autre côté du miroir, comme si quelque secret gisait dans le paysage, celui d’une catastrophe qui l’aurait ensorcelé. À moins que ce ne soit, dans la mutation qui l’altère, le « renverse » (« catastrophe » signifie aussi retournement), « un paradis futuriste et temporaire » qui s’annonce, à la faveur de cette « cérémonie secrète et maçonne » dont parle Stéphane Bouquet.
Le titre du livre est mystérieux. Une lecture attentive du texte de Stéphane Bouquet ne livre aucune clef qui mettrait sur la piste le lecteur. Ce dernier peut donc librement s’abandonner à son imagination. J’ai pensé pour ma part à la baie de Naples recouverte de cendres après l’éruption du Vésuve, aux fresques de Pompéi désensevelies bien après le désastre. Car cendreuse, me semble-t-il, est la tonalité qui sourd de la lumière voilée, obscurcie et jaunie, presque sépia parfois, qui caractérise ces neuf photographies de Morgan Reitz. Comme si quelque catastrophe écologique avait eu lieu, empoisonnant, empoissant d’une suie malsaine, d’un air vicié, l’atmosphère où semblent figés dans une sorte d’irréalité inquiétante les éléments (bâtiments aussi bien que végétaux) qui constituent chaque paysage. – Quoique là encore l’ambivalence prévale, car cette lumière voilée n’est pas sans rappeler également la dorure sombre des icônes.
Mais c’est à une autre catastrophe aussi qu’on peut penser, une catastrophe intime celle-là. C’est elle du moins qui transparaît tout au long du récit de Stéphane Bouquet. La narratrice, abandonnée à sa solitude (au silence « avec lequel il est si facile de se mettre à la colle »), est en attente, en vain, de la « consolation éblouissante » d’une étreinte qui ne vient pas. Elle voudrait pouvoir aimer, mais c’est seulement sa propre bouche qu’elle rencontre : telle est « l’horrible tragédie d’une Echo post-moderne ».
Stéphane Bouquet est un poète inventeur de formes, de grandes formes (je veux dire à l’échelle du livre tout entier). Son livre précédent, Vie commune, revendiquant « l’emmêlement des gens » et la « porosité » des genres, avait pour originalité de rassembler et faire tenir en un même volume trois longs poèmes en vers, une pièce de théâtre et trois nouvelles. Cette fois, se confrontant à l’image photographique, il choisit la prose narrative. Mais il conduit le récit selon une singulière logique d’où se trouve exclue toute providence narrative. C’est au contraire, dans l’enchaînement des phrases et des séquences narratives, la bifurcation imprévue qui prévaut. D’où l’effet d’étrangeté ressenti par le lecteur. En voici un exemple :
« La mélodie des merles lui a soufflé la clef ou la nouvelle lettre qu’elle a cru dénicher dans sa poche et puis finalement c’était seulement un ticket de caisse d’une longueur hallucinante. En tout cas, un ballon de foot s’est écrasé sur son crâne et la radio des voisins criaille pendant que la fumée carnée du barbecue se tord dans les airs et qu’un des joueurs adolescents vient vers elle et s’excuse avec une contrition qui la ravit. Il paraît qu’une certaine espèce de baleine chante à 52 hertz et qu’aucun autre cétacé dans le monde n’est réglé pour capter sa fréquence. C’est dur pour elles d’avoir seulement le plancton pour confident ».
L’écriture est donc commandée par une logique disjonctive. Elle relève de ce qu’on pourrait nommer une « poétique de la surprise », à l’instar de celle qu’on voit à l’œuvre, par exemple, dans la poésie de Dominique Fourcade. Mais, à la différence de Fourcade, qui refuse la narration, préférant insister sur l’espace proprement textuel, Stéphane Bouquet, lui, étend cette logique au récit tout entier. Et c’est pourquoi chez lui le principe de disjonction se double d’un principe de conjonction. Il s’agit malgré tout (malgré le côté sans cesse bifurquant du récit) de conférer une unité et une continuité à ce qui demeure bien un récit organique et non un collage de fragments. Le chaos narratif est en même temps un cosmos – ou plutôt, pour reprendre un mot qu’affectionnait Deleuze un « chaosmos ». Un chaosmos sans providence, comme est le monde d’aujourd’hui.