Langues obscures. L'art des voleurs et des poètes de Daniel Heller-Roazen par Jacques Barbaut
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
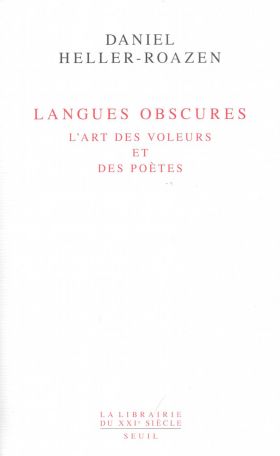
Après l’exergue (en langues), de deux lignes, tiré de Finnegans Wake, qui chapeaute Langues obscures, s’ouvre le premier chapitre, intitulé « Les langues fourchent »…
« Quoi de plus inimaginable, en soi, que les sens enfermés dans une langue inconnue, dans des phrases, des mots, voire des sonorités aussi infimes qu’un changement de quantité dans une voyelle, la voix qui monte ou qui descend, l’ajout, à une enfilade de consonnes et de voyelles, d’une aspiration, comme celle de la lettre h ? » (p. 17)
… première section de onze savantes et documentées études (plus de soixante pages de notes, de références bibliographiques et d’index), traduites par Françoise et Paul Chemla.
Daniel Heller-Roazen, qui revient sur l’étude de Marcel Schwob sur le jargon des coquillards, d’après leur procès de 1455, leurs procédés, et inévitablement sur le cas François Villon, formule cette fascinante question qui irrigue l’ensemble du volume :
« Se pourrait-il qu’un lien caché existe entre les deux formes de discours hermétique, qui fasse des vers une sorte de parler de bandits ou du jargon une variété de poésie ? » (30)
Ce polyglotte, professeur de littérature comparée, évoque l’argot et le cant, les diverses espèces de « langues secrètes », celle des malfaiteurs et des rôdeurs, le « langage exquis » des arnaqueurs et des vauriens, celui des vagabonds et des mendiants, le langage impénétrable des Gitans, le « français des colporteurs », les dites « contre-langues », la langue cryptique spéciale des prostituées françaises du XIXe siècle, le largonji des loucherbèmes, le javanais, le verlan, entre bien d’autres :
« L’usage secret d’une langue peut aussi impliquer l’altération de sa forme sonore. Il suffit de penser à des opérations comme le mélange des syllabes, la suffixation, l’infixation, la préfixation, l’apocope et la troncation, qui toutes peuvent s’unir de diverses façons et selon des règles trop nombreuses pour être prévisibles. » (43)
Ce philosophe, connaisseur en philologie indo-européenne, nous initie à la poésie scaldique, « extraordinairement complexe », obéissant à de redoutables exigences formelles, de longueurs et de timbres, de rimes, d’allitérations ou d’assonances, au vieux norois, aux sagas, à l’Edda poétique, et à la notion des kenningar, leur fonctionnement, « On ne peut nier qu’en dépit de leur obscurité incontestable les kenningar sont restées un élément fondamental de la poésie médiévale scandinave pendant plus de quatre siècles. […] Snorri attribue à un dieu l’exigence d’hermétisme de la nomination en poésie », le penchant des scaldes pour les périphrases (la plupart du temps opaques), puis les périphrases de périphrases (« en trois étapes, on atteint ainsi un synonyme unique de “mer” qui est aussi prolixe qu’énigmatique : “ terre du serpent du banc du navire ” »), leur prolifération, les circonlocutions au troisième degré — « Une des plus froides aberrations consignées dans les histoires de la littérature », résume J. L. Borges…
De l’Inde védique — « le Rig Veda, dont la strate la plus ancienne date du IIe millénaire avant J.-C. », à la Grèce archaïque et à la Scandinave médiévale, avec passage par les runes, ce sont aussi les trésors cachés des énigmes et des devinettes du folklore et de la littérature dite « populaire », avec exemples pris notamment dans les sphères du russe et de l’hébreu, et dont les solutions se trouvent toujours dans les opérations rhétoriques fondamentales (métaphores ou métonymies) ou les différents types de jeux de mots sonores (homophonies ou infimes différences de prononciation, changement d’une voyelle ou d’une consonne, inversion de syllabes…), puis bientôt les textes des troubadours (« qui nous sont plus hermétiques que ceux de la Rome antique »), l’art du trobar clus (du « trouver clos »), la définition des « senhals », ces noms de fantaisie donnés pour dissimuler l’identité de la dame bien-aimée, les noms des dieux (ceux qu’on leur donne et ceux qu’ils donnent) et les noms sacrés… Dès le sanscrit, les traités le disent et le répètent : les dieux, par nature, « aiment l’occulte » et « détestent ce qui se donne à voir clairement ».
« Les êtres parlants ont une attention au détail, ou une crédulité, si vive qu’on peut les fourvoyer en altérant ne serait-ce qu’un seul des atomes phonologiques qui, lorsqu’on les ordonne et qu’on les associe à d’autres, constituent les mots connus. » (109)
Un retour sur le nom de Ferdinand de Saussure (le fameux cas dit « des deux Saussures »), professeur de langues indo-européennes à l’université de Genève, qui laissa à sa mort 99 cahiers manuscrits consacrés à la « poétique phonisante et en particulier au principe de l’anagramme » des poètes archaïques, à la recherche d’un art secret, la « fureur du jeu phonique » qui serait à l’œuvre chez les poètes depuis le sanscrit ancien, le saturnien, une tradition occulte qui serait encore pratiquée au Moyen Âge et à la Renaissance, et peut-être jusqu’aux poètes qui, vers 1910, écrivaient encore des poèmes en latin… mais ce Saussure qui n’a pas publié un seul mot de ses recherches (pas davantage que son fameux Cours de linguistique générale, au point que l’on parla de sa « graphophobie », ou « horreur d’écrire »), ensemble, dont témoignaient ces « cahiers secrets », qui ne fut publiquement révélé qu’en 1971 grâce à Jean Starobinski dans son livre Les Mots sous les mots : les anagrammes de Ferdinand de Saussure, études qui suscitèrent chez les linguistes comme chez les littéraires un scepticisme quasi général (à l’exception notable de Roman Jakobson, qui le lut avec quelque intérêt), et, puisque, « sur plusieurs points, il semble même que la théorie des anaphones soit aux antipodes des principes fondamentaux du Cours » : « Les critiques n’ont pas hésité à évoquer une maladie mentale dont il aurait souffert : ils ont diversement parlé de la “folie”, de la “démence” ou même de la “schizophrénie” détectable dans les pages des cahiers d’anagrammes » (147)…
Onzième et dernier chapitre, qui boucle la bouche de ces Langues obscures, « Les secrets de Tristan Tzara »… Tristan Tzara, le dadaïste, le même qui, dans ses premiers textes, a défini la « spontanéité » comme caractéristique suprême de l’art futur, passa les dix dernières années de sa vie penché sur les poésies de François Villon (le Lais, le Testament), pour y dénicher des anagrammes (des noms propres dissimulés, pour la plupart) très précisément structurées sur l’axe symétrique du vers, soit un procédé cryptographique impliquant une forme complexe de déchiffrement, comme si l’ensemble de l’œuvre (les « ballades dites en jargon » exceptées) fonctionnait tel « un roman à clé continu ».
Seuls des programmes informatiques purent préciser les probabilités et la fréquence de la présence de ces noms cachés dans la poésie de Villon, et l’argument pour réfuter la validité de cette découverte tint en ce paradoxe : « ça marche beaucoup trop bien ! », surtout quand Lynn D. Stults, une linguiste américaine, fit apparaître des noms inattendus comme celui du secrétaire d’Etat des Etats-Unis Henry Kissinger (si c = k, mais Tr. Tz. lui-même s’était autorisé bien des licences orthographiques) au vers 130 du Lais !
Cette réfutation majeure consista, dans son essence, « à soutenir que le poète-chercheur s’est trompé en croyant avoir retrouvé quelque mille deux cents anagrammes, parce qu’il y en a plus du double qu’il n’avait pas vues. Autrement dit, qu’il avait raison au-delà de ses espoirs les plus audacieux. Donc, il avait tort. » (207)
Si Roman Jakobson, dans son article « Structures linguistiques subliminales en poésie », notamment, défendait une idée de l’herméneutique « intensément cryptique » selon laquelle les séquences ou les contraintes poétiques « peuvent être à l’œuvre même là où les êtres parlants ne perçoivent consciemment aucune récurrence », et que, avant lui, dans un cahier sur Homère, Saussure avait précisé que le jeu phonique anagrammatique peut marquer la langue poétique « que le critique d’une part, et que le versificateur d’autre part, le veuille ou non », nous laisserons à Baudelaire (dans son « Poème du haschisch », cité p. 167), un grand pratiquant, le soin de trouver, d’associer, d’halluciner tout autrement :
« La grammaire, l’aride grammaire elle-même, devient quelque chose comme une sorcellerie évocatoire ; les mots ressuscitent revêtus de chair et d’os, le substantif, dans sa majesté substantielle, l’adjectif, vêtement transparent qui l’habille et le colore comme un glacis, et le verbe, ange du mouvement, qui donne le branle à la phrase. »