Vague de John Ashbery par Jean-Claude Pinson
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
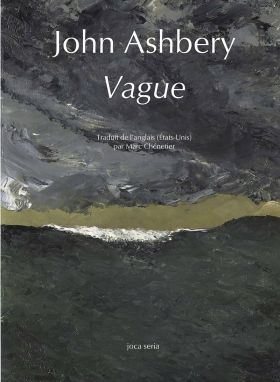
Le phrasé très free-jazz du poète Ashbery
A Wawe, tel est le titre original de ce recueil du poète américain John Ashbery*< En anglais, le mot désigne la vague, mais aussi un salut que l’on fait de la main. Traduire par Vague (sans article), c’est évidemment laisser de côté ce second sens. Perte cependant compensée en français par un gain, puisque l’adjectif homonyme ajoute une idée de « flou », d’indécision, qui se trouve être essentielle à la poétique de l’ouvrage. Ashbery en effet s’attache à soumettre au mouvement ondulatoire du langage, à sa rythmique toute en bifurcations, les certitudes arrêtées dont l’opinion ne cesse de se nourrir pour mieux masquer la trop inconfortable incertitude de vivre.
Et puisque grandes vagues de langage il y a, « flou » sera ainsi, dans ces poèmes, synonyme de « flot » et de « flux », de « fluctuations », de mise en fuite des représentations convenues. Comme les rouleaux se formant au large pour s’écrouler sur le rivage n’ont de figure que perpétuellement changeante, les phrases du poème ne construisent d’énoncés que pour dans un même mouvement les détruire. Un principe d’ironie les gouverne, en conséquence de quoi « il serait vain, note Marc Chénetier dans sa remarquable Postface, d’attendre qu’apparaissent la côte, les p’tits bateaux et les marins, les châteaux de sable et les pâtés ». En résulte, pour le lecteur, un indéniable égarement. Les bribes de phrase qu’on lit sont toutes intelligibles, nullement obscures, mais difficile est l’acte de synthèse qui assurerait la continuité d’une compréhension. Désorientation qui nous rappelle que rien n’est simple, qu’il y a toute une pluralité de mondes dans la pénombre de l’esprit, à peine effleurés par « tout ce à quoi nous pensons quand nous cessons de penser » (p. 20).
Pour autant, on n’a pas affaire à une poésie proprement « abstraite », tournant le dos à l’expérience pour s’enfermer à double tour dans la seule jouissance du langage. « Ça ne veut pas rien dire » (Rimbaud à Izambard). Au contraire, c’est toute l’étendue et l’intensité de l’expérience de vivre, sa « vacillation fébrile » (p. 46), sa labilité qui échappe, son « impossible » (à dire, à traduire en mots), que cherche, non à représenter, mais à capter Ashbery. Marc Chénetier le dit très bien (au moyen d’un verbe – « chauvir » – aussi juste que peu usité) : « Ashbery, note le critique, ne témoigne pas d’une expérience, ni ne la commente ; il écrit, dira-t-on [d’]après le motif, et non sur lui, avec des moyens de langue qui font songer à la sensibilité multidirectionnelle des oreilles d’un grand cerf aux aguets ; c’est sa parole qui, inlassablement, chauvit. »
On a pu dire (un critique de langue anglaise, Denis Donoghue) qu’Ashbery faisait sienne une « aspiration de la musique à la perfection formelle qui prétend constamment vouloir dire quelque chose sans pour autant se plier à l’obligation de produire un sens particulier ». Ce qui vaut à ses yeux, ajoute le critique, c’est un « genre de rythme qui prend la place du “sens” ». Toute énonciation poétique, dirons-nous pour notre part, est tendue entre une logique du sens et une logique « musicale », entre le souci de signifier (de dire quelque chose à propos de quelque chose) et celui de « phraser » (de faire entendre un rythme et un chant). Dans les longs poème-conversation de ce recueil, c’est sans doute d’abord un « phrasé » (au sens où on l’entend d’un sax) qu’on retient. C’est d’abord une voix qui nous parle. Une voix qui semble improviser comme peut improviser un musicien de free-jazz. Le propos en effet sans cesse bifurque au mépris des transitions, sautant sans prévenir d’une image à une autre et d’un monde à un autre. Le ton en est tour à tour méditatif ou familier, enjoué, au plus près de la langue parlée, non sans accents de gravité (mais dépourvus d’emphase). En d’autres termes, l’esprit du blues perce sous l’allure free-jazz. Et si un nom alors vient à l’esprit, c’est celui d’Ornette Coleman ; c’est à son chant si singulier qu’on pense.
Le recueil date de 1984, à l’époque où le rap commence à gagner quelque influence. Je ne sais si Ashbery écoutait ce genre de musique. Mais ce qui est sûr, c’est que sa façon virtuose de rythmer la langue et de la déhancher sans cesse témoigne d’une vigueur d’élocution et d’un flow incontestables – d’une capacité à enchaîner ses énoncés épars selon un rythme à la fois fluide et syncopé. Du moins c’est le sentiment que communique la traduction de Marc Chénetier. Ce n’est évidemment pas le moindre de ses mérites.
* De cet important poète américain était paru en 2013, chez le même éditeur, un livre réalisé en collaboration avec Joe Brainard (pour les dessins), Le carnet du Vermont. Nous en avions rendu compte dans le n° 39 (mai-juin 2013) de Place Publique.