Bronka Nowicka, Nourrir la pierre par Pierre Gondran dit Remoux
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
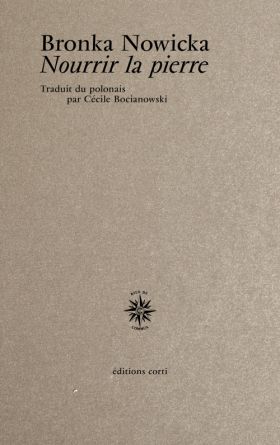
Bronka Nowicka, née en 1974, est une artiste polonaise à l’œuvre protéiforme. Au cœur de son travail de vidéaste et plasticienne se trouve l’objet, notamment les enjeux de la mémoire qui s’y attache au-delà de la mort de son propriétaire. Dans Nourrir la pierre, elle éclaire un mode de rapport aux objets original et distinct : celui de leur perception par le petit enfant, probablement au moment de l’acquisition du langage, parfois bien plus tôt, parfois chez un enfant plus grand — âge, genre et position de l’enfant dans la narration étant changeants. Le recueil compte quarante-quatre poèmes en prose, chacun étant consacré à un objet : le peigne, la petite cuillère, les boutons, mais aussi la cendre, le rebord de fenêtre… et la pierre « à nourrir », au statut particulier. Dans ces textes courts alternativement drôles, étranges, épouvantables, l’autrice retranscrit avec brio la relation du jeune enfant au monde, à la fois égocentrée et incertaine, rationnelle et empreinte de pensée magique : flottante.
Dans les premiers textes, l’enfant saisit les limites de son corps, la peau salée de ses genoux qu’il suçote : « L’enfant le sait : la seule chose qui sépare l’homme du monde, c’est la peau. C’est grâce à elle qu’il ne pénètre pas dans l’infini des choses. » Ce monde infini des choses et des êtres distincts de lui est un effarement pour celui qui, il y a peu, ne faisait qu’un avec la mère, le sein de la mère (l’objet primaire selon les psychanalystes) : « L’enfant est dans le jardin, la bouche béante, d’où fume sa sidération face au monde. » Plus loin, Bronka Nowicka évoque avec une grande acuité certains des traits développementaux mis en évidence par Piaget. Ainsi, l’animisme est omniprésent : « L’enfant n’arrive pas à dormir. (…) Il a peur que la pierre meure parce qu’elle ne mange rien. » A contrario, le corps des humains a parfois l’apparence de choses inertes : « L’enfant regarde des gens nus dont le sommeil a collé les yeux et ouvert la bouche. (…) Le corps de ma mère, c’est de la pâte – elle déborde sur mon père qui gît comme un sac. » De même l’artificialisme — selon lequel le monde naturel est fait par et pour l’humain, et est commandé par lui selon des causalités magiques — : au square, un homme, en visant les nuages avec un bâton, « les déplace d’un endroit à un autre » du ciel. Ou, enfin, cette interprétation des forces et mouvements des êtres, réminiscence de l’antipéristase aristotélicienne que Piaget avait relevée — Aristote explique la trajectoire d’une pierre lancée par la raréfaction de l’air laissée derrière elle, vide qui s’emplit brusquement d’air, poussant la pierre en avant —, qui devient sous la plume de Bronka Nowicka : « Quand [l’idiot] marche, il ouvre grand la bouche et la ferme, comme s’il ne marchait pas sur la terre mais avançait dans l’air à coup de dents. »
Comme lecteurs, nous sommes donc projetés dans un monde que toutes et tous avons connu et avons oublié… Le trouble est majeur. D’autant plus que l’autrice ne nous donne pas à voir le développement idéal d’une sorte de modélisation d’enfant. La détresse est en effet intimement mêlée à l’étrangeté et irrigue les poèmes. À cause du silence et du désintérêt d’une mère qui est loin d’être la « mère suffisamment bonne » de Winnicott, à cause de la grande promiscuité — seule l’arrière-grand-mère cloîtrée dans son placard malodorant semble se rappeler, lors de courts épisodes hors sa démence sénile, que la main, « vers laquelle avaient afflué des souvenirs intacts », est faite pour entrer simplement en contact avec l’enfant —, surtout à cause de la maltraitance exercée par le père : « Un jour mon père trouva ses mains. Ses propres mains. Elles étaient cachées dans les poches de son manteau. (…) Au bout de quelques jours passés à leur place, les mains mangeaient, buvaient et claquaient des doigts. Plus tard, elles eurent envie de frapper. C’est alors que mon père me les montra. » Telles sont les raisons d’une étrange schize qui atteint l’enfant : à côté de lui, menant une vie parallèle et lui prodiguant des conseils (comme lui apprendre à pleurer de vraies larmes), « la tristesse » est là, tout premier mot du recueil. Encore un objet, finalement, mais au sens de Mélanie Klein, projection extérieure, défensive, de la part lugubre de l’objet primaire introjecté, à la fois bon et mauvais, ambivalence participant à la fondation du moi quand elle est équilibrée.
C’est sur ce terreau redoutable que doit pourtant se jouer une étape cruciale : l’acquisition du langage par le deuil de la perception nue, véritable sujet du livre. Mais ça ne se déroule pas comme il faudrait : les parents tentent d’« appuyer sur le ventre de leur fille pour qu’elle dise quelque chose », d’extirper les mots de sa bouche avec les doigts, mais l’enfant demeure muette comme une pierre, cette pierre qu’elle glisse dans sa bouche et qui métaphorise le langage qui tarde à venir, car c’est bien celui-ci qu’il faut nourrir pour grandir : « C’est alors que l’enfant découvrit un creux sous sa langue, il y mit la pierre et ne devint pas plus lourd pour autant. (…) L’enfant parcourait le jardin et regardait ce qu’était cet endroit. La pierre mangeait cette vision avec l’enfant, qui savait déjà cela : il nourrirait la pierre de tout ce qui lui passerait par les sens. »
On notera qu’une nouvelle édition a paru en Pologne illustrée de photographies d’objets créés par l’autrice, notamment des poupées chimères, arte povera de bric et de broc, dont une sans visage. On pense à la « poupée-fleur » conçue par Françoise Dolto : tricotée sans visage, ni pieds, ni mains, elle aidait l’enfant psychotique à projeter ses affects. Poupée bouc émissaire, maltraitée, comme dans le poème « Les ciseaux » de Bronka Nowicka.