La montagne de H.D.Thoreau et É.Reclus par Lionel Bourg
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
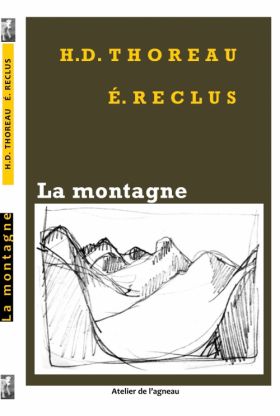
Bonne, belle idée que d’apparier, sous une même couverture, quelques pages de Thoreau, inédites en français, et les deux premiers chapitres d’un ouvrage bien connu d’Élisée Reclus, son Histoire d’une montagne étant disponible dans la collection Babel des éditions Actes Sud.
Henry-David Thoreau n’a que 25 ans quand il rédige Une marche au Wachusett, compte-rendu de l’excursion entreprise au mois de juillet 1842 en compagnie d’un camarade. Le sommet qui l’attend, lequel s’inscrit dans « la ligne brumeuse que dessinent les montagnes à l’horizon », dénué d’arbres, « recouvert de pierres nues et parsemé de buissons de myrtilles, de framboises, de groseilles, de fraises, de mousse », ressemble tellement aux crêts les plus familiers de mes propres escapades que, sans rechigner une seconde, j’emboîte le pas de l’écrivain, profitant à sa suite de l’intimité, « non pas du jour qui se retire, mais de celui qui ne fut jamais profané. »
La marche sera joyeuse.
Empreinte d’une pureté juvénile, naïve peut-être, si bien que l’impression d’évoluer au sein d’un paradis que rien n’offusque ni ne souille s’étoffe du sentiment d’accéder à l’univers des dieux de l’Olympe, Homère, Virgile ne sont jamais loin, ou à quelque « Polynésie aérienne », le ciel, ses bleus, ses filets de sang et les échancrures d’ombres qui le lézardent, participant pleinement à l’euphorie qui s’empare du promeneur. Pour Thoreau, tout n’est plus que rythme, cadence des vers qu’il écrit et que sa traductrice, Camille Bloomfield, ose rendre en recourant à la rime (la version américaine du texte, publiée elle aussi, autorise des lectures mitoyennes), l’innocence religieuse qu’il voudrait exprimer, celle des hommes dans leurs villages, celle des bêtes, inspirerait-elle, malgré les guerres indiennes à peine évoquées, une poésie presque mièvre, ou candide, sulpicienne, tant les montagnes lui paraissent dresser face à lui le miroir de la virginité d’une Amérique idéale.
Au passage, il est question de « petites chaînes, comme celle des Alleghanies », promontoires que le lecteur de Rimbaud aura rencontrés dans Les Illuminations, de cailloux prêts à s’ouvrir les veines, de feu tapi sous les herbes, de ruisseaux et de forêts filtrant les rayons du soleil, l’accent de Jean-Jacques Rousseau donnant à la balade son tour politique : « Une chaîne de montagnes détermine beaucoup de choses pour l’homme d’État et pour le philosophe. Les progrès de la civilisation se glissent le long de son flanc plutôt qu’ils n’en franchissent les sommets. Combien de fois fait-elle barrage aux préjugés et au fanatisme ! »
Rousseau…
On l’entend distinctement lorsque Reclus confesse qu’il était « triste, abattu, las de la vie. La destinée avait été dure pour [lui], elle avait enlevé des êtres qui [lui] étaient chers, ruiné [ses] projets, mis à néant [ses] espérances […] » La phrase inaugurale de son essai s’écoule ainsi, porteuse d’amertume, de chagrin, de déceptions en tout genre, la trahison des amis, l’abjection d’une société qu’il abhorrait le condamnant à l’exil qu’il se choisit un jour dans la montagne. En quête de solitude, il quitte la ville, trouve asile chez un berger dont il partagera la cabane, va par le « brouillard d’un gris bleuâtre qui rampe lentement sur les hauteurs et se déchire en route aux lisières de la forêt. » La paix le gagne. Il goûte la liberté que rien ne limite et, reprenant pied peu à peu, aime, caresse l’espèce de corps féminin auquel il s’unit maintenant, l’eau, qui partout ruisselle, creuse des lits, cascade ou rabote les plus rudes vallées, l’invitant à s’abreuver sous chaque pli, chaque anfractuosité que cette chair dévoile. Élisée Reclus consigne sa frénésie – son plaisir, pourquoi craindre le terme ? – avec l’extrême sensualité qui fut sienne. Sa voix, la tonalité lascive, fougueuse parfois, de ses rêveries, métamorphosent la moindre description en poème ou en récit d’enchantement, les contrées qu’il peint, si voisines des domaines que les enfants de son époque découvraient chez Jules Verne, s’étayant à parts égales de la réalité la plus matérielle et de l’épaisseur du songe.
« Je suis dans la montagne non encore asservie ! », s’exclame-t-il.
« Les fantômes lugubres qui hantaient [sa] mémoire relâchent leur étreinte » et, tandis qu’il se croit « enfoui dans les abîmes de la terre », il s’évade, s’extirpe du passé pour jouir enfin des « fortes épaules chargées des glaces aux reflets d’azur » et des « flancs où les pâturages alternent avec les forêts et les éboulis. »
Deux auteurs. Deux insoumis. Appréciant par ailleurs Gustave Roud autant que Ramuz, je n’entrerai pas ici dans les fastidieuses querelles opposant les amateurs de « la marche en plaine » aux amoureux de la randonnée montagnarde, me bornant à l’esquisse de la préférence légère qui m’attache aux paroisses hérissées de schiste ou de granit et que teinte de mauve l’automnale bruyère.
Au reste, je vis à proximité du massif hercynien. Loge à cent mètres d’une rue Élisée Reclus. Pleure en écoutant Le temps des cerises. L’on devinera sans trop d’effort quelle est ma pente.