Les pérégrinations paresseuses de deux apprentis oisifs de Charles Dickens et Wilkie Collins par Lionel Bourg
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
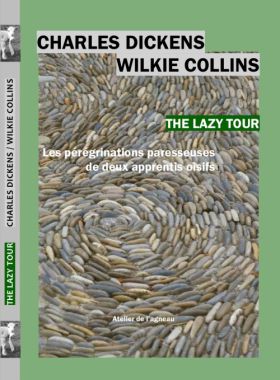
Le 7 septembre 1857, Charles Dickens, 45 ans, et son acolyte, Wilkie Collins, plus jeune d'une douzaine d'années, bouclent leurs bagages puis partent en direction du Cumberland, région du nord de l'Angleterre où, durant quelques semaines, ils s'apprêtent à tenir le journal de voyage que publiera le magazine Household Words dont Dickens était alors le rédacteur en chef.
Transparents sous les masques de Francis Goodchild (Bonenfant-Dickens) et de Thomas Idle (Loisif-Collins), les auteurs, qui combattent la fatigue en absorbant force pintes de bière et de nombreux verres de whisky dans des auberges ou des hôtels de bon aloi, s'en vont gaillardement à la conquête de lieux dignes de l'odyssée fantasque dont ils rendront compte au débotté de cinq livraisons.
Dérisoire en elle-même, l'aventure se doit d'être picaresque, nos apprentis oisifs, « épuisés par l'été interminable et chaud et par le travail interminable et chaud qu'il avait entraîné », s'enfuyant un beau matin de « chez leur employeuse, Dame hautement méritante (nommée Littérature), d'une honnêteté et réputation sans faille, bien que, il faut le reconnaître, pas si hautement estimée qu'elle aurait pu l'être dans la City ».
Leur projet ne se leste d'aucune justification.
Ne rien désirer voir. Ne rien désirer faire. Ne rien savoir. Ne rien apprendre enfin, le but du périple n'en constitue pas un, la vie seule, la plus paresseuse possible, méritant un minimum d'attention, un minimum d'effort peut-être, une telle perspective serait-elle incompatible avec l'affirmation de principe. Marche, train, voitures tractées par des chevaux flegmatiques, les rencontres se suivent, consternantes : « La route du Cumberland, relate Loisif, montait et descendait comme toutes les routes, les clébards du Cumberland surgissaient de derrière les cottages et aboyaient comme tous les clébards, et les paysans du Cumberland, comme tous ceux de leur espèce, contemplaient, bouche bée, la carriole tant qu'elle était en vue. » Naturellement, il pleut. Pluie « douce, serrée, somnolente et pénétrante » poétise Loisif, lequel, fragile d'une cheville, ne tardera pas à se blesser durant l'ascension du Carrock, sorte de Golgotha calédonien au demeurant brumeux, chaotique, où les Simon de Cyrène ne se bousculent pas quand il s'agit de secourir un « étranger » ou un messie barbu de la randonnée pédestre.
L'épisode, savoureux, m'a renvoyé sans barguigner à mes propres excursions dans les parages de la Haute-Loire ou des monts du Forez, contrées matelassées de bruyère, propices aux orages et aux averses, au vent, aux rauques jappements des chiens de ferme, aux légendes et aux ruptures des ligaments, aux foulures ainsi qu'aux déchirures musculaires, aux ampoules, aux entorses. Adolescent, en compagnie d'un de mes cousins, j'y explorais des galeries creusées à flanc de parois hercyniennes, vestiges de mines jadis exploitées jusqu'à l'épuisement où, Bouvard, Pécuchet de quatorze ans, nous recherchions du plomb argentifère et des cristaux de quartz dont quelques-uns avaient l'élégance de se tapir dans des géodes que nous martelions avec l'ardeur des nains de Blanche Neige. Et puis, dans un paysage de parcelles agricoles délimitées par des murets, nous nous exercions en famille à l'exécration de la paysannerie, nos pères, nos oncles, nos chères mamans et nous-mêmes vitupérant la « classe réactionnaire » et les champions du « marché noir », ploucs, pagus, chouans d'Auvergne et des gras pâturages qui, sous l'occupation, avaient éconduit les nôtres à coups de fourches.
Si Collins n'y va pas de paume morte avec les villageois, Dickens, pour sa part, prépondérante, multiplie les morceaux de bravoure, sa verve ciblant de préférence les gares et les locomotives. L'express qu'ils empruntent en direction de Carlisle vaudra pour tous : « Il dégageait, en traversant les champs de moissons, une de ces odeurs de jour de grande lessive et une colonne de vapeur aussi puissante que si elle émergeait d'une énorme bouilloire à thé rougeoyante. […] À un moment, la machine hurlait avec une hystérie si intense qu'il paraissait nécessaire que les hommes chargés de s'en occuper dussent la retenir par les pieds, lui taper sur les mains et la ranimer ; à un autre moment elle s'enfouissait dans des tunnels avec une énergie têtue et discrète si déconcertante que le train paraissait s'envoler et retourner dans la profondeur des ténèbres. Ici, les gares succédaient aux gares, avalées sans aucun arrêt par l'express ; là, le train, telle une rafale de canon, déboulait dans la gare, happant d'un coup quatre campagnards avec des bouquets de fleurs et trois hommes d'affaires portant valises, puis refaisait feu en filant : bang, bang, bang ! »
De fil en aiguille, ou de « vipères de fer » en wagons en proie au délirium tremens, de murs pareils à des « yeux d'hippopotame » aux machines « humaines fripées, ruisselantes de feu et d'eau », du ciel enfumé, crasseux, aux quais enduits de graisse, d'une « campagne à la lande découpée, semblable à des miles et des miles de bourbe anté-Adamite » aux « débris d'un énorme calice de toasts-à-l'eau antédiluvien », l'humour détraque, déconstruit parfois le lyrisme qu'il articule ou soutient de ses cocasseries, la narration, son double et son ombre, sa brise, ses effluves, prodiguant quant à eux les soins d'urgence promis à la réalité. De toute évidence, Dickens ne recourt à cet art aussi sévère que parodique, cette critique en somme, de la littérature par elle-même, qu'afin de hisser sa passion des mots à l'étage le plus élevé de son temps. Dialogues, récit presque fantastique, descriptions hallucinées (celle de la gare de Carlisle, bâtisse atteinte d'une maladie dégradante, folle, hirsute, grossière ou extrêmement raffinée dans ses inconvenances, pourrait se retrouver soixante-dix ans plus tard dans une chronique de Léon-Paul Fargue), on comprend que la Belle endormie dans son lit de grammaire est bien le seul objet, l'unique tourment de nos duettistes. L'asile que Bonenfant « passe voir » tandis que son compère se repose résume d'ailleurs la situation : « De longues allées d'arbres, d'hommes, de femmes en ruines ; d'interminables avenues de visages désespérés ; des chiffres dépourvus du moindre pouvoir de vraiment s'additionner dans un quelconque but concret ; une société de créatures humaines qui n'ont rien en commun sauf qu'elles ont toutes perdu la force d'être humainement sociables entre elles. »
La plupart des romans, la majorité des poèmes fermentent dans cette phrase.
Les « courses de Doncaster » peuvent dans la foulée conclure la série des reportages, « Dame Littérature », cravache à la main, s'est refait une beauté. Dickens, certes, caracole encore. Collins imite ironiquement les journalistes consciencieux mais, « cinglés, bookmakers et autres créatures obscènes » ayant le moral en berne, on ne rigole plus : la langue funambulesque du premier ne se rompra pas le cou, celle, un soupçon professorale du second, évitera les périls de la corde raide grâce à son balancier. En fait, la partie est jouée. La paresse, l'oisiveté que les morales laïques ou religieuses condamnent, engendrant dit-on tous les vices, le plaisir très physique d'écrire, péché moins véniel qu'il n'y paraît, affirme son caractère d'incontestable activité. Que la besogne soit scandaleuse la rend plus désirable : les « horribles travailleurs » de Rimbaud n'attendront pas longtemps avant de répudier la société industrielle et les forçats du labeur salarié.