Le désert, Rimbaud de Jean Esponde par François Huglo
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
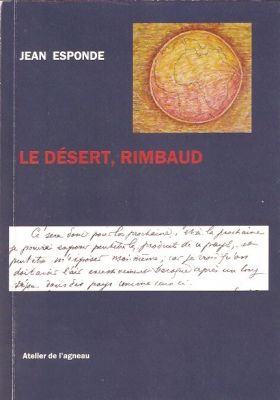
« La littérature ne doit rien produire d’autre que de littéraire (…) et l’on ne peut être pleinement reconnu comme écrivain que si l’on écrit des textes à effet social nul » (Nathalie Quintane. Pourquoi l’extrême gauche ne lit-elle pas de littérature). Ainsi, des « deux Rimbaud », l’un chasserait l’autre. « Parole poétique » (inoffensive) et « trafic » silencieux (inavouable) s’excluraient. Jean Esponde répond, rigoureusement et vigoureusement : il n’y a qu’un Rimbaud. Il est donc « temps de passer aux travaux pratiques. Le texte a déjà modifié l’existence. Il va produire du réel et de l’irréparable hors du champ littéraire ».
En un livre inclassable, à la fois documentaire et album, récit et essai, s’assemblent photographies, descriptions et dialogues dont la brièveté, le rythme, rappellent le cinéma, fragments de lettres témoins de l’aventure africaine et de poèmes européens qui la projetaient, la promettaient : Une saison en enfer surtout, mais aussi parfois Illuminations, et déjà Les poètes de sept ans : « (…) il faisait des romans, sur la vie / Du grand désert, où luit la liberté ravie, / Forêts, soleils, rives, savanes ! ». Le voilà, le désert : 500 km de la Mer Rouge aux montagnes d’Éthiopie, traversés par Rimbaud en 1886-1887. Le roman familial n’est pas étranger au « roman sans cesse médité » par le poète de sept ans. À peine arrivé à Harar, Ar-Arthur « réclame aux siens le dictionnaire arabe et d’autres papiers de son père comme le cahier Plaisanteries, jeux de mots, une collection de dialogues, de chansons, etc. ». Mort l’année précédente à Dijon, mais disparu depuis longtemps, ce père avait signé dans la « Revue d’Orient » un article sur les effets calamiteux des sauterelles de Sebdou, en Algérie. Dans « L’Écho d’Oran », l’officier Frédéric Rimbaud avait comparé Abd-el-Kader à Jugurtha, chef africain qui avait défié Rome. À son tour, Arthur âgé de quatorze ans, « dans une dissertation latine illisible pour sa mère », chante les louanges du résistant algérien. Plus tard, il choisira son camp : « celui d’une Éthiopie résistant à la colonisation, animée de la même énergie que les confédérations kabyles. Comme s’il voulait aussi compenser les choix de son père ». Quant aux échanges épistolaires avec une mère qu’il fait tourner « un peu plus en bourrique, d’Aden à Zanzibar », Jean Esponde commente : « Que ne faut-il pas accomplir pour plaire / déplaire à une mère douée pour moraliser, culpabiliser, dont il ne s’est jamais défait, avec laquelle il saura maintenant parler : argent, économies, richesse, mariage, respectabilité ».
Le roman familial s’inscrit dans le roman historique. « Deux ans après la République étouffée, puis la Commune écrasée », Une saison en enfer annonce une première rupture : célébrités artistiques et littéraires méprisées, Beauté injuriée, conversion à « la réalité rugueuse à étreindre ». Deuxième rupture, la réponse au copain Delahaye en visite à la ferme de Roche dans les Ardennes en août 1879. La littérature ? « Je ne m’occupe plus de ça ». Delahaye témoignera du goût de Rimbaud « pour les conversations en compagnie des ouvriers, des travailleurs ». Un devenir nègre prolongera et réalisera le « livre nègre ». Rimbaud sera « le premier blanc à pénétrer dans une communauté indigène », comme le voudra Lévi-Strauss. Il étudiera « l’arabe et le Coran en compagnie de quelque vieux lettré », entreprendra l’écriture d’une « somme ethnologique sur les Gallas », dans un contexte où « l’ethnologie naissante accompagne la colonisation ». Mais son adjoint Sotiro voyage « sous un costume musulman, avec le nom d’Adj-Abdallah et accepte toutes les formalités politiques et religieuses des indigènes ». Son endurance, son courage, gagnent le respect des Danakil, qui le considèrent comme leur égal. Dans le « dépeçage de l’Afrique », le « théâtre colonial » de la concurrence entre puissances, loin de « jouer au matamore, au conquérant, au Blanc supérieur », il demande « l’autorisation de traverser un territoire à ses habitants » et prend le temps « de négocier avec ses chefs », de même qu’il négociera « presque un an » avec les autorités françaises avant d’investir sa petite fortune, 6 ans de travail (de négoce : café, ivoire, gommes et or, pas de « trafic » !) dans des caisses de fusils et de cartouches à destination de l’Abyssinie, « le seul pays d’Afrique essayant encore de résister à la colonisation ». Il vaut mieux l’avoir pour alliée. Avec le jeune gouverneur Lagarde, « la France prendra la défense de l’Éthiopie », écrira plus tard le futur empereur Haïlé Sélassié. Alain Borer : « Rimbaud était "du côté" du libérateur de l’État éthiopien à travers la figure de Ménélik, et avec l’accord du gouvernement français ». Makonnen, jeune cousin de Ménélik et commandant de son armée, écrit à Lagarde « qu’il aimerait bien visiter la ville nouvelle de Djibouti », qui ouvrirait à l’Éthiopie « un passage pour accéder à la mer. Bientôt premier ambassadeur de France à Addis Abeba, Lagarde favorisera leurs achats d’armes. Celles fournies par Rimbaud et quelques autres, c’est un arsenal encore sommaire quand il s’agit d’affronter une Italie se prenant pour Rome », qu’écrasera Makonnen : « première victoire d’une armée africaine face à des Européens depuis Hannibal remarqueront des historiens ». Mais Rimbaud ne sera ni « Livingstone ou Stanley », ni « le Lawrence ironique de Ménélik », ni « pourquoi pas ambassadeur d’Éthiopie au Caire ». Il apparaît comme un « conquérant sec et narquois, sans victime et sans étendard, indivisible et sans espérance, toujours intact ».
Collégien à Charleville, Rimbaud se proposait déjà d’étudier la langue Amhara « quand avec des camarades il envisageait d’aller explorer les sources du Nil : gravures et récits de voyage lus dans "le Magasin pittoresque" ». Il voulait entendre et comprendre une Afrique que l’Europe prétendait dominer en l’ignorant. Dans « le travail poétique des mots » qui « écarte, déblaie, coupe, épuise le langage », Rimbaud « se désertifie ». Le désert, les armes, sont « la continuation de la poésie par d’autres moyens ». De la « liberté ravie » qui luit dans le « grand désert » du poète de sept ans, au Harar où Rimbaud revient par le désert après avoir écrit, du Caire, à son employeur d’alors, Alfred Bardley « Je ne puis plus rester ici parce que je suis habitué à la vie libre », se dessine un Rimbaud pour qui, écrira Bardley, tout est la plupart du temps « mal, mauvais, idiot », et à qui « pour exprimer tout cela », les mots « ironiques et drôles » viennent « d’abondance ». Un Rimbaud qui adore « la brousse et les déserts du Somali, les montagnes de Harar, l’inconnu et surtout ce qu’il appelait la vie libre, en ces pays ». Le négoce lui donne « pignon sur désert ». Mais devenir nègre, devenir désert, signifie aussi solitude. Illusions perdues ? Une saison en enfer annonçait : « J’ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien ! Je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs ! Une belle gloire d’artiste et de conteur emportée ». De Tadjourah, le 8 janvier 86, il écrira aux siens : « Enfin, l’homme compte passer les trois quarts de sa vie à souffrir pour se reposer le quatrième quart ; et, le plus souvent, il crève de misère sans plus savoir où il en est de son plan ». Jean Esponde suggère : « Si Rimbaud avait consulté la Sybille d’Érythrée, elle lui aurait peut-être annoncé le démantèlement de ses entreprises, l’effondrement de son orgueil ». Illusions perdues ? Peut-être pas. Si Une saison en enfer traçait le programme, les vers de Bannière de mai en assumaient les conséquences et les risques :
« Je veux bien que les saisons m’usent.
À toi, Nature, je me rends.
Et ma faim et toute ma soif.
Et, s’il te plaît, nourris, abreuve.
Rien de rien ne m’illusionne.
[…]
Et libre soit cette infortune ».