Les Enfances Chino de Christian Prigent par Jean-Paul Gavard-Perret
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
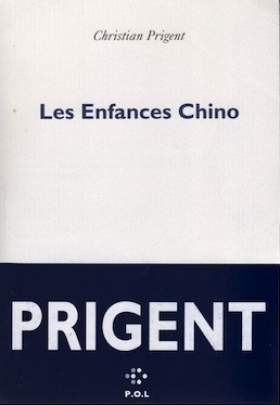
TOUS CEUX QUI TOMBENT (ET SE RELEVENT)
Insidieusement et bien plus intelligemment que ceux qui se lovent dans le sillon de l’autofiction Prigent poursuit ce qu’il avait commencé avec Grand-mère Quéquette. Il replonge le lecteur vers la fin des années 50 à une mode bretonne typique des sous-préfectures de bien des départements français de l’époque. Le centre ville est bourgeois, le péricentre manufacturier et ce qui n’est pas banlieusard appartient encore au monde agricole à la Maupassant. Dans ce marbré, Chino, le héros de livre, tombe du tableau de Goya intitulé Les jeunes. Souvenons nous que le jeune Prigent a comme il l’écrivit « tâté de la barbouille». Ses écrits sur les peintres témoignent de l'importance accordée aux arts plastiques. Ce fut au fond du fond du bureau de son père que l'enfant a découvert sur de mauvaises reproductions quelques chefs-d’œuvre mais pas ce Goya qu'il découvrira bien plus tard grâce à une commande du Musée de Lille. Beaucoup d’autres portraits du peintre vont s’animer : lavandières, jeunes filles, ombres énigmatiques etc... Un monde sort de la fiction picturale afin d’entrer dans le décor villageois. Chino n’est donc pas seul : ses semblables, ses frères et sœurs gardent dans la tête le sexe (« les cochonneries »), les exploits sportifs et les conneries qui feraient d’eux aujourd’hui ceux que d’aucuns aimeraient passer au Karcher.
Mais la criminelle engeance des banlieues n’est pour l’heure qu’un ramassis de petits voyous plutôt mal dans leur peau. L’interdit règne en maître entre jeunes filles rêvées et animaux . Les frustrations engendrées par les premières tournent en agression envers les seconds. Pour les sombres « héros » du roman drôle et de ce drôle de roman la conscience politique et un certain sens de l’Histoire se limitent aux plaques du nom des rues, à des monuments et à quelques rumeurs des radios. Bref tout vagabonde encore dans un clair-obscur plus proche de l’ombre que de la clarté. Comme celle de l’enfance qui se transforme en un monde adulte puisque en ces temps décalés l’adolescence était ignorée. Pour l’auteur, « faire fiction » revient à raconter cet échouage du sexuel. Ce qui suppose la mise en scène du leurre : du fantasme de fusion. En fiction « basique » ce fantasme passe par la mise en scène de l'extase amoureuse, du coït ininterrompu avec le rêve d'idylle.. « Il n'y a sans doute pas de littérature sans cette naïveté » avoue l'auteur. Mais il n’existe pas de grande littérature sans sa mise à distance cruelle. C'est à ce retournement auquel procède tous les grands auteurs comiques » de Rabelais à Kafka, de Shakespeare à Beckett.
Le lecteur retrouve dans ce livre tout l’acidité et la puissance de la vis comica et de la prose poétique de l’auteur. Elle se « dit » dans la voix et le souffle. Elle rappelle l’objectif premier que Prigent précisait dans son livre d’entretiens avec Hervé Castanet : « trouver le hors sens musical venant malaxer, engorger, gêner la fluidité facile et déréalisée du sens ». Si bien qu’une nouvelle fois sa fiction est un engagement du corps vivant (physique, pulsionnel) dans l'écriture. Fidèle aux « Emanations, explosions » de Rimbaud, « le pétomane » (comme il se nomme) lutte dans son texte contre l'asphyxie de la langue que l'usage communautaire pollue. Sa fiction engage une course de vitesse contre la fermeture stabilisée du monde tel qu’on l’a montée au sein de reproductions intellectuelles qui ne sont que des chromos (De Modiano d’un côté à Annie Ernaux d’un autre –- et pour ne pas citer les pires).
« Les enfances Chino » représente une résistance à la coagulation de la forme et du sens. Il reste son bégaiement systématique en une suite de glissements d'ondes, de mouvements syllabiques corpusculaires que, selon l’auteur, on retrouve toujours « où il y a de la voix : chez Racine comme chez Céline, chez Mallarmé comme chez Artaud mais aussi chez Schwitters ou Bernard Heidsieck ». Prigent reprend cette littérature où se perçoit le creusement de la voix. Elle emporte ici la nuée des figures, des images, des pensées. La « musique » du livre se façonne de son souffle impur, désaccordé, déformé à travers lequel la poétique fictionnelle au bout du compte informe et forme du monde.
Reprenant la fameuse formule de Lacan « Là où ça parle, ça jouit, et ça sait rien »,Prigent crée à la fois un corpus étrangement mélancolique et une vive sensation de l'incapacité des langues apprises et des formes répertoriées à donner l'expérience qu'on se fait des choses et de la vie. Chino et ses sbires rappellent combien le fond de l’être peut effrayer tant, écrit Prigent, il est « tissé de barbarie, ouvert à perte-pied sur la rumeur de l'inconscient, pulvérisé par la débâcle des corps et des choses dans le temps et l'atomisation de la matière ». Majeur un tel texte compose avec ce fond et lui donne existence. Par la bande surgit une morale qui n’est pas vraiment hédoniste – voire paradoxalement quelque peu masochiste et puritaine.Surgissent glissées des Goya et de la terre bretonne les lignes (tordues) de vie reforgées par l'exigence d'un gai savoir lucide et donc un peu cruel. Il fait en tomber, au fur et à mesure des près de 600 pages, bien des illusions affectives, amoureuses, conviviales, sociales, idéologiques, religieuses et épistémologiques.