Près des abeilles de Georges Navel par Hervé Lemarié
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
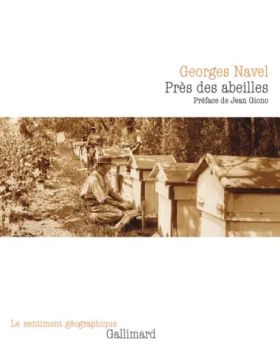
Admiré par Giono (qui signe la préface de Chacun son royaume, récit de 1960 dont Près des abeilles est un florilège), soutenu par Groethuysen et Paulhan, Georges Navel (1904-1993) a été négligé, pour ne pas dire oublié. Il est pourtant un écrivain de première importance. On peut le constater une fois de plus avec ce grand format de la collection « Le Sentiment géographique » illustré de photos issues des archives familiales.
Treizième et dernier enfant d’une famille paysanne presque illettrée et prolétarisée dans les fonderies de Pont-à-Mousson, le jeune Georges fait son miel de tout ce qui l’entoure ; il grandit plus vite que ses camarades « endormis » au contact des poilus qui se battent à un jet d’obus mais aussi de la nature dont, déjà, avec une grande acuité, il observe tous les reflets au fil des saisons. À douze ans il envoie promener l’école et se met à l’école de plusieurs maîtres : ses frères aînés Lucien et René qui fréquentent des causeries anarcho-syndicalistes, Bakounine, Kropotkine et Simone Weil. Il sera insoumis dans la vingtaine au sens administratif en refusant de faire son service militaire et en se déplaçant avec de faux papiers, mais on comprend à lire ses écrits retraçant son Parcours* qu’insoumis, il l’est d’emblée et pour toujours. Dès la fin des années 20 il fréquente la colonie de Bascon, dans l’Aisne, qui est à la fois communiste, anarchiste et végétalienne – c’est surtout une utopie réalisée. Les colons cultivent la terre non en agriculteurs, pas même en paysans, mais en jardiniers : « Aucun statut ne réglait le départ ou l’arrivée d’un ancien ou d’un nouveau camarade jardinier, ami de la nature et de la liberté. Aucun horaire ne réglait le travail, il pouvait choisir sa tâche parmi les tâches les plus urgentes du moment, travailler peu ou beaucoup, sa participation dépendait presque uniquement de son bon vouloir. » On y chasse « les mots en -isme » pour revenir à « la vraie vie ». Existence authentique, liberté absolue, bonheur, émerveillement, c’est le programme du poète, pas pour plus tard, mais hic et nunc, même après avoir quitté l’idylle libertaire pour louer sa force de travail car le réfractaire a développé l’art de s’employer sans s’aliéner. Autodidacte plus averti qu’un lettré il aurait pu choisir la main à plume au détriment de la main à charrue mais l’exercice du corps, même dans des conditions très difficiles – ouvrier en usine, terrassier, saunier, cueilleur, vigneron, apiculteur –, est le garant d’une indépendance de loup famélique refusant les franches lippées du chien attaché. Comme l’animal du fabuliste qui n’a que les os et la peau, Navel cavale, encore et toujours : « Il fallait courir, marcher, respirer fort, grisé de mouvement, ivre d'air bleu, présent à la vie par toutes mes fibres, la grâce des révélations soudaines dans un éclair me visiterait. Pour toujours, je serais relié au chant du monde. » Menée essentiellement dans le sud de la France, c’est une vie nomade, fruit non d’un manque mais d’un excès : « Je contenais trop de bonheur pour vivre à la même place ». Partout le manœuvre itinérant trouve son aise. Il a quelques secrets pour cela, qu’il révèle sans prosélytisme à ses lecteurs, des qualités surtout. Le courage physique n’est pas la moindre.** L’attention prêtée aux plus infimes éléments du réel en est une autre. Il ne quitte donc pas les mancherons, mais la militance active pour la littérature, hanté par Rilke et marqué par Rimbaud. Tout passe par les sensations et l’écriture qui se fait tantôt sobre comme son quotidien, tantôt lyrique comme une saison prodigue (« Il s’agit d’une opération de grand style » annonce Giono) : « Par la sensation de plénitude corporelle, je voudrais conquérir la joie de l’âme pour répondre par un sentiment de fête au miracle de la vie. » On comprend mieux pourquoi Navel n’entend pas lâcher le travail manuel : ce serait se couper du monde dont notre chair est le truchement (« La nature, écrit Novalis, est cette communauté merveilleuse où nous introduit notre corps ») : « Les fruitiers étaient en fleurs, le cerisier comme proche compagnie, baigné de bon air et de soleil, je travaillais avec bonheur, malgré mes courbatures. Je passais là-haut mes plus belles heures. » Il dort dans un cabanon ? aubaine pour mieux entendre les hululements ; il crèche au grenier ? « plus près du vent, plus près de la nuit, des grosses pluies battantes ».
Le récit s’émaille de petites descriptions d’une si juste vigueur qu’on croit voir un Cézanne. Parfois la notation prend des airs de haïkus : « Le long du talus, des chênes-lièges rompent les alignées de pins. La lumière vibre. » La cueillette des kakis ou le ramassage des châtaignes sont l’occasion d’une communion intense : « Les yeux fermés, dans l’effacement de mon existence, un moment le souffle suspendu, j’essayais de rejoindre le silence du caillou ou de la sève des arbres pour attendre l’illumination espérée : la connaissance du plus haut bonheur ».
Seul parfois, il retrouve régulièrement Sylvie avec qui il se baigne près des salins, oubliant avec elle dans « le clapotement des vagues, le sable, le cri des cigales, l’ombre des pins [...] les champs de sel et leur éclat. » Occasionnellement il s’associe avec des indociles de sa trempe. Autre secret pour la chasse du bonheur, la société choisie : « Je trouvais un vif sentiment de fierté à pouvoir travailler selon mon bon plaisir et jamais à regret, la présence d’un compagnon écartait l’ennui, Léon piochait posément, son rythme modérait ma fébrilité ». Et si la conversation s’empèse, « les neiges des Alpes, les fleurs rosées sur les arbres en février enlevaient leur sérieux à [leurs] échanges ». Un autre acolyte a trouvé, comme Navel, la recette du bonheur : « Heureux de respirer les odeurs de la pinède, le souffle venu de la mer, de passer de l’ombre au soleil, il profitait de tout, Augustin, pour en faire du plaisir, même du bruit de ses souliers sur les aiguilles de pins. » Le grincement d’une roue de brouette n’est pas moins à goûter que l’hymne sibilant des passereaux « au tablier rouge » ; pris d’une « bonne fatigue » le soir, le travailleur peut se vouer à la contemplation des étoiles avec un sentiment de dilatation cosmique.
Cette merveilleuse langue poétique et fraternelle est là pour nous le rappeler : la sobriété peut être souriante, la frugalité heureuse. « Libre comme un patricien, je n’ai ni esclave ni chèvre à l’attache. Mon genre d’existence s’accorde aux perspectives d’une société où les hommes émancipés de l’esclavage du travail par celui des machines cultiveront tous leurs dons et leur pouvoir de création ».
* Bel ouvrage également réédité en ce début d’année (Gallimard, « L’Imaginaire », 1950).
** En témoignent le livre Travaux (1945), qui l’a fait connaître, et son engagement dans la guerre d’Espagne.