Que pense le poème ? d'Alain Badiou par Guillaume Artous-Bouvet
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
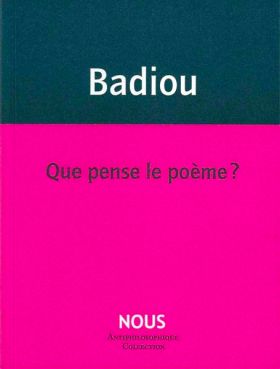
Que pense le poème ? recueille neuf textes déjà parus, à quoi s’ajoute un entretien inédit d’Alain Badiou avec Charles Ramond, et que précède une préface de l’auteur. S’il ne s’agit pas, bien sûr, de la première intervention badiousienne sur le terrain d’une philosophie du poème (Théorie du sujet, Conditions, Petit manuel d’inesthétique, sans même évoquer L’Être et l’événement, ayant manifesté en leur temps l’intensité d’un tel souci), l’ouvrage constitue en effet, comme l’indique la quatrième de couverture, « le premier » que le philosophe consacre entièrement à la poésie. Il reprend, et parfois approfondit, sous les aspects d’une prose condensée et pédagogique, les propositions déployées par l’œuvre antérieure.
Elles s’articulent selon trois directions, qui interrogent trois relations : poésie et philosophie, poésie et politique, poésie et poésie, si l’on veut bien accepter que cette dernière formule recouvre d’une part l’exercice du commentaire de poèmes singuliers, d’autre part, la tentative d’une définition (philosophique) de la poésie. Cette recension, sans prétendre éclairer l’entier du livre, se contentera d’envisager ces trois perspectives, et de les aborder du point de la poésie elle-même, si cela se peut, et non à partir de sa position fonctionnelle dans le système philosophique badiousien, où elle apparaît comme une condition de la pratique philosophique, aux côtés de l’amour, de la science et de la politique.
Si le livre emprunte son titre au premier texte qu’il présente, « Que pense le poème ? », publié pour la première fois en 1993 dans L’art est-il une connaissance ?, c’est bien que cette seule question commande et rassemble celles dont, liminairement, elle inaugure la posée. Elle nous permettra d’aborder la première relation que nous évoquions, qui confronte poésie et philosophie. Badiou l’affirme avec force : « Il faut réserver le mot “connaissance” à ce qui se soutient d’un objet, l’objet de connaissance », or « le poème ne vise, ni ne suppose, ni ne décrit aucun objet, aucune objectivité » (p. 19). C’est que le poème « ne relève pas de la communication », et constitue « seulement un dire, une déclaration qui ne tire son autorité que d’elle-même » (p. 14) comme le montre telle séquence rimbaldienne, trouvée dans « Mémoire » :
Ah ! la poudre des saules qu’une aile secoue !
Les roses des roseaux dès longtemps dévorées !
Ce que Badiou commente ainsi : « Qui parle, et de quel monde s’agence ici la nomination ? Devant quoi faut-il ainsi entrer dans le partage d’une exclamation ? rien dans ces mots n’est communicable » (p. 14). Cette incommunicabilité poétique ne se réalise toutefois qu’au prix de la découpe de ces deux vers, séparés de ceux qui les suivent immédiatement, en clausule du poème, et qui les rappellent à la nécessité de leur contexte :
Mon canot, toujours fixe ; et sa chaîne tirée
Au fond de cet œil d’eau sans bords, — à quelle boue ?
Ce complément contextuel appelle deux remarques :
1/ L’énigme du décor déployé par les deux premiers vers peut être partiellement résolue ; on évoquera le pollen des saules, levé par l’envol d’un oiseau, ainsi que la paronomase étymologique qui justifie l’expression « roses des roseaux » – sinon leur dévoration, peut-être liée aux assauts de l’été, métaphore tropique, dans « Mémoire », du temps lui-même.
2/ La parole poétique (« qui parle ? », demande Badiou) dépend visiblement d’une autorité assignable : celle d’un sujet « fixé », au centre d’un plan d’eau (« quel monde ? »), qui s’interroge classiquement sur sa propre origine, c’est-à-dire sur cette boue primordiale en quoi il s’enracine.
Nous dirons donc, pour compléter le commentaire de Badiou, que le poème dramatise la question de sa propre autorité (conformément à l’intuition du philosophe), en déployant une surface de lisibilité non problématique. Dès lors, si l’on peut dire que le poème « n’a pas d’objet » (p. 19), c’est en cela qu’il ne cherche pas d’abord à déployer l’objectivité partageable d’un monde, mais endure plutôt la profondeur résonante d’une question.
D’où la remarque de Badiou, affirmant dans des termes proches de ceux de Conditions (1992), qu’une grande partie de l’opération du poème « vise précisément à renier l’objet, à faire que la pensée ne soit plus dans le rapport à l’objet », ce qui revient à viser « à ce que la pensée déclare ce qu’il y a en déposant tout objet supposé » (p. 19-20). Opération de soustraction, chez Mallarmé (où il s’agit d’énoncer « l’être, ou l’idée, au point même où l’objet s’est évanoui », p. 20), de dissémination, chez Rimbaud (qui tend « à dissoudre l’objet par son infinie distribution métaphorique », p. 21).
Ce premier développement ne doit pas laisser croire, toutefois, à l’intransitivité absolue du poème : la dissolution de l’objectivité n’est pas le signe d’un renoncement poétique à « dire » ou à « penser », mais bien la conséquence d’une ambition, de nommer « ce qui est, en tant qu’il est » – cet être en tant qu’être ne se définissant, chez Badiou, qu’à partir d’une hypothèse soustractive. Or c’est précisément au point de cette ambition que le poème se distingue de la philosophie, vouée quant à elle, comme le montre Badiou à l’occasion d’une lecture de Platon, à l’exercice de la dianoia (ou « traversée argumentative »), démarche qui ne saurait rendre compte du Bien ou de l’Un, « soustraits à l’objectivité intelligible » (p. 26). De ce discord, Badiou donne une seconde formulation : la philosophie, essentiellement « traversante » et réflexive, peut être définie comme tentative de « penser la pensée », d’être une « pensée de la pensée », tandis que la poésie apparaît comme une « pensée en acte », une « pensée sensible » (p. 26), dans laquelle ce qu’il y a se donne dans l’efficience d’une autorité sans condition.
La philosophie, en ce sens, se soutient du désir de penser quelque chose (fût-ce la pensée elle-même), tandis que la poésie pense ce rien, à savoir que quelque chose soit. Ainsi de ce poème d’Álvaro de Campos, hétéronyme pastoral et prolixe de Fernando Pessoa, extrait du Gardeur de troupeaux (p. 35) :
Ne penser à rien
c’est avoir une âme à soi et intégrale
Ne penser à rien, c’est vivre intimement
le flux et le reflux de la vie.
Et ce quelque chose, qui est, sans n’être rien d’objectif, peut se dire ainsi chez Trakl, dans deux occurrences distinctes saisies par Badiou : « il y a une lumière que le vent a éteinte », ou encore, dans « Elis » de Sébastien en rêve (p. 18) :
Un gibier bleu
Saigne lentement sur le hallier d’épines.
Un arbre brun est là, debout, séparé.
De qui sont tombés les fruits bleus.
Les signes, les étoiles
Sombrent lentement dans l’étang.
Dans le commentaire de Badiou, à la même page : « tout cela m’est accordé comme une évidence que seul le poème institue » – évidence dont nous dirons cependant qu’elle se trouve, comme dans l’exemple rimbaldien, disposée à la fois comme littéralité sans cause (ou pur « il y a » du monde), et interrogation radicale sur sa propre autorité.
La confrontation s’aiguise toutefois dans la configuration historique spécifique* que Badiou désigne comme « âge des poètes », dès lors que, comme l’écrit le philosophe, « les poètes de l’âge des poètes sont ceux où le dire poétique non seulement est une pensée et instruit une vérité, mais aussi se trouve astreint à penser cette pensée » (p. 31), dans un acte pourtant soustrait à toute réflexivité. D’où une redéfinition du partage précédemment évoquée, que Badiou explicite dans le texte largement consacré à Platon et intitulé : « Philosophie et poésie : au point de l’innommable ». Comme il l’écrit, dès lors que « le poème moderne s’identifie lui-même comme pensée » (p. 67), la philosophie ne peut plus saisir « le couple du poème et du mathème dans l’opposition simple de l’image délectable et de l’idée pure » (p. 69). Elle doit alors assumer qu’il existe un point de communauté « disjonctive » entre mathématique et poésie, qui est, dit Badiou, le « point ou l’une et l’autre de ces pensées trouvent leur innommable » (p. 69) : « multiple pur comme inconsistance primordiale de l’être en tant qu’être » (p. 70) pour la mathématique, « multiple comme présence venue aux limites de la langue » présentifiant la notion pure du « il y a », pour la poésie (ibid.).
Ce qui peut se dire autrement : poésie et mathématique se rencontrent dans l’épreuve d’un innommable commun, qui signale l’exception de l’être en tant qu’être au dispositif formel qui prétend le saisir (mathème ou poème). D’où une égalité de principe quant à ce qu’on pourrait désigner comme leur pertinence ontologique – égalité entre mathématique et poésie que la philosophie doit reconnaître sans toutefois y quérir les voies d’un accès immédiat à l’Être lui-même. Le sens véritable de cette reconfiguration historique aura d’ailleurs, selon Badiou, été manqué par Heidegger, qui tend à identifier la philosophie à la poésie, en prêtant à cette dernière une force spécifique de nomination de l’Être, dans un geste de dévaluation du mathème qui semble converse à celui de Platon. D’où ce jugement sévère, considérant que « Heidegger prophétise à vide une ré-activation du sacré dans l’appariement indéchiffrable du dire des poètes et du penser des penseurs » (p. 56).
La réflexion concernant la relation entre poésie et politique, elle aussi, suppose de discuter la condamnation platonicienne du poème. Comme le rappelle Badiou, Platon « nous dit sans détour que ce qui sert de mesure au principe politique est proprement l’exclusion du poème » (p. 61). Ce qu’il faut lire en prenant la mesure conséquente de la place éminente accordée à la question poétique, dans la proposition politique de la République. L’intervention de Badiou, sur ce point, est double : d’une part, elle consiste à relativiser l’importance de l’interprétation usuelle, qui suggère « que le poème interdit, situé qu’il est à une distance double de l’Idée (imitation seconde de cette imitation première qu’est le sensible), tout accès au principe suprême dont dépend que la vérité du collectif advienne à sa propre transparence » (p. 61). Le philosophe montre que c’est bien plutôt son immédiateté inobjectivante que Platon reproche au poème, à quoi il oppose la patience argumentative du philosophème – reproche dont la partialité s’établit à partir de l’hypothèse d’un « âge des poètes ».
Mais d’autre part, le philosophe évoque, hors contexte platonicien, l’existence d’un « lien essentiel entre poésie et communisme, si l’on prend “communisme” au plus près de son sens premier : le souci de ce qui est commun à tous » (p. 139). Ce qui peut se dire ainsi : la poésie, dans l’effort même qu’elle déploie pour soustraire l’Être à l’objectalité, c’est-à-dire pour en manifester la brûlante exception au discours lui-même, témoignerait du « désir que les choses de la vie soient comme le ciel et la terre, comme l’eau des océans et le feu des broussailles dans un soir d’été, c’est-à-dire, appartiennent de droit à tout le monde » (p. 140). Effort « dans » la langue, ou « en » langue : « Or, ajoute Badiou, la langue est ce qui est donné à tous dès l’enfance comme un bien absolument commun » (ibid.). La poésie se donne donc comme ce qui, dans l’élément d’une langue commune, affirme l’exception de l’Être à la langue (c’est-à-dire la résistance silencieuse des choses), et sans doute par conséquent, l’exception de la langue à elle-même, en tant qu’elle ne peut jamais faire l’objet d’une privatisation intégrale par un style ou une signature. L’apparente idiomaticité poétique n’étant rien d’autre en ce sens que le symptôme d’un effort singularisant qui, par l’écart différencié qu’elle rend visible, retrempe, selon l’expression de Laurent Jenny, la langue dans sa propre généralité.
La force générale de la poésie dépend en ce sens des interventions locales des poètes, qui doivent être saisies dans leur singularité. Ainsi s’explique la présence insistante de certains noms propres, dont ceux, notables, de Paul Celan, de Fernando Pessoa (et ses hétéronymes), ou de Philippe Beck. Alain Badiou consacre également un texte à Gerard Manley Hopkins et Wallace Stevens, évoquant tous deux « la figure du soldat », exemple remarquable de cette « localité » de la vérité poétique, en quoi s’inscrit lisiblement sa dimension politique : « L’humanité comme totalité naturelle n’existe pas, car l’humanité est identique aux victoires localisées qu’elle remporte sur son élément d’inhumanité immanent » (p. 80). De même, tout poème réel doit être compris comme la tentative locale et comme telle, limitée, de rendre lisible une humanité habitable. La convocation des poèmes de Pier Paolo Pasolini permet quant à elle de préciser les coordonnées de la situation politique présente, dans le refus réaffirmé d’un compromis : « Si même l’idée de révolution est obscurcie, il demeure que nous ne pouvons accepter ni l’affirmation sans destruction [c’est-à-dire le compromis avec la « “démocratie” représentative et parlementaire » (p. 107)], ni la destruction sans affirmation [c’est-à-dire le terrorisme conçu comme « amour de la haine », (p. 110)] » (p. 111).
Quant à ces propositions poétiques locales, le geste de Badiou consiste le plus souvent à proposer une paraphrase orientée, et pensive, de telle ou telle séquence – ce qui se remarque en particulier dans le champ de la réflexion concernant la politique du poème, où le postulat de transitivité est frappant. Ainsi du commentaire de « Vittoria », de Pasolini :
Ce poème est un manifeste pour la vraie négation. Son motif capital est le suivant : si l’opposition est séparée de la destruction, comme elle l’est au régime de la « démocratie » représentative et parlementaire, nous avons comme résultat la haine et le désespoir. Le symbole de ce résultat est que les héros morts de la dernière guerre sont amenés à fusionner avec les ouvriers méprisés de nos banlieues dans une sorte de figure terroriste. (p. 107)
On le notera, une telle disposition méthodique ne diffère pas essentiellement de celle de l’exégèse heideggérienne. Ainsi de tel passage où Alain Badiou cite « Philippe Beck partant pour le poème comme s’il partait pour la guerre, guerre d’autant plus dure que, ainsi que le lyrique, elle est la guerre pour la puissante paix de la langue » (p. 136). Il s’agit des huit premiers vers de la sixième « Lyre d’& », dans Lyre dure (Nous, 2009) :
Le champ
de pensées à façon,
un drap cousu,
volume de fleurs pâles,
établi,
je monte à cheval.
Pour parestre ou parêtre.
Dans la dureté non violable.
Ce qui se lit ainsi, au titre, donc, d’une « paix de la langue, où finalement, nous rencontrerons, pour chacun et pour tout le monde, la chance de reconstruire le monde avec les outils qui ont été abandonnés dans sa construction » (p. 136). Dans l’intensité même de sa véridiction euphorique, le discours philosophique ne dit rien de la singularité expressive qu’une stylistique du poème, fût-elle élémentaire, reconstituerait aisément. Entendons-nous bien : il ne s’agit pas ici de contester l’extraordinaire acuité de la lecture badiousienne au nom d’une autorité disciplinaire exogène (celle de la critique littéraire, s’opposant, dans la gestique d’un vieux conflit, à celle de la philosophie). Bien plutôt cherchons-nous à reconnaître ce qui, dans l’opérativité du concept, risque d’oblitérer la nécessité d’une lecture stratifiée, au nom de l’innommable lui-même – innommable qui, paradoxalement, assigne la force de vérité poétique à ce que disent les noms, dans leur substantialité sans équivoque.
N’en prenons que deux exemples :
1/ Le vers « Le champ / de pensées à façon » fait travailler, d’une part, l’effet d’une syllepse qui détermine la pensée non seulement comme pensée pensive, mais aussi comme fleur multipliée (s’il s’agit bien d’un « champ de pensées », malgré l’enjambement). Or ces pensées florales sont pensées « à façon », c’est-à-dire « sur commande », faites pour autrui, d’après une matière héritée – même si elles se laissent justement façonner, c’est-à-dire marquer au coin d’un style. Ce qui se redit, au vers 4, par l’expression « volume de fleurs pâles / établi », que l’on doit lire doublement : l’établi est le lieu d’un travail possible, de la production singulière, ou floraison, mais aussi de l’établissement pâli d’une tradition qui risque toujours d’interdire l’inédit.
2/ La dérivation étymologique qui rappelle, au vers 7, que paraître (sens de l’action de celui qui « monte à cheval ») se disait au XVIIe siècle « parestre », ou « parêtre », témoigne à son tour de l’ambivalence essentielle qui transit l’entrée dans le discours : où il s’agit d’apparaître dans la singularité neuve d’un « être » dont on souhaite l’inviolabilité, mais où l’être lui-même appartient au « parêtre », c’est-à-dire au paraître des apparences instituées : « volume de fleurs pâles / établi », ou « pensées à façon ».
Au total, il faut dire que l’intervention badiousienne impressionne, et convainc, notamment lorsqu’elle livre, à partir d’une lecture de Celan, telle définition du poème :
…quand la situation est saturée par sa propre norme, quand le calcul d’elle-même y est inscrit sans relâche, quand il n’y a plus de vide entre savoir et prévoir, alors il faut poétiquement être prêt au hors-de-soi. Car la nomination d’un événement, au sens où j’en parle, soit ce qui, supplémentation indécidable, doit être nommé pour advenir à un être-fidèle donc à une vérité, cette nomination est toujours poétique : pour nommer un supplément, un hasard, un incalculable, il faut puiser dans le vide du sens, dans le défaut des significations établies, au péril de la langue (p. 58-59).
On souscrira sans peine à cette proposition, que le poème relève de la « nomination d’un événement », c’est-à-dire de la nécessité de phraser non pas l’institué du monde (ou « situation saturée par sa propre norme »), mais ce qui vient en étonner l’ordonnance. Événement ne désignant pas seulement ici le réel d’un bouleversement, mais aussi, ce nous semble, la révélation qu’il y a dans le monde davantage que son idée. L’effort du poème est de dire que quelque chose manque au dire : que « dire » ne dit pas le tout d’un réel excessif, et d’un monde qui échappe à toute totalisation discursive. D’où en effet cette puisée « dans le vide » du sens, et l’épreuve d’un « péril de la langue ».
Mais nous nous interrogeons sur l’usage insistant du lexique du nom (nommer, nomination, innommable) pour définir et penser une poésie non « dianoétique », c’est-à-dire non discursive. Ces termes semblent suggérer que l’enjeu réside dans l’insularité substantive d’un nom, marquant elle-même tantôt, l’évidence sans équivoque d’une idée, tantôt l’impossibilité même de la nomination, sur le modèle du styx mallarméen. Ce qui, au plan de la méthode même du commentaire, donne lieu, tantôt à une déclaration d’incommunicabilité (le pur « il y a » assigné à Celan ou Rimbaud), tantôt à la traduction immédiate, dans une prose philosophique, de la diction poétique. Or il nous semble que si la poésie peut être fidèle à l’événement, au sens de Badiou (c’est-à-dire à un « vide » du réel indiquant que le réel tel qu’il semble établi n’est pas tout), c’est en tant qu’elle dispose syntaxiquement, dans l’héritage non réductible d’une langue, la possibilité toujours équivoque, et inquiète, d’une autre langue – c’est-à-dire plutôt d’une autre grammaire, d’une autre diction, que d’autres noms. Et c’est bien cette équivocité, dont Badiou a constamment l’intuition, mais dont il ne restitue que trop rarement l’agencement singulier, qui détermine simultanément le poème comme évident (on comprend ce qu’il dit, puisqu’il s’écrit dans une langue commune), et comme énigmatique (ce qu’il dit n’est rien, qui soit de la langue et du monde tels qu’ils sont, puisque le poème réveille l’étrangeté même de la langue commune, et le scandale d’un réel qui, excédant sa propre représentation – i.e. sa propre norme – pourrait toujours être un autre).