Ascension de Guillaume Condello par Guillaume Artous-Bouvet
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
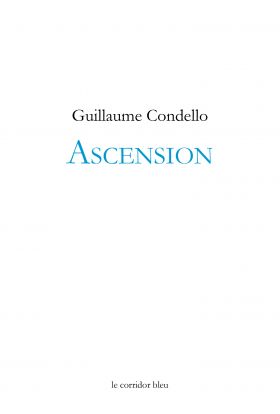
Qu’est-ce qu’une ascension ? Un trajet vers (le) plus haut qui dépend de la relativité d’une éminence, c’est-à-dire aussi bien de la mesure d’une descente, et peut-être d’une déchéance. C’est le premier paradoxe à quoi l’Ascension, dernier livre de Guillaume Condello (Le corridor bleu, 2018), doit nous rendre attentifs, au-delà de la matière de l’anecdote restituée par Pierre Vinclair sur son blog *: l’ascendre suppose une déclivité inverse, dont l’impression sensible continue d’habiter le mouvement de la montée. L’ascension peut donc se dire d’un langage qui, tandis que le corps (parolier) monte ou du moins y prétend, fait plutôt l’épreuve d’une descente, d’un approfondissement intérieur ou intime.
Le double exergue (Sôseki / Saint Augustin) y insiste, qui marque d’une part que le « poète a le devoir de disséquer lui-même son propre cadavre », de l’autre, que dans l’admiration voyageuse du monde (« cimes des montagnes, vagues de la mer, vaste cours des fleuves… »), les hommes « se délaissent eux-mêmes ». Monter ne doit pas signifier se quitter. Ceci, donc « n’est pas de la littérature / de voyage c’est encore / de la littérature » (p. 20). Malgré les paysages, les visions, les « nuages » de la Chine ancestrale (p. 22-23)
versant le lait la lumière
de la lune sur les ornières de
la route défoncée
sera-t-elle un jour terminée
versant
sur les champs inondés
la nuit liquide et
l’odeur atroce du purin
l’odeur atroce de
la nuit
le silence
Qui font parfois tableau, sous régime de l’ekphrase, où passe peut-être estampée telle image évasive, et future (p. 39) :
un tableau
ou dit-on autrement
ici
montagne enveloppée ou
entourée par
brume
langues de vapeur impalpables presque rien un néant blanc qui bouge plus tard nous y serons ce n’est
que de loin
qu’on peut les voir
Il faudrait pouvoir monter vers soi, avancer, donc, dans le souci d’un soi que seule telle ascension pourrait faire advenir : soi qui est à la fois soi futur (révélé au terme de l’effort), mais aussi soi passé (qui s’éclaire en se quittant, dans le mouvement d’un départ où soi s’arrache à soi). Il faut donc progresser dans la conscience étrange que c’est (toujours) déjà soi qui monte vers soi, et dans l’épreuve de l’épuisement qui marque moins la révélation d’un soi neuf, que l’impossibilité peut-être pathétique de se départir de soi. C’est en ce sens, nous semble-t-il, que l’expérience de l’ascension peut constituer un véritable exercice de subjectivation : celui qui monte (vers soi) faisant d’abord l’épreuve de sa propre pesanteur. L’ascension mesure donc moins le mouvement d’un arrachement à soi, que la descente intime selon laquelle soi s’éprouve demeurant, incessamment, rivé à soi. C’est en ce sens, également, que la proposition de Condello se distingue de celle de Pétrarque, dont l’ascension du mont Ventoux (1336) donne lieu, comme on sait, à quelque réconciliation avec (le) plus haut.
D’où certaine impuissance poétique, qui ne cesse de rappeler la force d’une gravité qui atterre (p. 23) : « je n’aurais pas la force / de faire cela / de savoir leurs travaux et leurs soucis du terme / je n’aurais pas la force / eux non plus ils sont rivés / à terre ». Bien sûr, l’ascension semble simple, en ses « premiers pas » (p. 26-27) : « et les premiers pas sont simples / sur le / chemin / pavé je ne pensais pas / que ce serait comme ça je pense / aux grands espaces / alpinisme / Thoreau ». Toutefois l’ami « marche devant », et le poète reste derrière, pensant qu’il va « vomir » (p. 35) : « je ne suis plus entraîné / et je couvre ma mollesse de cette excuse ». L’ami (Vinclair) est celui qui monte vite : « mon ami devant il est / plus rapide » (p. 41) ; « il marche / plus vite que moi je le suis / je souffle et je marche et / j’ai soif nous n’avons pas assez d’eau » (p. 42).
Difficulté d’ascendre qui recouvre en effet quelque impuissance à dire (p. 22-23) :
je ne voudrais pas savoir
et je ne saurais pas dire
leurs soucis de paysans
poète prophète ou aède
qu’importe
au monde mes
profondes vues politiques
c’est
encore
de la littérature
C’est pourquoi tout se passe comme si le monteur prononçait une élégie paradoxale, où se dit le regret de la descente qui habite l’ascension, comme de l’impuissance qui hante l’intention de dire. D’où ce tout début du « Prologue », peut-être – dans un livre constitué dudit prologue, d’un épilogue, et de trois chapitres centraux (p. 11) :
sanglotant
à gros sanglots longs disant :
(il n’en est pourtant encore
qu’au printemps
naissant)
Il faut donc serrer les dents sur un regret qui commence dès l’enfance, ou la jeunesse extrême (« printemps naissant ») (p. 11) :
je serre les dents et ravale
ce qui remonte
dans la gorge
serrée les dents
découvertes sur les crânes ça fait toujours comme une grimace un air hostile ils
voudraient pourtant pitoyables et leur regard insondable comme la tristesse une étreinte
encore saint Jérôme
Un second paradoxe s’inscrit, nous le voyons, dans la définition de l’ascension : c’est qu’elle ne s’accomplit pas selon la continuité d’un mouvement, mais au gré du discontinu d’une progression heurtée, suivant l’insistance d’un langage qui cherche sa vérité formelle parmi le dispars des proses. Ainsi, la verticalité du vers, qui dramatise le mouvement d’une descente de l’œil sur la page où s’effectue, selon la conversion paradoxale que nous évoquions, l’effort même d’une montée, se trouve-t-elle continuée et contrariée par l’horizontalité d’une prose traversière et discontinue, elle-même imponctuée (les dents serrées du vers se trouvent prosaïquement, i.e. génériquement, reprises en dents de crânes). De là, ce prosimètre en quoi consiste ce livre, lui-même travaillé par une force de répétition où s’inscrit l’effort continué de l’ascension (p. 51) : « pourtant nous n’avons pas assez d’eau (encore une fois) ni de nourriture (encore une fois) ». La prose (prosaoratio) rappelant parfois qu’insiste un monde de prose, qui suscite une ethnographie parenthétique et frivole (p. 65) :
(à côté de nous deux russes (ukrainiennes) (riches ?) échangent des syllabes (bruits) l’une d’elle porte une couronne de fleurs (traditionnelle ?) et en face de moi je vois deux blondes beaucoup d’Occidentaux (des couples mixtes aussi (comment ne pas soupçonner un rapport intéressé ou plutôt (aussi ?), chez l’occidental (bien souvent l’homme est occidental et la femme chinoise, c’est comme ça, je ne sais pas pourquoi c’est comme ça, sans doute qu’on pourrait interpréter ça à travers une grille féministe mais aussi)
Dans l’ascension se joue en somme quelque quête, qui suppose l’assomption toute première que le réel excède nos forces et nos lexiques (p. 17) :
il y avait des arbres je les lui nommai [au fils] mais je ne les connaissais pas tous il me fallait bien lui
donner une catégorie pour saisir ce qui se présentait car ce n’étaient pas des chênes alors j’ai usé de
mon savoir si grand
que
je ne peux répondre à cette question
je cherche
comment vivre
en poète
Si cette question n’admet pas de réponse formalisée, le livre nous indique une double direction, esthétique et éthique : on peut ainsi songer à la référence à Confucius témoin d’un homme prisonnier d’une cascade, qui « aurait dû être noyé mais toujours […] remontait à la surface et pouvait même / remonter / le courant » (p. 14) : personnage, commente Condello, qui fait « corps avec le cycles des causes et des effets » et « suit le mouvement de l’être » (p. 15). Or faut-il dire que cette morale s’applique à la « vie », dont on doit accepter le mouvement pour parvenir à l’habiter « en poète » ? Ira-t-on jusqu’à supposer qu’au regard d’un parleur plongé dans les « remous » de la langue, la forme prosimétrique correspond bien à cette alternance des temps de résistance (le vers) et d’abandon (la prose), suivant, donc, le mouvement de l’être qu’est la langue même ? De cette tentation nous préserve la fin d’Ascension, qui rappelle que la question d’enfance doit « demeurer », devant la sourde bienveillance des pères (p. 72) :
j’ai laissé mes fils
et leurs questions
à mes parents
le grand joue silencieux
pour l’instant là
dans la pièce à côté le petit
hurle ne peut pas dormir
il a mal aux dents je mets
des boules quiès
C’est qu’à la différence de l’expérience de la cascade, celle de l’ascension suppose son dédoublement esthétique, qui lui confère un début, et une fin, tout en la constituant, nous l’avons vu, comme le trajet d’une conversion sans conversion : et c’est le troisième paradoxe, que ce trajet ne mène nulle part qu’au « silence » de la question, lui-même tissé du jeu calme d’un grand, et du hurlement assourdi d’un petit. Silence, ou « bruit des choses elles-mêmes », comme l’écrit Condello, dans une séquence de prose qui marque qu’en effet, quelque chose du réel échappe à l’entente du poème (p. 45) :
impossible d’aller trop près le rideau des feuilles c’est une toile les tableaux du peintre dans sa voiture
mentent ils la regardent de loin on n’y entend pas ce bruit stridulation je ne sais pas dire insectes sans
doute le bruit des choses elles-mêmes si l’on pouvait entendre, tendre les antennes et écouter le
cosmos lui-même vibre des ondes traversent tout et nous voilà nous y sommes
Où se remarquent ultimement l’impossibilité d’un accès, le mensonge de l’art, et la tentative poétique toutefois, ascension forcenée pour nommer sans savoir (« je ne sais pas dire ») le bruit blanc du réel – ce qui ne s’entend pas.
* Voir ici :https://vinclairpierre.wordpress.com/2018/03/13/ascension-par-guillaume-condello/: « En août 2016, alors que j’habitais à Shanghai, Guillaume Condello est venu me rendre visite. Nous sommes partis à la montagne de Shenxianju, avec nos carnets et ordinateurs ».