Rehauts n° 51 par Tristan Hordé
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
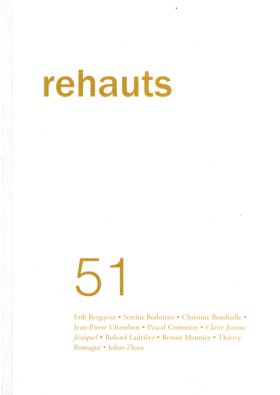
Par quoi commencer la lecture d’une revue de poésie ? Ce n’est pas un roman, il est donc agréable de feuilleter et, par exemple, de lire d’abord un écrivain que l’on ne connaît pas, ou le hasard faisant s’arrêter ici ou là. Cette manière habituelle de faire est cette fois en défaut : la livraison s’ouvre avec un long poème de Pascal Commère au titre qui intrigue, "Le voyage de la mère".
Le voyage de la mère, c’était vers sa fin (« Mère est morte ») ; un autre voyage, en train, celui du narrateur, semble ne pas avoir d’autre but que méditer sur ce voyage définitif. La mère est toujours absente présente, un "vous" lointain ou un "tu" suivi d’un futur. Disparue, elle demeure inconnue : le narrateur prend conscience de la distance qu’il y eut entre elle et lui et constate qu’il en ignore l’essentiel (« je sais si peu de toi ») ; à la question « De toi / que reste-t-il », il ne peut répondre qu’en détaillant un « fatras » d’objets de la vie quotidienne. En outre, hésitation constante entre ce qui revient à la mémoire et le sentiment d’un temps définitivement perdu, d’une reconstruction impossible :
Je ne sais rien de moins depuis que tu n’es plus,
rien de moins rien de plus
sinon que j’ai perdu le fil. Sans sa toile
l’araignée ne peut monter très haut.
Je ne sais pas filer mes doigts n’accrochent rien.
C’est cette hésitation, lisible ici dans le second vers, qui est à la base de l’unité formelle du poème avec la constance des oppositions dès les premiers vers. Rien n’est avancé sans être suivi d’une proposition contraire, l’exemple type étant, présent à deux reprises, « Je sais et ne sais pas » ; on peut sans peine accumuler les relevés, de « tu es là sans être là » à « Je vous écris entre deux portes ». Écrire dans ce train qui, peut-être, ne roule que le temps de l’écriture, puisque les mots seuls fixent ce qui si rapidement s’évanouit et font revivre ce qui n’est plus — « Hors les mots nulle issue » — Ce n’est pas hasard si Pascal Commère cite La prose du Transsibérien de Cendrars.
Ce n’est pas d’abord la mort d’un proche qu’évoque Sereine Berlottier dans "Deux voix", mais des souvenirs d’un séjour heureux à Rome, d’une relation amoureuse qui importait plus que les ruines antiques et qui abolissait le temps, « c’est ton corps que j’ai cherché, me sauvant nuit&nuit /&jour&encore rien du passé ni de l’avenir ». De la remémoration ensuite du passé, si forte se veut-elle, ne se lèvent que quelques images, réalité évanouie, d’où « la scène, celle-ci (…) / ne te fait pas apparaître ». Souvenirs qui sont parcours d’une vie, des premiers temps d’un amour — après les débuts de l’écriture — jusqu’au présent ; alors, écrit la narratrice, ce qui « me manquait plus que tout / sa parole et sa voix », manque lisible dans le choix des mots quand elle passe immédiatement, par l’ajout d’un -t-, de « plaines », l’espace, à « plaintes », le repliement. Manque encore lisible dans les ruptures syntaxiques comme si l’écriture ne pouvait restituer un ordre perdu. Comment en effet écrire la disparition de l’Autre alors que « les mots fruits ouverts / chauds et vibrants » ne sont plus reçus ? Aucun récit ne reconstruit quoi que ce soit du vécu, il faut attendre, seulement attendre, conclut la narratrice, « le temps qu’il faut aux images pour s’éteindre », et à nouveau tenter de vivre dans le réel.
Ce réel, Thierry Romagné le cherche, dans "Voir en peinture", en écrivant à partir d’un tableau de Leonardo Cremonini (Les loisirs de l’eau, qui devient Les plaisirs de l’eau en titre du poème), d’un triptyque de Marc Desgrandchamps (Sans titre 2004) et d’une photographie de Martin Parr (Grandé Beach, Mar del Plata), les deux titres conservés pour les poèmes. Les trois œuvres ont pour point commun d’être liées, chacune à leur manière, à une re-présentation de la mer, mais quelle réalité est visible sur une toile ? Peut-être n’y a-t-il rien d’autre à voir qu’un « univers flottant (…) entre le visible et l’invisible », où l’on peut par l’écriture, pour un temps, se projeter : le narrateur feint d’ailleurs d’entrer dans un tableau (« nous / qui sommes sur la plage »). Prétexte à écriture, les œuvres donnent aussi la possibilité de défaire une réalité dans un récit qui ne conserve, pour l’essentiel, du tableau de Cremonini que l’eau et multiplie les jeux avec le vocabulaire : emploi du mot « cadre » dans la plupart de ses acceptions, proximité de « remous » et « moue », « ados » » et « adultères », dans un autre récit « rivage » et « mirage », « dissolue » et « dissout ». Il semble impossible de « voir » dans les tableaux et la photographie autre chose que des traces du désordre du monde ; que dire de ces objets « déboîtés hérissés fracassés » sinon qu’ils sont « incompréhensibles comme la vie / ou l’agonie » ?
Il reste encore beaucoup à lire dans cette livraison de Rehauts ; reprenons, dans le désordre : un long ensemble de Jean-Pierre Chambon (Bois de chair),
une traduction du suédois (Erik Bergqvist, Journal du soleil) ) par Marie-Hélène Archambeaud, une autre de l’italien (Julian Zhara, Poèmes) par Laura Giuliberti et David Lespiau, des poèmes de Benoît Meunier (Un pas vers les morts), Christine Bonduelle (Prière de Jonas), Roland Ladrière (Près de la chaux qui s’écaille). Plaisir renouvelé quand on ouvre une revue : la variété des textes proposés permet d’en répartir la lecture.