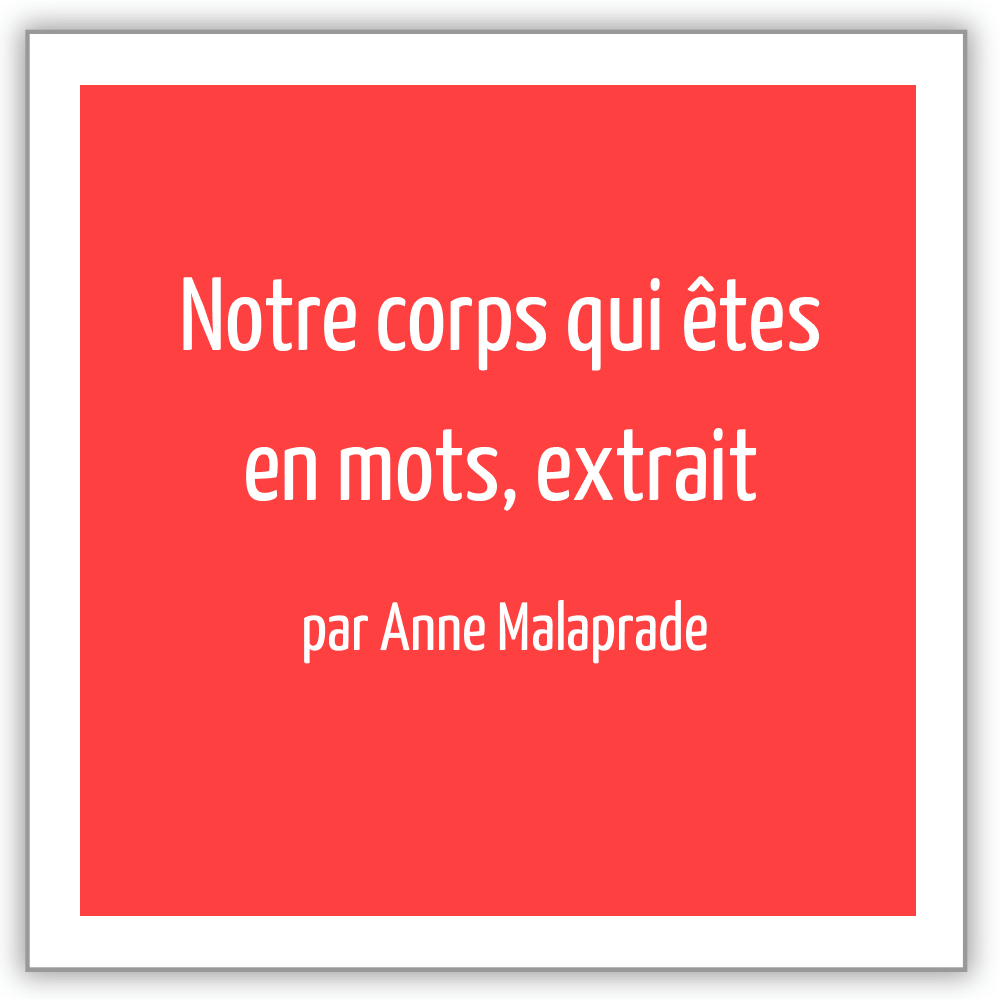Notre corps qui êtes en mots, extrait par Anne Malaprade
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
La journée s’achève par une nuit qui n’en finit pas. On pourrait travailler, continuer à travailler, lire écrire penser raisonner organiser corriger anticiper, mais. Quelque chose ne fonctionne plus malgré l’éveil tenace. Une lune dévisage la cité. Le corps ne peut laisser passer cette journée, les yeux-chats ne brillent plus, dévoyés par la neige ils coupent tous les courants.
On a eu trop faim, depuis la décision sur laquelle aucun retour n’est possible, et on nourrit ses enfants de sa propre faim, on entretient la faim comme un éveil dont la source serait intérieure, on donne, on partage, on ouvre, on transmet, on dévale certes, mais toujours en deçà de ce que la générosité dépenserait. Alors on se punit, on paie, on souffre ce devoir, on écoute des heures, on s’impose et on s’interdit, on grise, on fonce, on tombe, on envoie toujours plus de messages, on cherche et on compte les destinataires, on fixe la boîte sans lettres.
On ouvre les placards, tentations, on craque on croque on dévore on s’en veut on griffe on écoeure la vie déviante. On ouvre les cahiers et les lettres, on jette les enveloppes et les timbres, seuls subsistent les noyaux.
On se couche avec la parole des morts auprès de laquelle on s’allonge. Pourtant on sait que le sommeil ne nous prendra qu’une heure. Ensuite on marche dans le couloir qui n’est pas suffisamment creusé, pas assez sombre, pas assez protégé : un voisin nous guette depuis dix ans, il a vieilli et nous savons qu’il nous regarde vieillir. D’autres voisins déchirent notre patience amoureuse. On dit à l’autre immuable qu’on va mourir, qu’on veut mourir, on lui répète que la mort nous sent, nous précède, qu’elle est déjà couchée, étendue, qu’elle nous attend. Nous l’attendons attendre, nous l’entendons progresser.
On se réveille comme si rien n’avait eu lieu. On a survécu au sommeil. En une heure on a dormi une vie entière. On veut le matin et on ne veut plus le matin. On espérait que les magasins obstinément ouvrent la nuit. On veut la poste la nuit la bibliothèque la nuit les rencontres la nuit on veut les services les médecins on veut l’écriture on la sent elle s’agrippe à nos mains alors on masse nos pieds s’en défaire par la crème la douceur le parfum. On voudrait le thé et le café, le sucre et le salé, l’homme-ci l’homme-ça, on voudrait n’être jamais lue et on voudrait se lire dans l’autre. On se défait, on jette, on se débarrasse. On cherche la légèreté avec chaque enfant. On redécouvre la langue du dix-septième siècle et à chaque fois : terreur, je ne comprends pas, je suis aspirée noyée, je traduis l’échec, stupéfaction, « juste déplaisir ». Je ne peux ni prendre leur repos ni calmer vos douleurs. Avec l’un j’ai crié. Tout de suite je regrette. Avec l’autre c’est non. Tout de suite je regrette. Avec le troisième je caresse un corps, la chaleur des mots fondant obscure. « je mérite la mort de mériter sa haine ».
Je dois un mot à ces deux femmes dans la rue vêtues de noir. Je leur dois ma respiration et ma peur. Je leur offre un café et une image. Elles sont belles et tragiques, mesurées dans leur démesure. Même l’hiver leur peau marque le temps tanné. Elles portent des vêtements sobres, de longs pulls qui recouvrent leur féminité, des chapeaux excessifs constitués de tissus tressés. Aussi nettes, évidentes telle une apparition. Silencieuses, précises, elles glissent dans le quartier, portant des sacs énormes. Une vie dans les chiffons et les livres, les journaux et les images, les bouches dans la main : elles errent dans les plis d’une folie écrasée. L’une est la mère de l’autre qui est l’esclave de la première ; la fille a abandonné la source du vouloir. La déraison de l’une a lié l’autre dans un terrifiant vis-à-vis. Elles font peur aux animaux et aux enfants, elles me fascinent, elles vivent l’impossible supplice en silence : suivre et précéder l’effondrement, l’entourer, le désarticuler, le traduire en gestes immobiles. Elles avancent vers, attendent le peu de soi, le creux des dieux, le retrait des hommes. « on les laisse passer ; tout leur paraît tranquille. » Elles ne boivent pas, elles fument des cigarettes qui consument le vide, elles ne mangent pas, regardent dans la même direction mais ne se regardent jamais, ne nous regardent jamais. Nous sommes transparents dans nos couleurs pourtant elles nous transpercent de leurs yeux-nuages. Je sais qu’elles sentent, je sens qu’elles savent. Personne ne les arrête. Elles ne réclament rien. Elles attendent que le temps, colère et flamme, les signe.