Aberrations chromatiques de Dominique Pagnier par Bertrand Degott
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
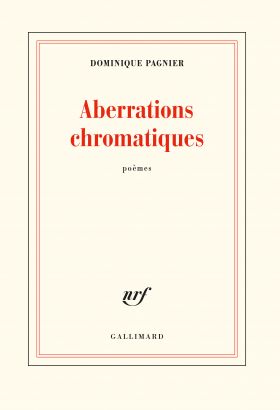
Après Le Cénotaphe de Newton (Gallimard, 2017), immense chronique du xxesiècle, Dominique Pagnier nous donne avec Aberrations chromatiques un nouveau recueil de poésie, où l’on retrouve le mélange de prose et de vers qui déjà composait Le Général Hiver ( Champ Vallon, 2012). Surtout, l’on aime voir revenir, dans la collection blanche, des poèmes en prose de la même eau que ceux qui ont fait ses premiers recueils dans cette même collection, depuis Faubourg des visionnaires (1990) jusqu’aux Amours (1998). C’est la même écriture dense et dansante, tout en volutes, en gloires et en vapeurs, plutôt baroque si l’on accepte la transposition d’art. Elle n’est pas infondée, tant ici la prose de Pagnier, comme le vers pour Hugo, s’impose comme une « forme optique ». L’attention poétique, toutefois, que Hugo dédiait à la pensée, se trouve chez Pagnier consacrée à la sensation et à la vision. Ainsi le recueil s’ouvre-t-il sur le point de vue des animaux (9) pour s’achever sur celui du poète (110). Entretemps auront apparu maints phénomènes et instruments d’optique, phosphène et aurore boréale, prisme, loupe et zootrope, mais aussi et surtout un télescope dont l’oculaire fait voir au ciel des astres qui n’y sont pas. On appelle aberration chromatique l’apparition de défauts colorés dans l’image d’un objet perçu à travers une lentille (c’est un peu la bête noire des photographes !). Dans le texte éponyme (58), le poète se dit sujet à de telles illusions d’optique. Et nous, lecteurs, ne sommes pas toujours sûrs de ne pas voir flou lorsque notre œil s’applique à l’oculaire. Si l’on devine bien la chronique d’une très ancienne famille, d’une espèce de diaspora dont le poète est l’héritier, c’est aussi, par là même, la légende de l’humanité. Également historien et géographe, Pagnier nous promène à travers l’Europe de l’Est, de l’Yonne jusqu’en Sibérie mais aussi, de manière plus imprécise, vers quelque « empire oriental » (11), à travers plus d’un « royaume inventé » (65). Quant à la temporalité, tout en semant çà et là quelques millésimes, il en récolte infatigablement la référence biblique, en vertu des correspondances : un rayon de soleil fait fuir l’ombre « comme à la Création » (60), le manteau d’une jeune fille a l’odeur forte du « soir de la Passion » (63), nombreux sont ceux qui ressuscitent et dont le doigt éprouve les plaies, on côtoie constamment « la fin des Temps ». Mais en cela aussi Pagnier fait partie des poètes, ces experts de la réalité augmentée. Pris dans un tourbillon qui le confronte à un univers éclaté, le lecteur finit par comprendre que même ce monde devrait avoir une unité. Il se rapproche alors de la page, d’un peu trop près, puis il s’en éloigne à nouveau et son regard sur le poème s’en retrouve modifié. Les proses de Pagnier agissent comme des stéréogrammes dont soudain ressort l’image en 3D. Les temps sont révolus, la religion est morte, le monde est englouti mais nous apparaissent avec un relief nouveau les cartes à jouer, les œillets de crépon vendus au profit des mutilés, les timbres de tous pays, la frise tracée sur le cahier du jour, tous ces éclats de vie, toute cette « poussière de la vieille France » (titre d’une subdivision). Les dieux nous ont quittés, les guerres ont ravagé nos territoires, tout porte le souvenir de la captivité et des camps — mais il reste le désir. Le désir de la chair dans ce qu’elle a d’aussi brutal que suave, non moins que le désir de voir cette chair ressusciter. Ce que Pagnier conserve de Follain, ce n’est pas simplement l’intérêt pour les ornements et les sacrements, c’est aussi l’effort pour sauver de l’oubli autant qu’il est possible. On est à peine moins séduit par ses vers, dont on ne sait pas toujours sur quelle musique il convient de les chanter — et cela s’applique même à quelques passages où le décasyllabe dominant se retrouve, sinon malmené, taratantaraïsé. Quant à la prose, on peut s’interroger sur le trait de style propre à Pagnier qu’est l’inversion appuyée du sujet, et même réitérée comme dans cette scène à deux personnages : « Un flocon de neige fond dans les cils de la femme et se transforme en larme. N’en est pas dupe celui qui se tient devant elle dans le couloir où n’ont jamais fini de sécher les manteaux que les aïeux portèrent durant l’exode hivernal en Poméranie. Elle est venue lui rendre ses lettres. » (65). Sans doute par calque de la phrase germanique, le procédé permet, une fois posé le procès, de développer l’agent ad libitum : est-ce que les existences, l’immanence des êtres et des choses, ne valent pas mieux que les projets et les actes ? Ce recueil est l’œuvre d’un contemplatif qui croit à l’âme et à la poésie, tant qu’il se persuade encore de l’« innocence des êtres » (55) et de l’« éternelle bonté de l’homme » (54). Est-il besoin d’ajouter que sa lecture est bénéfique ?