Compost de Michel Valprémy par Jean-Pierre Bobillot
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
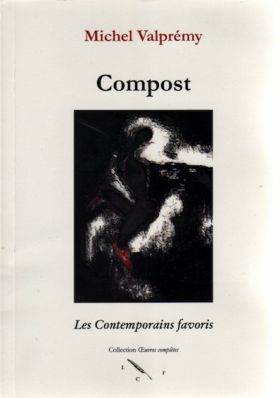
POésie C’EST : la mort qui est dans la vie, et la vie qui est dans la mort aussi…
Second tome des « œuvres complètes » du regretté Michel Valprémy, ce Compost, publié il y a quelques mois par Didier Moulinier aux Contemporains favoris dans la collection « Œuvres complètes » (qui a précédemment accueilli deux volumes de celles de Sylvie Nève), fait suite à Agrafes, publié deux ans plus tôt par Françoise Favretto à l’Atelier de l’agneau dans la collection « Archives » (où il voisine, donc, avec Jacques Izoard et Eugène Savitzkaya) : ce qui suffit à esquisser une histoire, un territoire. Celles-ci (Agrafes) rassemblant maints recueils, certains très-minces, d’autres moins — « livres à venir, pour des lecteurs à venir », notait en préface François Huglo —, semés à la manière d’un louvoyant itinéraire d’errances à la Poucet chez divers « petits éditeurs » ou sous forme de numéros spéciaux de « petites revues » ou de plaquettes en marge de celles-ci ; celui-là (Compost) égrenant maints plus ou moins brefs écrits, mêlés à un grand nombre de dessins, inédits ou qui firent le bonheur de maints numéros des mêmes ou d’autres « petites revues » — mode de divulgation tenant de la diffraction, et qui s’accordait si bien à cette « chatoyante diversité des textures » (Huglo, toujours), caractéristique d’une œuvre infiniment, et explicitement, éclatée.
*
Diffraction… car, c’est bien de lumière qu’il s’agit, tout au long de cette itinerrance, de l’arpentage d’un territoire par le regard que l’on peut, ou non, y porter, comme l’indiquait le titre d’un volume publié, déjà jadis, à l’Atelier de l’agneau : Cadastre du clair/obscur — et comme le souligne, dans l’« interview semi-imaginaire » préfaçant Compost, le même Huglo citant L’Appartement moutarde, paru d’abord aux éditions du Rewidiage, aux bons soins de Dan et Guy Ferdinande : « J’avais ardemment désiré de vivre en pleine lumière » ; phrase sitôt mise en tension avec ces formules, puisées aux nombreuses lettres que l’indéfectible ami lui avait adressées : « Écrire un roman sur la lumière (la pénombre) », et : « la pénombre dont j’ai absolument besoin. Idéalement, la rencontre avec le soleil doit être aveuglante. » (Quelque chose comme : « la mer mêlée / Au soleil. ») À rapprocher de celle-ci, au détour d’une réponse que fit Valprémy à Christian Degoutte, à propos de « [s]on hermétisme » : « Je crois éclairer suffisamment la cible, même si la lumière ricoche, joue à cache-tampon. Et pour l’onirisme, » ajoute-t-il, s’inscrivant sans l’emphase reçue dans l’exigent sillage de Rimbaud, « en effet, “il y avait des visions derrière les rideaux de gaze.” Je n’ai pas fermé les yeux. » Qu’y comprendrait un Izambard, un Demeny ?
Or ce territoire, c’est d’abord (comme pour Rimbaud) un corps : un corps en déshérence, ou en déserrance… — Huglo, le précis et précieux exégète, le rappelait également : « Michel disait “écrire pour (se) reconstituer un corps”. » Gageons qu’il en fut de même de la danse ; et si, telle la guêpe, il fut danseur, sa phrase ne l’est pas moins, voluptueusement, somptueusement, quoi qu’elle dise, quelque trivialité, obscénité ou relent de « sales petits secrets », qu’elle charrie, avec hontes infantiles affleurant ou affluant, il faut bien en passer par là !... et le fût-elle, vertiges et dégoûts en retour, tueusement : « Il n’est point de serpent ni de monstre odieux… » — Si (comme le suggère une analogie qui traversa les siècles, de Malherbe à Valéry) le vers est à la prose ce que la danse est à la marche, sa prose est (ce qui n’étonnera que ceux qui n’ont jamais lu Mallarmé) toute pétrie, façonnée, pénétrée de vers : « effort au style » ; et sa phrase, qui juxtapose plutôt que de subordonner, enfile comme autant de perles (sueur, sang, rire, sperme, insectes, salive, urine) les mots, miettes de fable, soubresauts d’intime, chaos de cahots, petites décharges de soi, étincelles, surprises ou remords, retenus ou déviés, d’évidences et de confidences, fausses pistes, repères où se perdre davantage ou, tout d’un coup, entrevoir quelque éclat — Huglo titre sa préface : « L’Entrevoyant » —, au fur, scrupuleusement mesuré, de ses virevoltes, glissements, aiguillages de la pensée, entre concentration et décentrement, cheminement et vagabondage : c’est le jeu du signifiant comme défi au tragique récurrent.
Fouir… ici même, fouir… plutôt que : « Fuir ! là-bas fuir ! » Car, défi n’étant pas déni, Valprémy à n’en pas douter regarde du côté d’Arthur, plutôt que de Stéphane : l’Arthur des « Poètes de sept ans », de « Mémoire », des « Illuminations » (« Science et patience, / Le supplice est sûr. ») Et, de cette ecfouiture, extraire la quintessence, le jus jouissif issu, dégorgé, sous le pressoir de l’écriture, de l’envahissante boue, des rinçures de la vaisselle des corps, du trop-plein d’immondices, de déliquescences, de putrescences (« compost »), qui encombre la cervelle (mot baudelairien) : quelque chose comme une fouissance est alors, pour l’effusif auteur comme pour son attentif lecteur, le connivent « supplément de plaisir » (qu’il n’est pas interdit de qualifier de « poétique ») résultant de cet « effort », de cet « horrible travail »… Car s’il recourt au mythe, au rêve, à l’imaginaire, volontiers débridé, ce n’est aucunement pour mythifier (son propre cas), ou pour mystifier (son pauvre lecteur) ; c’est que ces trois dimensions, dont se compose le symbolique, sont précisément, quoiqu’obscurément, ce dont se constitue ce qu’il y a, pour tout sujet, de plus réel, ou ce qui peut y donner accès : bien loin, donc, de s’y opposer, voire de le disqualifier. C’est à peu près, en d’autres termes, ce dont il est question dans ce fragment de son journal, année 1991, que l’on trouvera dans le n°6 de L’Intranquille, la revue de l’Atelier de l’agneau, qui paraît opportunément ces jours-ci :
2 Avril. Bordeaux.
Dans une lettre à François Huglo : « Je me raconte en sachant que je mens, que je mens forcément. Je ne suis pas celui que je raconte, celui que j’ai failli être, que j’aurais dû ou voulu être. Je sais que je mens et je montre celui que je raconte, je joue, je joue si bien que je deviens vrai, moi et l’autre, non pas confondus, mais double. »
« Serpents, monstres odieux… » : Racine et Boileau, aussi bien que Sophocle et Aristote, n’ignoraient pas qu’un art, une poésie, un théâtre, se voulant cathartique, se devait d’en passer par là… mais ne réussirait qu’à l’expressément esthétique condition de les rendre, fût-ce un instant, non point inoffensifs, mais désirables. Il y a de cela chez Valprémy : et ce serait, si l’on veut, sa part de « classicisme » ; mais il n’ignore pas, pour autant, cette pénétrante « notion indubitable » qu’avança Mallarmé : « que, dans une société sans stabilité, sans unité, il ne peut se créer d’art stable, d’art définitif. De cette organisation sociale inachevée, qui explique en même temps l’inquiétude des esprits, naît l’inexpliqué besoin d’individualité dont les manifestations littéraires présentes [et ce présent, de toute évidence, est aussi bien le nôtre] sont le reflet direct. » Dès lors que les poètes ont délaissé le « lutrin » et « les grandes orgues du mètre officiel », au profit de la « flûte » sur laquelle chacun va, « dans son coin, jouer […] les airs qu’il lui plaît », il n’y a plus de règles pour cela, de recettes éprouvées, d’« arts poétiques », comme le scellent les formules jumelles de Francis Ponge : « une rhétorique par objet » (côté « choses »), « une rhétorique par poème » (côté « expression »). Plus encore, ici : une rhétorique par phrase, par mot même (côté expression), c’est-à-dire : par détail (côté choses) : « Ce qui m’importe vraiment : les détails », confie-t-il — à son journal, puis à François —, c’est-à-dire : « je retiens les brindilles du paysage [côté choses], les brindilles du discours [côté expression] » ; d’où : « Il faudrait écrire chaque paragraphe comme si lui seul devait rester. »
S’il fallait trouver, à la poétique valprémienne, une généalogie, nul doute qu’y figurerait, certes, en bonne place, l’Arthur de « sept ans » « surpris à des pitiés immondes », qui « voyait des points » à force d’« écras[er] son œil darne », et « écoutait grouiller les galeux espaliers. » Mais il y aurait, non moins, ce « style de décadence » où, suivant Paul Bourget, « l’unité du livre se décompose pour laisser la place à l’indépendance de la page, où la page se décompose pour laisser la place à l’indépendance du mot »… et ainsi de suite, serions-nous aujourd’hui tentés d’ajouter, ad lib., bref : un style d’indéfinie dissociation, sous l’imprescriptible pression des « détails », si « révélateurs » (comme autant de lapsus…) ; et ce « symbolisme », tendance cérébraliste, qu’illustra Remy de Gourmont, l’auteur de Sixtine et de « La dissociation des idées » (grand pourfendeur, soit dit en passant, de l’étiquette « décadente »), qui le définissait « comme le libre et personnel développement de l’individu dans la série esthétique. » Corollaire : « les symboles qu’il imaginera ou qu’il expliquera seront imaginés ou expliqués selon la conception spéciale du monde morphologiquement possible à chaque cerveau symbolisateur. » Ce qui légitime l’hermétisme : « On est toujours compliqué pour soi-même, on est toujours obscur pour soi-même […] ; l’Art personnel — et c’est le seul Art — est toujours incompréhensible. » (Ailleurs : « Il y a trop peu d’écrivains obscurs en français » ; et, plus abruptement encore, Artaud : « Tout vrai langage / est incompréhensible »…) Cependant, nuance-t-il, « si personnel que soit l’Art symboliste, il doit, par un coin, toucher au non-personnel » : ce qui peut s’entendre, en termes quasi baudelairiens : « chercher l’éternel dans la diversité momentanée des formes ».
L’un des attraits, point négligeable, du présent volume, est le grand nombre de dessins qui s’y trouvent rassemblés. Y apparaissent immédiatement une divergence et, bientôt, une profonde convergence (voire une complicité) entre deux « manières » ou « postulations », au gré desquelles s’effectue, à hue et à la diable, la double « poussée lyrique » à l’œuvre, tour à tour et simultanément, dans les textes, quelquefois au fil sinueux et ténu, mais têtu, d’une même phrase, et qui en font le précieux (sans les chantournements et les évitements de la préciosité) : — d’un côté, précision, netteté (sans bavure), littéralité, sècheresse, dans la mise à nu, la coupe, à vif, « noir sur blanc » ; — de l’autre, indécision, tremblé (à peine) du geste et de la vision dans le dégradé chatoyant, les mouillures, le flou, le fondu, le « clair/obscur » ; mais des sarabandes de « Bittus » — qui sont aussi, visiblement, les signes dansants d’une écriture anguleuse et fourchue, fourmis ou pattes de mouches, insextes surgissant tout crachés, tout criés, de l’encrier (du même, ça crève les yeux, que la singulière calligraphie des manuscrits) — aux suites de fantomatiques apparitions/disparitions, dans les dégradés de noirs et de gris du délavé de la page, de formes plus ou moins menaçantes, grimaçantes — se contaminant d’informe (à la Bacon) —, se parcourt tout un spectre (!) où se rencontre parfois, esseulée, telle silhouette de bittu délavé, délité, déchu — quasi méconnaissable…
Et il m’arrive de songer à Odilon Redon, à ses noirs s’irisant en diaprures sensitives, à ses petites monstruosités, si chatoyantes, si odieusement désirables : « souriantes » même, telle son « araignée »…
*
Toujours extraites de son journal, année 1991, ces quelques lignes, je m’en aperçois, résument on ne peut plus nettement, et au-delà, en ses propres termes, mon propos, et auraient sans doute pu, avantageusement, s’y substituer :
19 Juin. Bordeaux.
De mes lectures sur la préhistoire, je tire un grand profit. Ces millénaires, ces millions d’années où l’anonymat règne devraient tous nous rendre humbles […]. Nos vies d’artistes européens font l’impasse sur le squelette ; on en cause, on ne veut pas le voir. Grande vitalité. Énergie à revendre. J’ai envie de dire merci. Je tourne la tête vers le ciel, vers les nuages. Parfois je pense au Dieu de mes vingt ans. Non, ça ne peut plus marcher ; il n’y a plus d’écho, je n’en veux pas. Les plus belles ferveurs sont humaines, comme le sont les pires saloperies. Si Dieu était (celui qui descend dans nos églises), malgré ses dons innés, il eût manqué de force compassionnelle. Mais, jusqu’à ce que tout s’éteigne, je veux bien devenir un grain de poussière dansant dans un rayon oblique.