L'odeur d'un père de Catherine Weinzaepflen par Carole Darricarrère
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
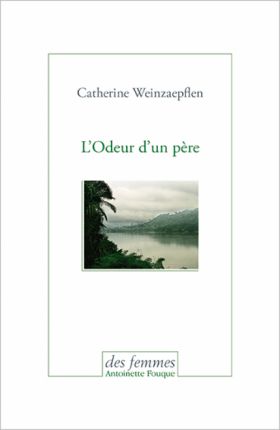
Les mots sont simples, concrets, comme à portée de main les uns des autres, fraternels et égaux en valeur, sans fronces ni fioritures, ils sont tournés vers le passé comme dans un journal en espaliers, ils ont chacun en dernier recours une opinion et brûlent leurs cartouches à petit feu.
Il est question de trouver sa place : la réponse est peut-être dans le livre, d’un suspens de page l’autre, en attente dans le pli d’un mot, ou bien oubliée, essaimée aux quatre coins du vent. La question fait le tour de la vie et des morts, petites ou grandes, virtuelles ou effectives, la réponse échappe et rebondit toujours ailleurs.
Immédiatement l’Afrique, le parfum des caféiers en fleur, « mon » Afrique dit-elle, celle des années 50, de Tintin au Congo et de Karen Blixen, immortalisée par l’Histoire et la Littérature, fait poème dans le texte telle une réalité extra(-)ordinaire et portrait dans le portrait cette Françafrique exotique grandeur nature qui fait figure dans l’imaginaire contemporain de fantasme impur et se confond avec la mappemonde olfactive du père, ce continent magique et mâle, globe en soi, terre virile étrangère : son odeur virale de vie vraie.
On comprend que l‘Afrique est un personnage principal et un déterminant, qu’elle aimante et forge les caractères, que lorsque l’enfant de parents divorcés débarque à l’âge de onze ans à Bangui chez son père - mon père ce héros - elle va en être tatouée à vie et que sans elle – l’Afrique – ni le père, ni sa fille, ni le livre n’auraient été ce qu’ils sont : des passagers de l’Afrique éternelle, des citoyens du monde, des migrants dans l’âme de l’Ailleurs déraciné - immédiatement « l’Afrique souligne la morbidité européenne » -.
Dans cet emboîtement de portraits déboîtés, celui d’un homme et celui de sa fille, le portrait de l’un et l’autoportrait de l’autre, celui de la construction d’une femme en miroir du fantôme intermittent de son père, de son milieu, d’un environnement, chaque être est une réponse, chaque forme est une adaptation, le milieu détermine l’être à la faveur des accidents de la vie et des rencontres.
L’Afrique remonte alors dans le cœur du plancher des veines, par la plante des pieds repousse ses lianes jusque dans le livre qui fait patchwork autour d’elle et n’aurait jamais, jamais ne se serait ressemblé, sans elle. L’enfant grandit et se répète autour de ses impressions, d’une somme de manques et de fausses notes, des nœuds dans son cahier de « résistance » et de la jungle en laisse des animaux qui croisent le grain autobiographique de son destin.
Du fruit éclaté en père persiste longtemps la signature olfactive de la terre mère adoptive, une composition mémorielle s’augmente de l’implant des âges de la vie et des époques, des retours sur s’interposent, discutent, saignent, nuancent, jugent, déplacent, redessinent, mettent à distance - Alice grandissait et rapetissait au fil de ses expériences et de ses perceptions selon des prismes différents -.
Le père meurt et ressuscite en fragments coupable à chaque page de son odeur fixée à jamais dans le médaillon d’un O majuscule - médaillon de la mémoire qui hérite et de la pensée qui théorise, découpe, décide, trie, jette, hésite et classe -.
Sa fille grandit divisée entre ce qu’elle attend de lui et ce qu’elle en reçoit, l’ici et l’ailleurs, le pensable et l’impartageable, l’amour dû au père et son rejet, la Françafrique joyeuse et le pays (l’aller et le retour), ce pays la France qui fera figure à maints égards d’escale étrangère tout retour contraint signant un échec potentiellement annoncé ; divisée entre le père et la mère, les tranches de vie du père ses femmes et ses maisons. Se construire, s’assimiler, s’identifier, être reçu est un exercice d’équilibre et un dépaysement ; Blanc des colonies, Pied-Noir, Pied-Rouge, Pied-Jaune, robinson bleu des mers du sud, expat’, mi-étranger en son propre pays est un drame qui laisse des cicatrices sur plusieurs générations.
La France est sans odeur, « une route bordée de platanes » en lieu et place du « matitis » qui séparait la concession du fleuve, ‘sans odeur’ ne laisse pas de souvenir : seul le néant est sans odeur. L’écriture du livre est faite de moments non linéaires - « Quand j’ai onze ans », « Quand j’ai trois ans », « Quand j’ai soixante ans » -, d’épisodes plus ou moins lyriques selon qu’ils évoquent le drapeau français ou la cotonnade africaine, le départ ou le retour, chaque âge a son point de vue et chaque pays son vocabulaire, chaque femme est différente : la mère dans son retrait, la compagne du père dans sa jalousie, l’auteure, les femmes du marché à Bangui. On se surprend à regretter que la seconde femme du père n’ait pas été une femme africaine. Mais alors l’auteure et le livre auraient connu un sort et des développements différents.
Le livre est un livre de temps forts et de moments passés seuls ensemble ponctués de détails qui n’existeront plus que sous la forme de souvenirs fondant eux-mêmes une mémoire entrant elle-même dans l’Histoire comme substrat.
Une politique du cliché et de la honte prend par endroits le relai, prête le flanc au débat qu’alimente l’idée que l’on se fait de l’Afrique coloniale, de ce que l’on en a compris et de ce que l’on en retient, une odeur mitée de nostalgie frottée de relents, le vin vieux d’un volcan jamais éteint.
Le livre est labouré d’élans de colère et de tendresse mêlés, de frustrations et de regrets, de points de rupture et de réaction : toutes flammes vacillantes leurs ombres continuent à lécher les parois de la caverne. Ce que l’on comprend : le premier homme dans la vie d’une femme est le père, ce premier amour est ici un amour contrarié. Jusqu’à cette blessure, ce « black out » dont nous ne revenons jamais : toi qui « m’as jetée dans la langue » ne m’as pas lue. Cahotant dans ce déni, ce dilemme, le journal aurait pu finir sur le Divan et ne jamais constituer un objet public. C’est peut-être cela une relation père & fille, « tant d’incompréhension », ce qu’il en reste, l’Odeur grand O d’un parfum petit p.
L’enfance n’a pas de fin, l’écriture prend racine dans un empêchement, les années se rattrapent au vol et retombe épinglé à vie au fond de la boîte à mémoire le penchant multicolore des filets à papillons sous l’aplat de la main écrivaine de la taxidermiste, avec émotion, émotion, qui discrètement s’en délivre dans le livre où elle se recharge et se décharge.
On comprend que Catherine Weinzaepflen a eu le privilège d’avoir un bout d’enfance africaine, un autre regard, une vie d’avant, tout un petit monde différent précieusement englouti telle une malle aux trésors dans les années naufrages d’un monde dur replié sur une idéologie du bien et du bon qu’il plaque sans nuance sur le vivant.