Revue Critique, n° 860-861 par Pierre Vinclair
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
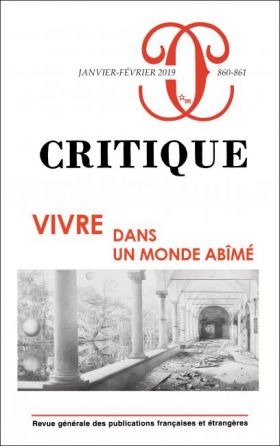
« Vivre dans un monde abîmé ».
En 2012, dans un numéro de Critique intitulé « Penser la Catastrophe », Marielle Macé présentait l’écopoétique de Michel Deguy. Sept ans plus tard, après que le concept de catastrophe a connu une telle fortune épistémologique et médiatique qu’il en est devenu suspect, elle dirige un nouveau numéro de la même revue : « Vivre dans un monde abîmé ». Plutôt qu’une catastrophe, unique et totale, face à laquelle on ne pourrait que baisser les bras, ce volume invite à penser la crise écologique dans la multitude de ses affections concrètes sur les vivants. La conséquence première de ce changement de perspective est le rôle de premier plan conféré à la création littéraire : vivre dans un monde abîmé implique l’invention de nouvelles poétiques.
Les contributions sont remarquables : écrites dans une langue imagée mais précise, les vues développées, originales mais étayées, sont à la pointe des préoccupations épistémologiques et critiques (notamment outre-atlantique). L’ensemble est bien composé, les articles, complémentaires, s’éclairant les uns les autres. Le volume n’est pas seulement un inventaire des désastres écologiques en cours ; le concept de « vivre » y est travaillé en profondeur : dans un monde abîmé, « que signifie ‘vivre avec’ ? » (se demande Sophie Houdart à Fukushima). Vivre, c’est « lutter » (Nathalie Kloos), mais aussi « composer la vie malade » (Enno Devillers-Peña) et même « savoir mourir » (Cyprien Tasset). C’est ressentir la disparition des êtres (Marielle Macé médite sur le silence des oiseaux), être traversé par de nouveaux affects (la « sostalgie » de Baptiste Morizot, c’est-à-dire le mal d’un pays transformé par la crise climatique), et développer des stratégies ou des « arts de vie » (p. 3) pour habiter le monde amoché, et en sauver ce que l’on peut encore en sauver. Dans une démarche bien éloignée du fétichisme littéraire, qui considère que certains textes, écrits par de « grands écrivains », auraient « une valeur » en soi, plusieurs auteurs de ce numéro confèrent à l’écriture, présente ou à venir, et qu’elle soit narrative, poétique ou scientifique (ces cloisonnements génériques n’ayant plus beaucoup de sens dans un paradigme pragmatique dont les figures tutélaires semblent ici Gilles Deleuze et Bruno Latour), un rôle double : sémiotique (rendre compte des signes que nous envoient les vivants) et politique (transformer les imaginaires). Deux rôles qui relèvent finalement de l’éthique (se comporter correctement avec les vivants).
Comme Gilles Clément invitant à « ne pas nommer trop hâtivement ce qui a lieu » (p. 57), Frédérique Aït-Touati, lisant Anna Tsing, plaide pour « l’élargissement du récit à l’ensemble des êtres du monde », la narration étant une « puissante façon de travailler la superposition, en ce qu’elle maintient des êtres qui sont pliés les uns dans les autres » (p. 7). Il s’agirait de « se rendre attentif au fait que les vivants sont riches de significations autochtones. » (p. 11) Marielle Macé acte que le silence des oiseaux est le « non-chant » de notre monde abîmé et souligne « la justesse de cette écoute en syntaxe du signifiant dans la nature » (p. 29) qu’est la poésie. La littérature apparaît ainsi singulièrement plus à même de rendre dans son épaisseur la signification des expériences que la langue formalisée, asséchée, de la mesure : « J'avais vu des gens mesurer tant et plus, écrit Sophie Houdart à Fukushima, mais j’entrevoyais là pour la première fois le champ d’expériences ouvert pour comprendre comment les radionucléides se ‘comportaient’, comment ils ’s’exprimaient' (detekuru). La prééminence d’un vocabulaire et de postures indiquaient que ces expériences relevaient davantage de l’observation que de la métrique […]. » (p. 82). Au fond, ce numéro de Critique plaide pour un nouveau pacte humaniste : la constitution, dans et par l’écriture, d’une manière adéquate de comprendre et d’habiter le monde. Mais « la réflexion humaniste, demande Cyprien Tasset, conçue comme entretien d’une culture d’abord textuelle ouvrant à une méditation sur la condition de mortel, offre-t-elle des ressources suffisantes pour une appropriation collective rapide de la situation écologique actuelle ? » (p. 108) L’article se conclut sur la nécessité d’une nouvelle poétique de l’enquête.
Or, comme le rappelle Baptiste Morizot, l’exploration doit aussi avoir une dimension diplomatique dans la mesure où elle implique d'interagir avec les vivants. Emanuele Coccia suggère, lui aussi à la suite de Bruno Latour, qu’il ne faut pas concevoir un milieu comme quelque chose de donné, auquel les vivants devraient s’adapter, mais comme un « compromis sur les besoins réciproques que plusieurs vivants et non-vivants ont signé pour rendre possible leur forme de vie en commun. » (p. 42) Dès lors, le monde n’est pas seulement un environnement déjà-là, à décrire par un sujet qui y serait simplement jeté : il doit être l'enjeu d’une élaboration (notamment poétique, narrative, imaginaire) collective, prenant en compte les besoins de tous : « Les mondes, tels que vécus, tels qu’ils sont, tels qu’ils deviennent, sont sous l’influence des manières dont nous les mettons en mots », rappelle Enno Devillers-Peña (p. 121). C’est pourquoi, au rôle éthico-sémiotique de l’écriture (rendre compte avec justesse et probité du nouvel état du monde) s’ajoute sa dimension politique : « la poésie n’est pas un luxe » (Audre Lorde, citée par Nathalie Kloos p. 97) pour lutter contre la colonisation de nos imaginaires, « elle permet de nommer des ‘idées sur le point de naître, mais déjà ressenties’ » (Ibid.) Pour les militantes écoféministes, la poésie doit ainsi nous permettre de « refonder le sacré, y compris dans ses dimensions ritualisées et organisées. » (p. 98) Encore une fois, on parle ici moins d’un genre particulier, que de la nécessité d’une refonte générale de l’imaginaire, notamment par l’écriture, jusque dans les sciences. Comme le rappelle Romain Noël dans sa critique du terme totalisant, écrasant et démoralisant d’« anthropocène », « c’est peut-être avant tout une guerre des représentations qui se joue ici, les mythes, les discours et les récits sont en première ligne. » (p. 139-140, il souligne).
La prolifération discursive sert parfois à conjurer l’impuissance : ainsi, moins les lois sont efficaces, plus les parlementaires en promulguent. Il en va parfois de même avec la crise climatique, quand le volontarisme théorique individuel trahit l’angoisse de vivre une situation que ne sauraient résoudre que des actions d’échelle planétaire. Ce numéro de Critique n’est pas une collection d’articles, c’est un véritable ouvrage collectif. Cette dimension a d’autant plus d’intérêt ici qu’il dénonce, au fond, le face à face dramatique mais stérile entre l’imprenable Totalité (le Monde, la Catastrophe, l’Anthropocène) et la logorrhée individuelle, pour mettre en évidence des médiations intermédiaires : les liens (et les conflits) entre les individus de différentes espèces ou d’une même espèce, les pays, les lieux, les représentations, les cultures, les mythes. Toutes choses qui sont irriguées, voire constituées par un imaginaire que des nouveaux récits, chants ou enquêtes peuvent contribuer à faire bouger. Non pas l’œuvre individuelle de l’écrivain héroïque faisant face au mur des siècles, non plus que le répertoire des livres légitimes classés par siècles et par genres, mais la lente constitution collective du sens, ce sang qui pulse aux veines des sociétés, et que continue de produire comme son cœur en fusion, pour les animaux humains qui ne s’en rendent pas toujours compte (même et surtout dans un monde abîmé), la pensée dans sa dimension créative, la poésie.