Le Pli des leurres de Luminitza C. Tigirlas par Carole Darricarrère
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
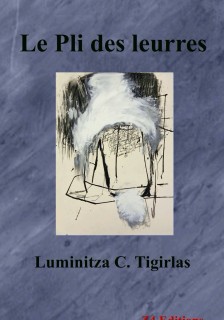
« Dans le Pli de la servitude accélérée, pénitencier pour les désaliénés qui risquent de chiffonner l’univers lisse, Odette est consignée aux Ateliers d’écriture pulsionnelle. Leur animateur est un certain Jacques Cauda, une surfigure de la peinture éros/sienne qu’on a déporté pour lui donner la chance de se qualifier dans un autre langage, plus décent que la décence. // Devenue l’ombre écrivante de ce Cauda-le-désinhibé, Odette n’a pas tardé à créer son propre personnage nommé Oète, qu’elle met en lien étroit avec son mentor. Par pudeur, elle le place sur une scène d’amateurs et le baptise Jacques Derlac en lui donnant le rôle de tripleur-poète (…) ».
Monologue volume rétrospectif incubateur du corps de souffrance surreprésenté d’une personnalité diffractée en guerre contre elle-même et son corps de filiation, blocs d’écriture psychotique greffés les uns aux autres comme arrachés aux pages du journal intime d’un assemblage de figures, « Le Pli des leurres » est une composition dramatique dont la violence morale théâtralisée force l’exclamation du côté du dérèglement : à lire nos petites vies feutrées à la lueur de nos seules lampes on en oublierait presque que le monde marche essentiellement sur la tête, paradoxal, incompréhensible, viral, dont l’insidieuse létalité a la capacité d’affecter à notre insu via le livre, dans cette propension poreuse à l’abandon qu’intime la lecture, notre potentiel vital jusqu’au tréfonds de nos délicates cellules.
On en oublierait nos enfances tordues, nos poussées d’acné, nos carnets de bord compulsifs, nos chapelets de fiel, nos fêlures adulescentes, nos démons suicidaires, nos pulsions de meurtre, nos nuits noires, vomissures inversées, renversées, déversées, si l’écriture, dont on oublie trop souvent sous couvert d’art poétique de louer les puissantes vertus thérapeutiques, ne nous repêchait au bord pour ainsi dire exorcisés.
Est-il pour autant nécessaire d’exposer mes dedans au grand dehors, de faire étalage de mes paroxysmes, de sacrifier aussi le lecteur ; moi lecteur, dois-je applaudir, tendre la main à Oète ou lui enfoncer la tête ; quelle valeur littéraire accorder à nos crises existentielles, nos familles de linge sale, nos séances de thérapie de groupe, nos cures de désintoxication, notre profil médico-mental, nos tares et nos échecs ; « Œuvrer ! À partir de quel moment ? » ; est-il utile de se masturber les méninges en public dès lors que la souffrance reste au chevet du mal et ne parvient à se sublimer ni en poésie, ni en pardon, ni en résilience en dépit d’inspirations carnassières poussant encore la rémission du côté du carnage ; « Quelle est ma voie, l’épreuve ? Que dois-je traverser pendant cette vie-là, où est l’espace de création ? » : du bon placement de la limite.
Histoire d’Oète en psyésie donc (« j’enferme le « p » majuscule dans le tiroir à lettres déchues. Poète sans « p », j’abuse la folie »), éloge du sale hérité des ‘nasty nineties’ (« trou-trou-trou/pensées à détritus : mensonges de scies »), orgasme clinique d’une écriture du désastre à partir duquel broder contractions de muqueuses fils de conversations et courts circuits psychanalytiques, hymen à fleur de lèvres du rejet de son propre corps et stimulations littérales ( « Le poison à retardement du Psy-docteur, tiens-tiens, une gouttelette se distille de ma plume, ‘Jacques Derlac lèche ma feuille ! Mon sexe est un mâché de papier encollé’. »), zig zag d’aveux et de fourberies, scènes capitales oniriques, vices et vertus des tiroirs à triple fond, leurs corniches relationnelles, leurs impasses gynécologiques, tête-à-queue poétique de nos culs-de-sac intimes, « Mon grain de folie est seul dans ma tête. Pas drôle de me prendre pour un pavot-œillette, grains à huile, ni pour une cultivatrice mericole. - Pauvre olivette, à tout prête - ».
D’avant prologues pittoresques ( « -o -u -trou/ comptine de fou/ tu vas où/ je reviens de nous/ eux deux - trous/ vou-vou-vous rentrés dans les clous (…) ») en prologues à déclinaisons névrotiques, « trios de versions offertes à Jacques Derlac » et berceuses jacquadiennes mutines, c’est donc un petit livre bien déjanté prompt à hameçonner le lecteur qui inaugure la collection Bleu-Turquin dirigée par Jacques Cauda aux éditions Z4, un texte freudien radical qui ne ressemble à rien de connu dédié expressément à Sarah Kane, « oral, vertical, anal, horizontal, mental ! », compte à rebours thérapeutique d’une régression, dépistage analytique d’une traversée sur le mode d’un « dire à mort » : de la chatte originelle aux chutes pseudo quantiques d’un mysticisme post-religieux (« Le corps que j’incarne dans cette vie est ailleurs un corps spirituel en parallèle (…) »), de la marque incestueuse par félin interposé aux jeux interdits, du sceau érogène de la morbidité aux frustrations libidinales, du coda MOINS ZÉRO de l’ablation des capitales à leur jacquerie intempestive, il serait question ici, sur l’autel du carcan mental et sous toutes réserves, à rebours de soi comme plaie native et aventure primordiale, d’un cas d’école.
Dans ce huis-clos au forceps de la lecture comme parturiente, au point d’intersection fuyant de l’art et de la pathologie, résister s’impose jusqu’à ce qu’un eurêka s’ensuive. L’écriture qui éconduit n’a pas d’épicentre. Son cœur suicidaire s’articule a contrario de lui-même. Son pouls saute à l’aune des fonctions corruptrices d’un menu déroulant, déroute l’entendement, réduit l’éclairage à un rail anatomique de lumière infrarouge sur une rose noire, une note de consultation, un étrier clinique sans moellon de confort, une expérience sensitive aux limites du sens prend le moi en otage et condamne le messie à une mort psychique. Rien n’est sûr dans la psyché humaine, faire œuvre au « bleu fond » signe ici un combat sans issue.
D’où surgit, entre fascination et répulsion, fulguration psychique et provocation, d’un compost hyperbolique de voix, un mille-pattes complexe de mues sur sables mouvants comme autant de surfigures, une surenchère de scènes fondamentales leur contenu d’injonctions mêlant Père, Fils, Mission, Ego, la mère la mère « Viol ! Mère croît sur le tronc d’Oète. Viol ! Viol ! », les poisons autophages de l’enfermement. Dans ce labyrinthe zarbi une fiction s’enfante tandis qu’à coups de talons s’envase le lecteur pris aux rets de sa propre psyché comme en un mauvais songe rêve d’un hallali, et rond et rond et rond dans le décor repart, le petit vélo rouge qui broie du noir, à coups cycliques de projecteur. À l’évidence la métamorphose résiste à la machine introspective comme à l’obsession siamoise mot à mot, bout à bout, par bouquets abortifs de bourreaux et de victimes aux confins de la recherche, d’un train de traumas.
Des voix des voix, opèrent encore à corps et à cris comme autant de représentations du moi, projections tantôt actives tantôt larvaires, une guerre intestine à tour de rôles en galère de genre, mais une guerre, sous nos yeux hallucinés fait rage, celle qu’une identité multipolaire en mutation à têtes interchangeables se fait à elle-même : l’hydre nombriliste du « qui est-ce moi », moi-Eleanor, moi-Lenny, moi-Elle-même, Odette-Oète version Jacques Derlac revisitant Sarah Kane avec la complicité « rouge-sang » online de Jacques Cauda.
Des voix, des chatières de désinhibition à l’intersection de tous les conflits internes, le lit des leurres à poil sur le devin divan : j’offre à l’Oète de Luminitza C. Tiriglas un bouquet de «trandafiri» anciennes au bon marc de porcelaine, façon naturelle d’opérer le malin sous perfusion de pétales avant que ‘l’horrigami' des incarnations ne creuse à jamais les cicatrices les perpétuant jusqu’à la dernière génération : des pleurs, des siens, des leurs, des peurs.
On aime (beaucoup) la coiffe de couverture si suggestive de l’artiste plasticienne moldave Doïna Vieru dont les encres, les fusains et les vives estompes lenticulaires font tant écho aux chambres mentales des herbes folles d’Oète alias Sarah Kane.
On se quitte en prescrivant un grand bol d’air.