SI DÉCOUSU de Ludovic Degroote par Tristan Hordé
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
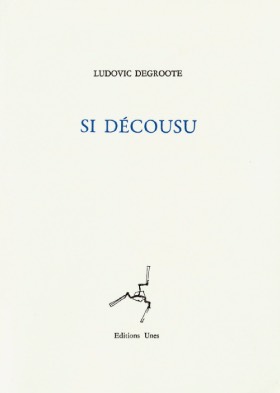
Une partie des poèmes, comme le précise une note avant la table des matières, a été publiée en revues, sous forme de plaquettes ou de livres d’artistes, entre 1989 et 2015, et une quinzaine de poèmes inédits ont été écrits entre 1994 et 2006 : tout laisse penser que ces décalages dans le temps donnent leur sens au titre, que le livre est une réunion d’éléments hétérogènes. La lecture s’oppose à cette première impression, d’un bout à l’autre les mêmes motifs sont présents — notamment, insistant, le thème de la difficulté de lire un ordre dans les éléments du monde et d’y avoir une place :
«dès que je m’en vais je suis dans la pente / je regarde la mer et je suis dans la pente ; je n’ai plus besoin de montagne / ni de marécage / tout cela paraît si décousu alors que la vie ne sort pas de sa ligne : on ne se défait pas de ce qu’on est / par delà les piles des ponts / nous somme finis (p. 118-119)»
Quant à l’unité formelle des poèmes, elle est aisément visible. On note des textes anciens jusqu’aux plus récents une permanence dans l’emploi de la paronomase, souvent en accord avec le propos de l’ensemble du livre, « vie tenue ténue », « sans vides sans rides », « impuissances impatiens », "tenue - venue", "gravir - gravats", "poupée - coupée". L’unité est en relation avec le désordre du monde et du Sujet ; le plus souvent, les vers sont séparés par des blancs, sans aucune ponctuation ni majuscule (y compris pour les noms propres), ce qui ralentit la lecture, et cette absence de lien mime la distance entre les choses, entre les choses et le Sujet. Un texte en prose restitue cette distance en introduisant régulièrement des barres dans le texte — voir la citation ci-dessus —, parti-pris de morcellement exposé jusque dans le titre du texte :
«TEMPS // MORT // BLOC
DÉFAIT
DE // SON // TEMPS»
Une autre prose, heureusement titrée "Compost", accumule des noms de fleurs, d’arbustes, d’arbres, longue énumération en une seule phrase et aucun des éléments nommés ne se détache des autres : tous ne sont que des « mots défaits dans leur lente transformation vide ». L’accumulation n’aboutit donc pas à un enrichissement (comme le compost agricole à un engrais), mais plutôt à montrer une opération inutile, un manque, et ce manque est partout présent. Ainsi, la mer en tant que telle apaise, mais ce qui la désigne et le nom des choses qui lui sont attachées, n’ont pas de réalité, « mer digue barque / dans ces mots le vent / des images vaines ».
Plus largement le monde, ce dans quoi chacun vit, est toujours qualifié négativement, milieu par nature du manque ; il semble impossible d’y trouver le moindre appui, quelle que soit la tentative pour aller vers l’Autre, ce que suggère le remplacement de "tendue" par "pendue" : « on s’accroche / à tout ce qui dépasse // un signe de vie // un regard // une main pendue ». Tout se passe comme si tout échange, toute présence étaient refusés. Le monde se caractériserait d’abord par l’existence devant soi d’un mur — « un mur partout » ; on pense à Antoine Emaz qui écrivait, dans "Poème du mur", « un mur indéfiniment » et, aussitôt, « un jour / on ira / plus loin » ; Ludovic Degroote prend-il le même parti ? « on est là / parce qu’on reste là ». Peut-on (se) changer ? comment vivre « la brutalité », « l’horreur du monde » ? Pour le dire autrement « qu’est-ce qu’on peut bien faire de soi » est peut-être la question en arrière-plan du livre.
Rien ne peut modifier ce fait que « nous allons seuls / dans notre solitude », mais c’est cependant quand on se met à l’écart, dans la « nuit claire » — image du temps à côté du temps du monde —, que l’on réussit à « ne pas avoir à jouer ce qu’on est ». Encore faut-il pouvoir penser ce que l’on est, quand le Sujet lui-même apparaît "si décousu". La construction de soi exige du temps pour « réduire la distance / qui vous mène à vous-même » et ce temps est aussi celui qui « nous défait ». Le passé demeure accessible mais les souvenirs sont tellement coupés du présent qu’ils semblent renvoyer à quelqu’un d’autre que celui qui les évoque ; quelle relation entre celui qui se souvient des « gaies tombes fleuries », des « riants caveaux » de son « enfance moisie », et celui qui écrit « je suis coupé de moi », « on vit séparé » ? Tout l’enjeu est bien de coudre, reformer un tissu, une continuité dans ce qui, la vie, n’est que discontinuité, fragments successifs. Restent ce qui ne peut se dénouer, des ombres qui demeureront quoi qu’on fasse, ce qui s’exprime de manière sibylline : [nés, nous sommes] « précédés de notre disparition » ? — disparition, un des mots récurrents.
La fragilité liée au fait de vivre ne signifie pas abandon au chaos, si l’on sait qu’il y a « manque » on sait aussi qu’il s’inscrit dans une double histoire, celle de la personne et celle de la poésie, tout comme l’ossuaire visité à Rome dont un passage de la description, « tête cou- / pée qui coupe / la tête zone du cou », renvoie aux disparus et est une allusion transparente à "Zone" d’Apollinaire.