L'homme qui penche de Thierry Metz par François Huglo
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
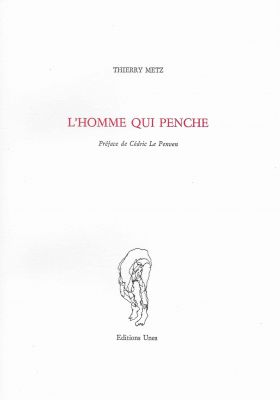
Comme celle de Georg Trakl, la poésie de Thierry Metz peut difficilement être séparée de sa vie et du traumatisme, provoqué chez l’un par le carnage de 1914 et chez l’autre par la mort de son deuxième fils Vincent, âgé de huit ans quand une voiture l’a fauché le 20 mai 1988. Le suicide sera pour les deux poètes le bout d’un chemin de dépression et d’addiction, cette manifestation de la pulsion de mort à travers la prise de la répétition sur le corps. « Je t’écris d’un ailleurs où il n’y a pas d’ailleurs. Vie reste vie Mort reste mort la voix ici ne se retourne pas, ne revient qu’avec des silences. Ou avec le pire », écrit Thierry dans Lettres à la bien aimée (1995). Dans les dernières lignes de L’homme qui penche, écrit au cours de deux séjours volontaires à l’hôpital psychiatrique de Cadillac où il lutte contre l’alcool et la dépression, fin 1996 et début 1997, quelques mois avant son suicide le 16 avril 1997, vie et mort se recouvrent et se cachent l’une l’autre : « Le mur est intact. Le maçon n’est lié qu’à ce qu’il fait. Et qui tient. Voilé par la mort. Que toute présence nous voile ». Dans sa préface, Cédric Le Penven parle d’un « présent inhabitable », d’un « perpétuel effondrement de l’ici », d’un « effort immense de ne pas céder à la chute tout en évitant de l’interrompre ».
Chaque livre de Thierry Metz est le Journal d’un Manœuvre, comme son recueil de 1990. « L’homme qui penche se penche pour écrire, pour retenir, peut-être, ce qui était plus penché que lui ». Pour « reconstruire un visage en décrivant ceux des autres humains égarés là », écrit Le Penven. Thierry parle-t-il de ce que bâtit son écriture ou de l’hôpital, quand il dit que « même si l’on connaît la maison, on ne sait où est allé l’habitant » ? Maison de retrait, de retraite, de recollection. « Chaque mot désigne la maison et l’habitant, la rencontre et la réparation ». Plus loin : « J’essaye, à ma manière, et plus simplement, de faire entrer l’homme que je suis devenu dans la maison de la rencontre et de la réparation ». Maison des morts-vivants ou des vivants-morts : « Eux ne sortiront jamais d’ici mais, comme des morts, ils ne le savent pas ». Sophie, par exemple : « Elle titube et tremble toute la journée, allant de sa chambre au fumoir, la nuque raide, les joues creuses, morte sans le savoir ». Maison où vivants et morts ne seraient pas séparés. Maison d’avant le deuil, suspendue à l’instant du trauma, de la rencontre du réel. Thierry et son fils se rejoignent dans un sommeil de dormeur du val, où un réel « intact et beau » baigne morts et vivants, « frais cresson bleu » (Rimbaud) ou « eau très claire, bruissante, peuplée d’épinoches » (Metz). L’enfant mort flotte face au ciel, comme porté par une barque, son regard dérivant avec les nuages, pour toujours :
« Je pense au rêve que je viens de faire. Le rêve d’un enfant allongé sur le dos, sa bicyclette près de lui, couché sur le talus, au bord d’une route communale. De l’autre côté se trouve une résurgence, une eau très claire, bruissante, peuplée d’épinoches. Derrière lui : un champ de betteraves. Et au-dessus, hauts, très hauts, des mirages qui s’étirent, rayés d’hirondelles et de martinets.
L’herbe.
L’eau.
Des nuages.
Pas plus.
C’est resté comme je l’ai vu. Intact et beau. Mais ne suis-je pas toujours dans l’herbe, à écouter l’eau en regard des nuages ? Et quoi que je fasse ou écrive, n’y a-t-il pas ou n’y a-t-il plus que cet instant ? »
Un tableau, mais aucune image. Un rêve, mais aucun onirisme. « Toute l’obscurité est dans le jour ». Thierry n’a « que ce blanc enfoui de la page pour enfouir la lumière —pour la retrouver ». Un présent sans avenir est sédimenté : « Il n’y a qu’aujourd’hui. Et qu’est-ce qui permet l’ouvrage et sa persistance sinon ce qui se dépose chaque jour en nous, retenu par une hypnose de la mémoire ? ». Il a envie de boire pour s’effacer « derrière ce geste », « pour que le travail de mort ait vraiment lieu ». De l’alcool au traitement médicamenteux, « je me débarrasse d’une ivresse par une autre, d’une mort par une autre mort, du vide par le vide ». Un possible est perdu : « Il me manque toujours tout ce qui aurait pu être. Et qui peut-être a été ». Plus loin : « Nous sommes en attente de ce qu’on croyait voir venir. Mais non, il arrive autre chose et il faut tout refaire ». Maçon toujours recommencé de maison des morts, de maison vide : « On cherche un habitant qui n’est plus dans la maison (…) N’est-ce pas l’homme qui penche, vu de trop loin maintenant, ou trop tard ? ». La vraie vie est absente : « Est-ce qu’on n’aurait pas pu vivre autre chose ? Que l’habitant ? Que la maison ? ». Thierry dit ne se sentir exister que quand il écrit, mais « le langage n’est qu’une piste que seule suivra notre ombre ».
C’est peut-être en commentant ce que vient de lui lire son voisin Farid après l’avoir écrit à l’encre rouge, que Thierry Metz définit le mieux son propre art poétique : « Paroles dévisagées et quelque chose qui n’est plus que soi —élémentaire, de toute urgence et qui va comme une lumière traquer le jour dans la lumière ». Le dénuement d’un fil électrique dénudé.