Mue de Stacy Doris par François Huglo
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
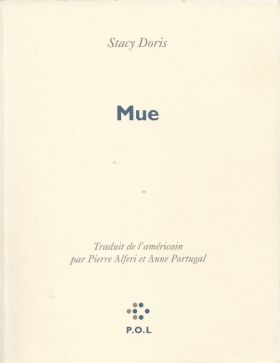
Il n’y a pas d’amitié, de connivence, d’empathie, il n’y en a que des preuves, et la traduction en est une. Gageons même que celle de la poétesse américaine Stacy Doris par Pierre Alferi et Anne Portugal comporte quelque plaisir ludique, malgré ou à travers la gravité du deuil : Mue est un legs, comme Les Congés de Jehan Bodel. La quatrième de couverture désigne ce livre comme : « le testament charnel et intrépide » que Stacy, emportée par la maladie en 2012, « adresse à son mari et à leurs enfants, saisis dans leur envol, leur premier plumage » (d’où le titre, Fledge : apprentissage du vol et moment où l’oisillon « se couvre de jeunes plumes, leur mue », précisent les traducteurs).
Il s’agit bien de saisies, d’instantanés quasiment photographiques, comme en cette métaphore éclair : « Tu fouilles ton bol / avec cuiller drone / en looping ». Ce délié libre de tout enchaînement dialectique incline à prendre avec une pincée de sel le sous-titre « Une phénoménologie de l’esprit », bien que le texte liminaire de Stacy présente le recueil comme « une traduction fidèle » de l’ouvrage, mêlée à « une reprise sauvage » de « poèmes de Paul Celan », entre « registre des désastres » et « compte rendu de miracle », et à « une brassée de poèmes d’amour d’amour éternel ». Les traducteurs ont vu Stacy « lire la plume à la main, jour après jour, la rude épopée spirituelle de Hegel », mais c’était pour opposer « au mâle idéalisme allemand » le défi de « la non dualité », de « l’échange fluide », du « désordre sans conflit, tout en maintenant comme des lèvres disjointes les césures trop réelles, béantes sans relève ».
Ce défi est celui que lance une forme poétique à celle d’un système philosophique. Stacy a écrit ou ré-écrit en français, traduit de l’espagnol et du français, traduit en anglais Tarkos et Fourcade. Elle écrit ici en américain, et peut compter sur la complicité de ses amis traducteurs. Elle s’est imposé « le vers de six syllabes, deux fois trois », et interdit « les bisyllabes : la paire est, par force majeure, disjointe ». Les traducteurs ont rendu « cette césure fondamentale » par « le vers impair, de cinq pieds », évitant ainsi le ronronnement de l’hexamètre français toujours prêt à « devenir l’hémistiche d’un alexandrin ». Le « repérage presque exhaustif du mot court » et « l’impair du veuvage » portent en creux « la dualité condamnée d’avance et en effet disparue, sauf dans l’évocation érotique des étreintes du couple et dans celles, câlines, des enfants ».
Il s’agit de saisir, de tenir. « On tient à tenir / pour certain », mais « un rien m’aplatit » et « pile usée je glisse ». Serrer, goûter : « Tenons notre bien / Ça baise et baiser / (…) / tu je suce acide / ton sourire, un long / bulbe ». Prendre et donner, conjurer par l’échange : « Mon mal —tiens mon mal—». Tout lâcher, dire « "Prends" à la nuit brève ». Car ça tient tout seul : « L’air tient l’air, sans bord ». Si « on s’agrippe aux cadres », ce n’est « pas jusqu’au bord ». Car « la forme est de nous ». Le réel est pente, « la pluie par exemple », et obstacle : « on bute / sur ce qui dépasse // du sable ».
Carrément contre Hegel ? « Au plus près veux pas / penser vivre un loin, / c’est philosopher, / un en-soi sais pas / s’affine à nos doigts ». Même si « l’on tend à figer / ce qu’on touche », la réciprocité du toucher qui « dit tu me touches » porte à « zapper la conscience / Dès qu’un acte est d’amour / rien nos doigts ne freine ». Toucher par la bouche : goûter. « Tuons le temps / à coups de fourchettes ».
Eros prend, dévore, et l’allitération mord à pleines dents : « Je t’agrippe et tu / bois la garniture / Ton slip a la grappe / alors tu m’agrippes / mais tes dents nous taillent / dans la même étoffe / saufs ». La vue, l’ouïe, ne sont pas exclues : « Viens voir mon bout mon / bout fait du bruit ». Ambigüité de « je fonce / dans ce qui me monte » : ce qui monte en moi ou ce qui me chevauche ? Plus loin : « Le moi cheval pousse. / Il fonce et calèche ». Du « sein secret », ballons sur la plage, « d’un coup on / lance en l’air le bleu ». Quand « le bleu même / peut plus me haler, / vite, vite un truc ». Et « Captive ou exclue / mon bleu, ce triomphe ».
Poussée des fleurs vers ce bleu : vers la mort ? « Tiges, nous —ça lustre / hisse vers un froid / prévu verrai pas / moi disjoint de toi ». Le « truc » urgent, c’est peut-être le langage. Les fleurs coupées ne font que changer d’élément : « Parole est un bain / sans partie d’évier / Envasons les tiges / Plongeons à pleins bras ». Le langage est agrippé comme « Doudou, car les noms / rapatrient les miettes / aimantées », quand « tout fuit dans la taie ». En un « Éloge évident », nous « accouchons doudou / de nos mains », qui serrent « fort chacun / en particulier / plus que nos reflux », et emballent « un seuil dans la joie ». Il y a du fort-da enfantin dans : « je balance tout / et tout resurgit / doudou sous la main / l’inerte c’est quoi ? ». L’autre m’allège : « Adieu gravité / rien qu’en moi perçue ». La réciprocité amoureuse —« sans tes mains ne puis / marcher (…)/ moi fabriquant toi / submergé d’un feu »— apprend, au moins autant que « philosopher », à mourir, à passer dans l’autre : « Donc toi, mon dehors ».